Tristan Leoni's three-part series of articles on IS and its 'caliphate', first published on DDT21 blogs.

Les Arabes, comme mercenaires ou auxiliaires, étaient le soutien indispensable des grands empires. On achetait leur concours, on craignait leurs révoltes, on se servait de leurs tribus les unes contre les autres. Pourquoi n’utiliseraient-ils pas leur valeur à leur propre profit ? Pour cela il faudrait un État puissant qui unifierait l’Arabie. Il pourrait ainsi assurer la protection des richesses acquises et du commerce, détourner vers l’extérieur l’avidité des Bédouins les moins pourvus au lieu qu’elle soit une entrave pour l’activité commerciale des Arabes eux-mêmes. Les États de l’Arabie du Sud, trop colonisateurs à l’égard des nomades, trop détachés des Bédouins malgré leur parenté lointaine, avaient failli à cette mission.
Un État arabe guidé par une idéologie arabe, adapté aux nouvelles conditions et cependant encore proche du milieu bédouin qu’il devait encadrer, constituant une puissance respectée à égalité avec les grands empires, tel était le grand besoin de l’époque. Les voies étaient ouvertes à l’homme de génie qui saurait mieux qu’un autre y répondre. Cet homme allait naître.
Maxime Rodinson, Mahomet, 1961, p. 58-59.
La naissance d’un État n’est ni fréquente, ni attendrissante. Et le prématuré, le proto-État, bien que très fragile, est déjà nuisible.
Avec l’actuelle restructuration du Proche-Orient, nous assistons à la constitution de nouvelles entités, les plus connues étant l’État islamique (EI) et le Rojava (Kurdistan occidental). Celui-ci, parangon de démocratie et de féminisme, serait un rempart contre la barbarie du premier. Car l’État islamique est un monstre, les images le prouvent. Tout le prouve. Il faudrait d’ailleurs le nommer Daech1 car il ne mériterait pas le « noble » qualificatif d’État et n’aurait « rien à voir » avec l’islam. L’explication devrait suffire. Elle n’est pourtant pas suffisante pour comprendre pourquoi et comment, depuis des mois, huit à dix millions de personnes vivent dans un territoire en guerre contre le reste de la planète. Les jours du Califat sont sans doute comptés, mais la question, elle, demeurera : Pourquoi ça marche ?
L’EI attire tous les regards, mais son image est brouillée. Le reflet qui nous parvient via les médias est celui d’une foire aux atrocités soigneusement mise en scène, ou d’épisodes guerriers choisis en fonction d’obscurs intérêts politico-militaires, par exemple la Bataille de Kobané. Mais parmi les groupes « rebelles » ayant émergé durant le conflit irako-syrien, l’EI est aussi le seul qui tente de mettre en place une structure de type étatique et qui s’appuie sur un projet politique structuré et ambitieux2 : le rétablissement du Califat disparu en 1258 qui implique une critique du monde, de sa marche, de l’Occident, de la démocratie, du nationalisme, etc. Est-ce à dire une critique du capitalisme ? Certainement pas, mais plutôt celle de certains de ses maux et excès, ceux qui entraveraient le fonctionnement libre et harmonieux d’une société califale rêvée… et surtout de son économie.
première partie : de l’État
« Ce qui serait le mieux, en ce moment, ce serait un pouvoir
autoritaire mais qui serait très bon, aimable et juste ».
Lilo Pempeit à son fils Rainer Werner, 1977.
Nous ne reviendrons pas sur les origines et l’artificialité centenaire des États et frontières de la région, ni sur les soulèvements de 2011 qui, en Syrie et en Irak, ont laissé place à une guerre civile puis, rapidement, à une confrontation militaire à plusieurs bandes opposant une multitude d’acteurs locaux et internationaux aux stratégies et alliances fluctuantes.
La généalogie de l’EI, à l’origine la branche irakienne d’al-Qaïda devenue autonome, est elle-même des plus complexe3 mais préoccupait peu de monde avant que ses troupes ne remportent une série de surprenantes victoires durant l’été 2014.
La question militaire
L’EI n’était à l’origine qu’un des groupes de résistance armée à l’occupation américaine en Irak (donc un groupe terroriste) ; mais, à partir de 2009, il bénéficie du ralliement de milliers de miliciens sunnites et de centaines d’ex-officiers de l’armée irakienne4.
Militairement très efficace, l’EI a été considéré par une bonne partie de la population irakienne sunnite comme une « armée de libération » et donc fêté comme telle5, et beaucoup de chefs de tribus ont choisi de lui faire allégeance. Cela explique que de nombreuses localités soient tombées entre ses mains aussi facilement (par exemple Mossoul) et que les troupes de Bagdad (chiites) n’aient que peu résisté dans ses régions.
L’EI s’est ainsi emparé d’un important arsenal qui lui servira pour progresser en Syrie à partir de 2013 ; dans ce pays les localités sont prises à la suite de violents combats contre d’autres groupes islamistes ou grâce au ralliement de ceux-ci. Dans le chaos ambiant, ses capacités logistiques et régaliennes lui valent une certaine popularité dans la population. C’est dans un second temps qu’il lancera des offensives contre le Rojava et le régime de Damas.
A noter que l’EI semble très attentif à la survie de ses combattants, n’hésitant pas à abandonner des positions si nécessaire (la question des attaques suicides est d’un autre ordre). Cette armée rassemblerait selon les estimations entre 30 et 100 000 hommes : beaucoup d’anciens miliciens irakiens, des arabes et des kurdes et au moins 20 000 volontaires étrangers. Leur solde étant versée avec régularité, cela limite pillages, vols et rackets dont sont coutumiers de nombreux autres groupes rebelles.
La réputation sanguinaire et impitoyable de ses troupes est sciemment entretenue ; n’étant pas signataire des Conventions de Genève, l’EI ne respecte aucune « règle » de la guerre, surtout contre ceux qu’il juge infidèles ou apostats. Ses adversaires, quels que soient leurs agissements, s’en trouvent parés d’un verni de respectabilité.
Administrer un territoire
Le rétablissement du Califat, sous le nom d’État islamique, a été proclamé le 29 juin 2014 dans la Grande mosquée d’al-Nuri à Mossoul. Le débat sur le terme « État » n’a pas cessé depuis6.
Si le mot désigne un territoire délimité à l’intérieur duquel une autorité souveraine fait régner ses lois sur une population fixe, dispose d’une armée, d’une monnaie et d’une économie, l’EI ressemble bien plus à un État que certaines entités aujourd’hui (plus ou moins) reconnues internationalement (Libéria, Somalie, Yémen, Vatican, Luxembourg, Libye, Soudan du Sud, etc.) et bien peu à un groupe terroriste.
Seule l’instabilité de ses frontières contredit le modèle étatique occidental, mais la guerre n’est pas seule en cause :
« Est-ce que le mot de « Dawla », généralement employé en arabe pour dire « État », et qui sert à l’acronyme « Daech », peut être exactement traduit par « État » ? Dans l’histoire du monde arabe et du monde musulman, ce mot distingue en effet des formes de gouvernement qui n’ont pas grand rapport avec l’histoire occidentale du mot État. Celui-ci renvoie à l’idée de « statique », de territorialité, de frontière, de souveraineté, de différenciation entre le politique et le social, en bref à bien d’autres choses que ce qui a pavé l’histoire du monde musulman » (Bernard Badie)7
Sur la question de la forme, l’EI a déjà répondu :
« Quant à ceux qui veulent des passeports, des frontières, des ambassades et de la diplomatie ils n’ont pas compris que les partisans de la religion d’Ibrâhîm [al-Baghdadi] mécroient et prennent en inimitié ces idoles païennes. […] Nous voulons rétablir l’État Prophétique et celui des quatre Califes bien-guidés ; pas l’État-Nation de Robespierre, de Napoléon, ou d’Ernest Renan. » (Dar al-Islam)8
L’EI gère un territoire de 300 000 km2 peuplé de 8 à 10 millions d’habitants. Il n’a pas tardé à installer (ou à transformer) les institutions du territoire qu’il contrôle. Elles se structurent autour d’une administration centrale réduite (sept ministres autour du Calife), d’un Conseil de guerre et de sept gouverneurs de provinces chacun assisté d’une choura.
Les deux grandes zones (Syrie et Irak) disposent d’une assemblée consultative composée d’imams, de prédicateurs, de notables des villes et de chefs de tribus, où toutes les voix n’ont pas le même poids mais où l’on recherche le consensus. La démocratie, invention occidentale et « idolâtre », est rejetée et le pouvoir législatif inutile : la charia suffit.
Raqqa (200 000 habitants) est de fait la capitale administrative, Mossoul (2,5 millions d’habitants) la capitale religieuse.
Lorsqu’il s’empare d’un territoire, l’EI restitue le pouvoir à des acteurs locaux (ou les maintient en place s’il leur fait confiance) : chefs tribaux, de clans, leaders de quartier, à condition qu’ils fassent allégeance exclusive à l’EI, qu’ils ne déploient d’autre emblème que celui de l’EI, et respectent ses injonctions en matière de mœurs.
Quant au fait que l’administration du Califat s’impose froidement par la violence et l’arbitraire, ce n’est certainement pas une raison pour la priver du nom d’État, au contraire.
Une répression extraordinaire… et ordinaire
L’EI est un des régimes les plus répressifs d’une région assez bien dotée en la matière9 mais c’est surtout le seul qui fasse un tel étalage d’« atrocités ». Pour des sociétés occidentales ayant connu une dé-brutalisation 10 ce ne peut être l’œuvre que de « barbares », c’est-à-dire qu’ils ne parlent pas « notre » langue.
Pourtant, dans les zones qu’il contrôle, l’EI, rétablit une forme d’État de droit, et ainsi « répond aux aspirations d’acteurs locaux »11. En Irak il a chassé les troupes chiites considérées par la population comme une abominable armée d’occupation, une « check point army » dont la présence n’apportait qu’exactions, violences, viols, racket, corruption généralisée et insécurité 12. Dans une ville comme Mossoul où régnaient bakchich et clientélisme, et où une misère massive jouxte d’inexplicables poches de prospérité, les premières mesures du nouveau régime, hautement symboliques, peu onéreuses et très médiatisées, sont l’éviction et l’exécution publique des corrompus. Les habitants le constatent, « c’est incontestablement un mieux par rapport à la situation précédente, devenue invivable »13.
Si l’ordre règne à Mossoul, c’est aussi que la répression est impitoyable. Mais loin d’être dictée par une folie mortifère incontrôlée, elle répond à de froides logiques étatique et administrative et trouve une légitimité dans une interprétation littérale du Coran et très rigoriste des Hadith (actes et paroles du Prophète). Cette abominable répression, ultra-médiatisée, relève en fait de trois registres différents :
1 / Politico-médiatique
Il s’agit d’exécutions d’otages mises en scène par les médias du Califat afin de choquer les Occidentaux. Elles sont massivement relayées par les médias occidentaux14.
2 / « Crimes de guerre »
Il s’agit des massacres, là aussi très médiatisés, commis par l’EI dans les heures et jours qui suivent la prise d’une ville ou de nouveaux territoires. Outre des exécutions de partisans ou sbires d’autres régimes, voire de militants démocrates ayant échappé à tous les groupes précédents, la nouvelle administration califale ne peut ignorer les minorités religieuses encore présentes15 :
Les gens du Livre (les chrétiens) se voient proposer trois possibilités : conversion, statut de dhimmitude (citoyens de seconde zone, mais protégés) ou exil. Beaucoup ont choisi cette dernière solution avant même l’arrivée de l’EI16.
Les « païens » (les Yézidis par exemple ) ne sont même pas considérés comme humains et n’ont donc aucun droit. Ils doivent être tués ou réduits en esclavage.
Les apostats (athées ou convertis) méritent simplement la mort. L’EI fait un usage fréquent du takfir, procédé permettant d’ôter la qualité de musulman à un adversaire et d’en faire un apostat (c’est le cas des chiites mais aussi de quasiment tous les sunnites opposés à l’EI).
Bien que l’EI se donne pour but d’appliquer strictement ce qui relève selon lui de prescriptions coraniques, il ne s’agit là que de la théorie. Dans la pratique, lors des combats, l’encadrement et la discipline n’étant pas encore du plus haut niveau, « bavures » et « exactions » sont fréquentes.
Quant au rétablissement de l’esclavage, c’est une conséquence des victoires militaires. Femmes et enfants capturés (« mécréants ») sont considérés comme une partie du butin qui se doit d’être partagée équitablement (ou du moins le produit de leur vente). Les victimes sont ainsi transformées en domestiques et/ou « concubines »17 (certaines auraient été achetées par des proxénètes turcs). Ici encore, l’EI se flatte d’appliquer à la lettre les indications du Coran qui encadrent cette pratique18.
3 / Justice ordinaire
Pour beaucoup de commentateurs, la justice quotidienne et correctionnelle est le service qui fonctionne le plus efficacement dans le Califat. Des juges religieux, les qadis, ont été nommés sur tout le territoire et pris place dans les Palais de justice.
Les peines encourues varient : amende, confiscation, flagellation publique ou non (par exemple pour avoir fumé une cigarette19), emprisonnement, amputation (pour un voleur), exécution selon diverses techniques (pour adultère, homosexualité, viol, corruption, etc.). L’effet recherché étant dissuasif et exemplaire, les exécutions sont publiques et les cadavres exposés. La baisse de la délinquance et de la criminalité serait considérable.
On retrouve des aspects de ces pratiques dans certains pays musulmans, en particulier l’Arabie Saoudite.
La justice jouirait auprès de la population d’une « réputation d’impartialité »20. Les médias de l’EI mettent évidemment en avant des exemples montrant que les djihadistes ne bénéficient pas de passe-droit : ici un responsable crucifié pour corruption, là un combattant exécuté pour viol.
Les qadis disposent d’une police chargée d’appliquer leurs décisions. Une autre unité, les muhtasibîn, fait respecter la hisbah (ce qui convenable ou pas, selon le Coran). Cette police des mœurs, rendue célèbre par la présence en son sein de femmes djihadistes européennes, surveille également les marchés.
Sans oublier une police secrète politique, l’Anni, et l’interdiction des manifestations. Le contrôle et la surveillance de la population semble particulièrement redoutable et des experts y voient même la « patte » d’officiers irakiens formés aux techniques du Bloc de l’Est21. Les opposants débusqués sont exécutés de manière exemplaire et, on l’aura compris, « si vous respectez leurs règles sans broncher, personne ne s’en prendra à vous »22. Pourtant, aussi efficace soit-elle, une politique répressive ne suffit pas à assurer la pérennité d’un régime.
La vie quotidienne
Les informations disponibles sont parcellaires, souvent anecdotiques et concernent le plus souvent Raqqa ou Mossoul. La réalité est sans doute bien différente dans les campagnes ou d’une ville à l’autre, en fonction de l’ancienneté de l’arrivée de l’EI, du degré de soutien ou de résistance des tribus et de la population, de l’éloignement ou de la proximité du front. Les réglementations peuvent par exemple s’appliquer de manière progressive23.
Dans les rues ce qui frappe c’est assurément le noir des femmes. Les nouvelles réglementations liées aux mœurs, à la religion (interdiction du tabac, de l’alcool et de la drogue24) mais surtout celles concernant la condition féminine sont les plus connues.
En fait, la situation des femmes s’est progressivement dégradée en Irak depuis le premier embargo de 1990 et surtout après 2003. Il en est sans doute de même en Syrie depuis 2011, où la plupart des zones « libérées » de Assad sont aux mains de groupes armés islamistes.
Outre un code vestimentaire très strict imposé dès le plus jeune âge (voile obligatoire pour les fillettes à partir de la troisième année d’école), les femmes ne peuvent circuler dans les villes du Califat sans la présence d’un tuteur masculin. Les seuls emplois féminins autorisant un déplacement hors du domicile semblent liés au secteur médical ou éducatif. A noter que, contrairement à l’Arabie saoudite, les femmes sont autorisées à conduire des voitures.
Il est également demandé aux hommes un effort vestimentaire, notamment d’éviter les tenues jugées trop occidentales ou certains vêtements de marques.
Ces rues des grandes villes dans lesquelles la police scrute les vêtements semblent pourtant grouillantes et bruyantes, les étals et boutiques achalandés, l’activité commerciale battant son plein25 . Ce n’est pas le business que souhaite bouleverser l’EI, plutôt l’apparence et la surface pour les remettre en adéquation avec la volonté divine. Les journées sont ainsi rythmées (perturbées selon certains commerçants) par les cinq prières quotidiennes, il y a enfin des agents qui régulent la circulation aux carrefours, de nouvelles plaques minéralogiques, un calendrier lunaire, etc.
L’EI accorde aussi une attention toute particulière à la sécurisation et à l’amélioration de l’approvisionnement, ainsi qu’à une baisse des prix des denrées alimentaires ; d’où le contrôle des moulins et boulangeries, autrefois publiques en Syrie. Pendant qu’une jeune « Autorité de protection des consommateurs » veille sur l’hygiène et la qualité des produits, les muhtasibîn sont attentifs aux prix dans les rues et sur les marchés : on peut tout de même être exécuté pour « spéculation et accaparement »26 .
Lorsqu’une ville est conquise, comme toute armée d’occupation conséquente, l’EI a parmi ses priorités de rétablir le fonctionnement des services publics. Les employés des entreprises publiques et les fonctionnaires sont incités à rester en place et le versement des salaires est assuré s’il le faut27. (et avec plus de régularité que sous le règne de Nouri al-Maliki). L’état civil se remet à fonctionner, prenant juste en compte les modifications légales (comme l’autorisation du mariage pour les filles dès l’âge de neuf ans).
L’EI s’efforce de reconstruire les infrastructures endommagées par la guerre mais lance aussi de nouveaux projets mis en valeur dans sa presse : réparation de ponts et de circuits électriques, création de lignes des transport public à prix réduit, restauration d’un service postal, etc. Lors de la prise de Palmyre, les exécutions à peine terminées, l’EI a dépêché sur place des techniciens pour rétablir l’électricité et les connexions internet. Les fonctionnaires de la ville ont reçu des avances sur salaire et du nouveau matériel médical a été installé dans l’hôpital28. A Raqqa, réalisation emblématique, le palais du gouverneur a été transformé en hôpital29. Dans des zones périphériques parfois délaissées par les régimes précédents, l’EI a pu « bénéficier de significatifs effets de contraste dans son rapport aux populations »30 en finançant des campagnes de vaccination, la construction de dispensaires, de puits ou d’écoles.
L’éducation est une autre des priorités affichées. Le régime insiste sur la nécessité de rouvrir écoles et universités, surtout pour les filières scientifiques et techniques. Il a créé une fac de médecine à Raqqa, où une université scientifique est réservée aux femmes. Quant aux programmes scolaires, ils ont subi une brutale réforme inspirée du modèle saoudien.
Il circule des images d’enfants et jeunes adolescents recevant une formation militaire dont on ignore le contexte : déscolarisation complète ou (plus vraisemblablement) cours hebdomadaire ?
Mais la propagande du régime montre aussi des djihadistes emmenant se baigner des enfants souriants, jouant avec eux, d’autres gamins au volant d’autos-tamponneuses ou sur des jeux gonflables géants dans les parcs. On sait aussi qu’à Mossoul a été organisée une « Journée du divertissement » avec distribution de ballons (sic) et concours de récitation du Coran…31
Un programme social
Les vidéos d’exécutions ne sont qu’une partie de la propagande de l’EI que véhicule internet : s’y ajoute un volet social et caritatif.
Il est classique pour les mouvements islamistes (d’opposition) de mettre en place des programmes d’aide aux plus démunis. Celui de l’EI est de grande ampleur et les mesures annoncées sont diverses : allocations aux familles les plus pauvres (à Raqqa, ville délaissée par Damas, 10 $ par enfant, puis 250 $ au début de l’hiver)32, ouverture de cantines, distribution de nourriture, contrôle ou baisse des prix des produits de première nécessité, plafonnement des loyers, allocations familiales, prime au mariage et pour chaque naissance33, allocations pour les familles de soldats morts au combat, etc.
L’EI achète ainsi la paix sociale et le soutien de la population, mais cela s’inscrit aussi dans son projet politique. Les djihadistes ayant en charge l’administration d’un territoire, s’ils crucifient les opposants, ils se doivent aussi de veiller sur l’immense majorité de la population qui respecte leur interprétation de la charia et qui peut, dans une certaine mesure, bénéficier elle aussi des conquêtes militaires34.
Il y a forcément une différence entre un programme et sa réalité35. D’autant que l’EI, de par même sa légitimisation religieuse ne peut bouleverser l’ordre établi (par Dieu) en s’en prenant aux différences de revenus, classes, hiérarchies (parfois tribales), allégeances, etc. Il ne peut se donner comme objectif que d’en limiter les excès et les abus les plus criants, sans pour autant succomber à son tour à la corruption, ce qui n’est pas simple36.
L’économie califale
Les informations en ce domaine sont en général fragmentaires et invérifiables (on apprend ainsi que l’industrie du ciment représenterait 10 % des recettes de l’EI, sans plus de précision37) ; beaucoup de chiffres sont avancés mais très peu de détails sur le fonctionnement concret des entreprises.
L’EI disposerait d’un patrimoine de 2 260 milliards de dollars, son fameux « trésor de guerre », mais ce chiffre recouvre en fait la valeur des installations pétrolières et gazières, des mines de phosphates, des terres agricoles et des sites culturels situés sur son territoire (dont des centaines de millions de dollars trouvés dans les coffres de la banque centrale de Mossoul)38. Il est en hausse par rapport à 2014. Le budget de l’État en 2015, de l’ordre de 2,5 milliards d’euros, aurait diminué, notamment à cause des recettes liées au pétrole (baisse des cours et hausse des bombardements), quoique celles provenant de taxes et confiscations grimpent.
Nous avons tout d’abord affaire à une économie de guerre, dans des zones parfois ravagées par les combats et vidées d’une large part de sa population. C’est surtout le cas en Syrie où, sur 22 millions d’habitants, 4 millions ont fui à l’étranger et 8 à 10 ont dû quitter leur domicile ; si certaines villes sont « passées » intactes à l’EI, d’autres ont été ravagées par de longs combats. De nombreuses usines ont déménagé dans d’autres régions ou en Turquie39.
C’est différent dans la partie irakienne du Califat où économie et population sont depuis longtemps adaptées à ce type de situation.
C’est via la Turquie (et dans une moindre mesure la Jordanie) que l’économie de l’EI est reliée au reste du monde, mais son entrée en guerre à l’été 2015 ainsi que les offensives kurdes menacent cet accès.
Dans le cadre d’une économie de guerre, l’EI semble faire preuve de pragmatisme afin de relancer au plus vite les unités de production nécessaires à son effort militaire et au ravitaillement des populations dont il a la charge (puis à la perception de taxes), en fonction de l’urgence, du type de propriétaire (compagnies d’État, qui sont nombreuses, ou privées), du type d’entreprise, des particularités locales. Cette capacité d’adaptation est facilitée par la large autonomie dont jouissent les autorités locales.
C’est ce réalisme, et non une volonté de libéralisme économique, qui expliquerait la privatisation de certaines entreprises d’État (sans exclure un bénéfice financier) ou le lancement d’un programme de soutien aux petites entreprises et à l’économie locale40. Des usines abandonnées par les propriétaires ont sans doute été remises en fonctionnement par l’EI. Par exemple, la gestion de certaines exploitations pétrolières a été laissée un temps aux entreprises en place, et pour d’autres confiée à des tribus locales.
En tout cas, l’EI paraît édicter plus de programmes, brochures, décrets, fatwas, etc. sur les questions de mœurs que d’économie.
Impôts et fiscalité
Un nouveau système fiscal reposant sur des prélèvements réguliers et des procédures et barèmes formalisés a été mis en place pour assurer le fonctionnement de l’État. Ces impôts, qualifiés par les médias occidentaux d’« extorsion » et de « racket », représentent au moins un tiers des revenus de l’EI. Ils comprennent la Zakât, aumône légale et troisième pilier de l’islam, aux formes diverses, parfois payée en nature par les paysans ; la Sadaqa, don volontaire aux nécessiteux, et la Djizya, impôt des dhimmis, lourde mais progressive selon les revenus (on parle de 60 à 250 dollars mensuels à Mossoul).
De très nombreuses taxes existent (certaines au titre de la Zakât) par exemple sur : les entreprises, le revenu des entreprises nouvellement créées, les télécoms, la protection des commerces, les retraits d’espèces, les salaires (5 % pour la «protection sociale»), ceux versés par Damas ou Bagdad (50 %), les produits aux frontières, les chameaux, les péages, etc. Cette fiscalité remplace celle des régimes précédents mais aussi les pots-de-vin qui étaient obligatoires.
Les « extorsions » comprennent de nombreux cas de confiscations : d’argent pour non-respect des réglementations (sur l’alcool ou les cigarettes), et de maisons, de terres, de voitures ou de bétail suite à l’abandon par leurs propriétaires.
L’augmentation des recettes en 2015 a deux causes : les difficultés du régime qui doit augmenter les taxes existantes, et une amélioration de l’administration et de la collecte.
Ressources extraordinaires et « criminelles »
Il s’agit de sommes versées par des donateurs privés du Golfe (les liens tribaux jouent ici un rôle important), des rançons d’otages, de la vente/rachat d’esclaves, et du commerce d’antiquités (ou plutôt de l’encadrement de ce trafic). Souvent liés aux conquêtes militaires, ces revenus ont tendance à se tarir.
De multiples rumeurs circulent sur divers trafics (cigarettes, drogue, organes) et d’activités mafieuses contradictoires avec l’idéologie affichée du régime. Ce qui semble plus certain, c’est la taxation de certaines filières préexistantes (par exemple celle du Captagon).
Banques41
L’EI s’est doté d’une banque d’État et d’une monnaie officielle : dinars, dihrams et fulus califaux sous forme de pièces en or, argent et cuivre (la valeur d’une pièce serait celle de la valeur intrinsèque du métal qui la compose). On ne sait rien de son utilisation réelle sinon qu’elle est peu probable.
L’EI contrôle sur son territoire plusieurs dizaines d’établissements bancaires, certains continuant à effectuer des opérations commerciales y compris des transactions internationales. Les banques de Mossoul, succursales d’établissements basés dans le Golfe ou à Bagdad, ont continué (continuent peut-être encore) à fonctionner normalement.
Le régime est néanmoins confronté à des difficultés de change : si ses revenus sont encaissés en dollars, euros, livres turques ou syriennes, il règle ses factures en dollars.
Agriculture
Elle représenterait entre 7 et 20 % des recettes du Califat, qui contrôle les vallées fertiles du Tigre et de l’Euphrate, là où étaient produits 50 % du blé syrien, un tiers de celui d’Irak (8ème producteur mondial) et près de 40 % de l’orge irakienne.
Ici encore la guerre est un facteur important dans des régions très agricoles (dans le gouvernorat de Raqqa, 50 % de la population active travaille dans ce secteur). Beaucoup de paysans ont fui (notamment des chrétiens ou kurdes) abandonnant fermes et terres. L’EI s’en est emparé mais des champs restent en friche42. Le contrôle de cette production est vital car il permet au régime de fixer le prix de la farine et donc du pain, base de l’alimentation.
L’EI contrôle aussi une large partie des champs de coton syriens dont la vente représenterait 1 % de ses recettes. L’exportation de cette fibre est moins aisée que celle du pétrole, mais la principale destination est la même : 6 % des importations turques auraient ainsi pour origine les champs du Califat. De quoi produire un cinquième des tee-shirts made in Turkey (soit 1,2 % de ceux vendus en France)43.
Divers
Quoique l’EI se soit emparé de la majorité des mines syriennes de phosphate (nécessaire à la fabrication d’engrais), il n’a pas les moyens de relancer l’ensemble de la production et il lui est difficile de la vendre. Cela représenterait néanmoins 10 % de ses recettes44. Il contrôle également des sites d’extraction de soufre en Syrie et en Irak, ainsi que de nombreuses cimenteries.
Hydrocarbures
Si en 2003 les compagnies américaines ont raflé tous les contrats irakiens, elles ont dû depuis faire face à la concurrence de BP, Lukoil et surtout de la Chine qui, depuis 2008, a investi des dizaines de milliards dans le pétrole irakien, devenant le premier client et le premier investisseur dans le pays. Aujourd’hui, 50 % de la production sont exportés vers la Chine (chiffre qui devrait atteindre 80 % en 2035), et l’on projette de construire deux pipe-lines reliant les deux pays. Plus de 10 000 travailleurs chinois étaient présents sur place avant l’irruption de l’EI.
Alors que les États-Unis cherchaient à se désengager militairement de la région, l’accentuation du chaos irakien gênait donc surtout les investisseurs chinois (déjà chassés de Syrie par la guerre). Ce n’est qu’en août 2014, lorsque l’EI a menacé les zones pétrolières sous contrat avec des compagnies américaines (Kurdistan et sud de l’Irak) et Bagdad (dont la chute aurait été catastrophique pour toute la région), que l’US Air Force a dû intervenir.
L’EI contrôle 60 % du pétrole syrien et 10 à 15 % de celui d’Irak (ce dernier chiffre a certainement baissé depuis le recul des troupes de l’EI à l’automne 2015). La production est estimée en 2015 entre 20 000 et 50 000 barils de pétrole par jour, contre au moins 70 000 l’année précédente : c’est une goutte d’eau comparée à la production régionale (la Syrie produisait 385 000 barils par jour en 2010)45. Le pétrole, vendu 50 à 60 % de moins que les prix du marché, rapporte entre 1 et 1,5 million de dollars par jour, soit entre 350 et 600 millions de dollars par an. C’est la principale ressource de l’EI (selon les sources entre 25 et 40 %) mais elle diminue du fait de la baisse des prix du marché et des bombardements occidentaux.
Par ailleurs, Daech recrute au prix fort des personnels compétents (techniciens, ingénieurs, traders…), en Syrie et en Irak mais aussi à l’étranger, pour améliorer la productivité de ses sites vieillissants46. L’État Islamique s’est fixé pour objectif de parvenir à des rendements doubles de ceux obtenus dans les champs de pétrole avant qu’il en prenne possession47.
L’EI s’occupe presque uniquement d’extraire du pétrole brut, vendu au pied des puits à des commerçants indépendants, contrebandiers, ou simples propriétaires de camion, qui emportent le pétrole pour le raffinage, la consommation locale (60 à 70 %) ou l’exportation. En octobre et novembre 2015, les bombardements américains auraient détruit des centaines de ces camions. De même, les grosses installations de raffinage comme beaucoup de ses raffineries artisanales (mobiles) ayant été détruites par la coalition, l’EI s’adresse à des raffineries privées dont il taxe la production. En Syrie, moyennant le paiement de taxes, des compagnies pétrolières privées ont pu continuer à travailler dans des zones conquises par l’EI48. L’exportation se fait par contrebande vers la Jordanie, la Turquie ou des zones tenues par des groupes ennemis via une myriade de camion, parfois à dos d’âne ou de cheval, ou acheminées par de mini-oléoducs artisanaux. En Irak, le trafic de pétrole est une pratique remontant aux temps de l’embargo, voire plus ancienne.
En Syrie le contrôle de l’extraction donne lieu à de nombreux conflits entre groupes rebelles pour le partage de cette importante source de revenus. Il en va de même des exploitations gazières qui permettent la fourniture de gaz et d’électricité aux populations.
Cela laisse aussi le champ libre à des trafics stupéfiants. Le pétrole extrait sur le territoire de l’EI peut être vendu à ses ennemis : à d’autres groupes, au régime de Damas ou au Rojava49. La prise d’une centrale électrique à gaz près de Palmyre a obligé Raqqa et Damas à des marchandages, puisque personne ne contrôle l’intégralité de la chaîne de la production à la distribution50. Dans la région de Deïr ez-Zor, l’EI a confié l’extraction de pétrole et de gaz aux tribus locales qui récupèrent une fraction des bénéfices mais vendent une partie de la production au régime d’Assad pour se prémunir de représailles aériennes.51 Attention aux sabotages d’oléoducs par des tribus exclues du jeu !
Rien qu’un État ?
Construire un État tout en faisant la guerre à presque toutes les puissances de la planète est loin d’être aisé. Ce que nous venons de décrire est moins un tableau socio-économique de l’EI à un instant T que l’esquisse d’un processus qui, en gros, s’étend de l’été 2014 à l’été 2015. C’est durant cette période, qui sera peut-être un jour considérée comme celle de « l’apogée » du Califat, celle de son expansion maximale, que l’EI se lance dans la construction d’un État, de son administration, tente de relancer son économie tout en assurant un niveau de vie supportable pour sa population.
Cette période est sans doute achevée et ce processus passé en involution. Sauf surprise d’ampleur, l’implication progressive de la Turquie dans le conflit, l’intervention militaire russe (octobre 2015) et la montée en puissance de celle des Occidentaux (été et automne 2015) devraient d’ici quelques mois régler la question de l’existence territoriale de l’EI en Irak et en Syrie. Déjà tous les indicateurs passent au rouge et les tableaux de productions et statistiques cités plus haut seront fin 2016 fort bas.
Nous nous demandions au début « pourquoi ça marche ? » Et nous avons vu que la survie et l’expansion de ce régime ne s’expliquaient pas seulement pas ces capacités militaires et policières. Certains parlent même d’« État providence ».
Mais c’est aussi que le Califat n’est pas seulement, banalement, un État. Non content d’administrer, il prétend transformer le monde, instaurer une nouvelle ère ou en préparer la venue… Une ère où il ne s’agirait évidemment pas pour l’EI d’abolir le salariat ni la société marchande, seulement de les remodeler à sa façon. « Pour que tout reste comme avant, il faut que tout change » (ici le « comme avant » est d’importance), la surface, les mœurs, coutumes, etc. Bien sûr, mais aujourd’hui, pour des milliers habitants d’Irak et de Syrie, et bien au-delà, l’espoir s’appelle Califat. Et des dizaines de milliers de jeunes, notamment beaucoup de prolétaires, traversent la planète pour y vivre ou y mourir, et beaucoup d’autres en en rêvent. Cet espoir est désespérant. Non ?
Tristan Leoni, novembre 2015
1Acronyme arabe de l’ancien nom de l’EI, utilisé d’avril 2013 à juin 2014, « l’État islamique en Irak et au Levant » (faisant lui-même suite à « État islamique d’Irak »).
2Le projet du PYD n’a lui pour cadre que le Kurdistan syrien (Rojava). L’EI entend lui, dans un premier temps, s’étendre de l’Inde à l’Espagne. Sur le PYD, voir notre article paru sur DDT21 en janvier 2015, « Kurdistan ? ».
3Sur cette question, voir Myriam Benraad, Irak, la revanche de l’histoire, Paris, Vendemiaire, 2015, 288 p.
4A partir de 2006, au sein de comités al-Sahwa (le Réveil), Bagdad avait salarié des milices sunnites pour lutter contre al-Qaïda. Le Premier ministre Nouri al-Maliki y met un terme en 2009, licenciant ainsi 85 000 miliciens.
5Pierre-Jean Luizard, Le Piège Daech, La Découverte, 2015, p. 17.
6Voir les entretiens avec Philippe-Joseph Salazar, disponibles sur Youtube depuis novembre 2015.
7Interview de Bernard Badie, Afrique Asie, octobre 2015, p. 33.
8Dar al-Islam, n° 3, mars-avril 2015, p. 14 (Dar al-Islam est la revue francophone de l’EI).
9Unique exception, le Rojava. Les chances d’y être enfermé arbitrairement, exécuté, torturé ou « disparu » par la police y sont bien plus faibles que partout ailleurs dans la région. Même Human Rights Watch le reconnaît.
10Au sens de George Mosse, historien qui a forgé le concept de « brutalisation » appliqué aux sociétés sorties de la Première Guerre mondiale, et dans laquelle il voit la « matrice des totalitarismes ».
11Pierre-Jean Luizard, op. cit., p. 15-16.
12L’armée de Bagdad, gangrenée par un absentéisme organisé et une forte corruption était d’une rare inefficacité pour assurer un semblant de sécurité dans la ville.
13Pierre-Jean Luizard, op. cit., p. 29.
14Ces images n’utilisent pas les mêmes canaux que celles, nombreuses et très populaires sur internet, montrant par exemple des djihadistes jouant avec de petits chats.
15Un traitement qui rappelle, par ses pratiques et son cadre religieux, celui des populations occitanes lors de la Croisades des Albigeois au XIIIème siècle.
16La dhimmitude, sévère et contraignante, comprend notamment le paiement d’un impôt spécial, la Djizya. A Raqqa quelques dizaines de chrétiens ont choisi ce statut, alors qu’à Mossoul les évêques ont préféré l’exil.
17Abdel Bari Atwan, Islamic State: The Digital Caliphate, Londres, Saqi Books, 2015 ; Claude Moniquet , Djihad : D’Al-Qaida à l’État Islamique, combattre et comprendre, La Boite à pandore, 2015, p. 182.
18Des agissements qu’il est problématique de qualifier de « barbares » tant ils rappellent les heures les plus glorieuses de l’Antiquité grecque.
19De par sa dangerosité, la cigarette est assimilée au suicide qui est interdit par l’islam.
20« Administration, police, communication… Daech, les rouages d’un quasi-État », http://bibliobs.nouvelobs.com, 18 novembre 2015.
21Alain Rodier, « Irak/Syrie: Daesh, comment ça marche ? », https://www.cercle-k2.fr, 7 juin 2015.
22Selon un membre du groupe d’opposants Raqqa is Being Slaughtered Silently cité par Layal Abou Rahal, « Raqqa, la ville modèle du califat de l’EI », L’Orient le Jour, 21 juin 2015.
23Hala Kodmani, « A Palmyre, l’État islamique a cherché à gagner la confiance », Libération, 1er juin 2015.
24Le célèbre Captagon, sorte d’amphétamine, n’étant ni un psychotrope ni un hallucinogène, n’est pas jugé haram. Les soldats de l’EI l’utilisent car il augmente la vivacité psychique et la résistance à la fatigue. Des djihadistes français ayant succombé à son caractère addictif ont été emprisonnés par l’EI.
25Voir les reportages de Vice News sur Raqqa : https://news.vice.com/video/the-islamic-state-part-1
26Avant, les réseaux clientélistes locaux organisaient la pénurie artificielle de denrées alimentaires de base pour faire monter les prix.
27Bagdad ou Damas continuent parfois à payer leurs fonctionnaires dans les zones qu’ils ne contrôlent plus ; c’est aussi le cas au Rojava.
28Hala Kodmani, « A Palmyre, l’État islamique a cherché à gagner la confiance », Libération, 1er juin 2015.
29www.france24.com, octobre 2014.
30Grégoire Chambaz, « Facteurs tribaux dans les dynamiques du contrôle territorial de l’État islamique », http://courrierdorient.net, 11 octobre 2015.
31Yochii Dreazen, « Daech, administrateur colonial », Foreign Policy, 20 août 2014 (Courrier international, hors-série, octobre-décembre 2015)
32Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, L’État islamique. Anatomie du nouveau Califat, Bernard Giovanangeli Editeur, 2015, p. 98.
331 000 dollars selon Samuel Laurent, L’État islamique, Seuil, 2014, p. 100.
34On pense ici au livre de Götz Aly, Comment Hitler a acheté les Allemands : Le IIIe Reich, une dictature au service du peuple, Flammarion, Paris, 2005.
35Les informations décrivant une situation alimentaire et sociale catastrophique avant l’été 2015 sont rares. Voir par exemple sur Raqqa en novembre 2014: Marie Le Douaran, « A Raqqa, Daech vit grand train mais fait mourir la ville à petit feu », http://www.lexpress.fr, 27 février 2015.
36Myriam Benraad, « Défaire Daech : une guerre tant financière que militaire », Politique étrangère, vol. 80, n° 2, été 2015.
37Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, op. cit., p. 118.
38Marine Rabreau, « Pétrole, taxes, trafics d’humains : comment Daech se finance », Le Figaro, 19 novembre 2015.
39Henri Mamarbachi , « Comment fonctionne l’économie de guerre en Syrie », http://orientxxi.info, 8 octobre 2015.
40Yochii Dreazen, « Daech, administrateur colonial », op. cit.
41Jean-Charles Brisard and Damien Martinez, Islamic State : The Economy-Based Terrorist Funding, Thomson Reuters, octobre 2014, 12 p.
42Aline Joubert, « L’État islamique vit-il au-dessus de ses moyens ? », http://www.marianne.net, 07 Mars 2015.
43« Le coton syrien continue d’habiller les Français », Le Monde, 23 septembre 2015. et Caroline Piquet, « Peut-on retrouver du coton «made in Daech» dans nos vêtements ? », Le Figaro, 3 septembre 2015.
44Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, op. cit., p. 118.
45En 2014, l’Italie produit quotidiennement 121 000 barils et le Koweït 2,8 millions.
46Marine Rabreau, « Comment Daech organise son lucratif marché pétrolier », Le Figaro, 26 novembre 2015.
47Elisabeth Studer, « Daesh financé par la manne pétrolière », www.leblogfinance.com, 19 octobre 2015.
48Financial Times, 16 octobre 2015.
49« Les ennemis de Daesh achètent son pétrole », RMC, 26 septembre 2014.
50Jacques Hubert-Rodier, « Les affaires mafieuses d’Assad avec Daech », Les Echos, 19 octobre 2015.
51Frantz Glasman, « Deïr ez-Zor, à l’est de la Syrie. Des islamistes, des tribus et du pétrole… », http://syrie.blog.lemonde.fr, 8 décembre 2013.
Source: DDT21, 6 décembre 2015
Comments
De l’utopie
« Toutefois, pourvu qu’on juge sainement des choses, les révolutions de ce temps n’offrent partout qu’une guerre d’esclaves imprudents qui se battent avec leurs fers et marchent enivrés. »
Saint-Just, L’Esprit de la révolution et de
la constitution de la France, 1791.
La répression de toute opposition n’explique pas tout. Surtout pas la « réussite » de l’État islamique (EI), c’est-à-dire le soutien populaire qu’il rencontre. C’est qu’il s’agit davantage d’un processus de construction étatique que de l’occupation d’un territoire par une « groupe terroriste ».
Après des années d’un guerre civile impitoyable, l’arrivée des troupes de l’EI ne signifie pas seulement le remplacement d’un régime de terreur par un autre, mais aussi [voir la première partie] le retour d’un État de droit, un calme relatif, une amélioration du ravitaillement, la réparation d’infrastructures, le rétablissement de services publics, la mise en place rapide d’une administration… dans le meilleur ou le moins pire des cas, certes, mais les habitants peuvent préférer l’ordre au chaos1. Que l’EI joue ainsi de ses capacités régaliennes, administratives, logistiques et financières explique qu’il ait pu être accueilli comme un libérateur dans plusieurs villes, puisse apparaître pour certains « comme un régime tout à fait respectable »2, ou que des tribus lui aient fait allégeance3.
Mais ce n’est pas tout. Il va falloir rajouter une couche, celle d’un « espoir désespérant ». Celle de l’adhésion, au delà du pragmatisme, d’une partie de cette population au discours et au projet du Califat. Car l’EI peut compter sur la participation active de dizaines de milliers de militants, soldats ou fonctionnaires, mais aussi sur le soutien passif d’un certain nombre d’habitants d’Irak et de Syrie (et sur la passivité prudente ou indifférente de beaucoup d’autres).
Et puis il y a ces dizaines de milliers de jeunes, notamment beaucoup de prolétaires, qui traversent la planète pour vivre au Califat ou y mourir, tandis que tant d’autres en rêvent.
Sunnistan…
« Penser global, agir local »
Jacques Ellul
Les temps seraient-ils venus pour l’avènement de l’État islamique ? Un nouvel État ? Moins artificiel que ceux existants ? On sait que l’EI a, de fait et symboliquement, aboli la frontière tracée au cordeau entre la Syrie et l’Irak. Est-ce ce fameux grand État regroupant les arabes sunnites, à cheval sur les ruines de deux autres ?
Une partie de la bourgeoisie locale peut espérer en un projet de type Sunnistan4. L’Irak était condamné et la Syrie le semble également. Dans le cas d’un éclatement de l’Irak, tel qu’envisagé avant l’irruption de l’EI, la partie sunnite aurait eu une place marginale, enclavée, très inférieure à celle que lui accorderait un futur grand État sunnite.
Sa forme peut paraître surprenante, mais l’EI joue son rôle d’État en préservant les intérêts de la classe capitaliste locale et en ayant une vision d’avenir. D’un point de vue économique, notre première partie a montré la volonté qu’à l’EI d’unifier (au-delà des divisions artificielles, nationales, ethniques) et de pacifier un territoire, et d’y relancer, rationaliser, et moderniser l’économie, notamment l’extraction pétrolière5. Et s’il lance des appels à l’Hijra, invitant à émigrer vers ses territoires non seulement les musulmans ayant une expérience militaire, mais aussi les enseignants, juristes, médecins et ingénieurs6, c’est pour préparer le futur et compenser l’émigration de beaucoup des membres des classes moyennes et supérieures. Aujourd’hui infréquentable, il pourrait demain satisfaire les intérêts de grandes puissances (reconstruction du pays, redistribution des cartes pour la production de pétrole, ventes d’armes, etc.) ou au moins préparer le terrain à de tels projets.
La création d’un Sunnistan de fait participe de l’inévitable remodelage d’une carte du Moyen-Orient dessinée il y a un siècle. L’EI effectue le sale boulot : massacres et déplacements de population qui faciliteront le tracé des prochaines frontières, rendant ainsi ces zones homogènes d’un point de vue ethnique et religieux, parachevant une confessionnalisation entamée depuis longtemps. Pour ce faire, il s’appuie sur ce qu’il y a de plus traditionnel comme pouvoir : les tribus. Al-Baghdadi n’oublie pas de se dire membre de la tribu des Quraysh, celle des descendants de Mahomet. Modernisation et archaïsme ne sont pas incompatibles.
Son projet repose sur une structure étatique souple, décentralisée, restituant aux notables locaux un pouvoir confisqué par Bagdad et Damas. Il assure une stabilité sociale intérieure en focalisant l’attention sur le « sociétal » (mœurs, vie quotidienne) et en canalisant la révolte des plus pauvres et une violence endémique vers l’extérieur.
Dans la zone irakienne du Califat, passivement ou activement, une majorité d’Arabes sunnites acceptent le nouveau régime. Après des années d’humiliation, c’est leur revanche (contre les chiites et les Américains), la reconquête de pouvoir, d’honneur et d’une visibilité politique. Par opportunisme et tant que cela sert leur intérêt, les chefs tribaux ont peu à peu adhéré au projet transnational de l’EI7 . Ils ont été suivis en cela par d’anciens cadres baasistes, d’ex-officiers de l’armée irakienne et de nombreux prolétaires des quartiers et zones déshérités de la région.
Mais, peut-être poussé par l’intervention américaine de l’été 2014 dans une stratégie de « sortie par le haut », l’EI ne s’est pas enfermé dans un communautarisme etnico-religieux de type Sunnistan. Bien que « revanche de l’histoire », le projet de l’EI ne se limite pas à n’abattre qu’une seule frontière.
… ou Califat ?
Les idéologies importées d’Occident (nationalisme, socialisme et, dernière en date, démocratie) n’ont guère apporté satisfaction, elles ne convainquent même plus dans leurs terres d’origine, et l’inadaptation du cadre national aux situations moyen-orientales n’est plus à démontrer. Fini les grandes idéologies politiques :
Si le Califat accorde une telle importance aux réformes dites sociétales (quotidien, mode de vie) ce n’est pas par maniaquerie. Le sociétal fait la différence, la seule à long terme ; c’est là la meilleure justification de l’EI, son marqueur politique, sa prise d’autonomie par rapport à l’Occident, une rupture avec plus d’un siècle de colonisation, de courbettes, d’emprunts idéologiques et de travestissements inefficaces.
L’EI, qui dénonce le nationalisme comme une « ordure de l’Occident », a aboli la frontière entre la Syrie et l’Irak, ce qui lui a permis de raviver les liens tribaux8. Le nationalisme, supposé défunt en Europe depuis 1945, y réapparaît sous forme régionaliste (Italie du nord, Flandres, Catalogne, Ecosse…), mais sa renaissance aux marges du continent (ex-Yougoslavie, Ukraine) s’accompagne de conflits meurtriers. Ce qui est censé réunir divise. Au Moyen Orient, un Etat national « syrien » ou « irakien » n’a de force que celle du dictateur capable de le faire tenir. Rien d’étonnant donc que la « récupération » idéologique de l’internationalisme et de l’universalisme par l’EI soit une de ses séductions majeures.
Son programme officiel, c’est la restauration du Califat abbasside disparu en 1258 et, dans un premier temps, la reconquête de toutes les terres musulmanes, de l’Inde à l’Espagne. Nous pouvons en rire, mais certains prennent la chose très au sérieux, notamment ceux qui sont prêts à mourir et tuer pour cela. Quant au caractère « médiéval » il est trompeur car s’il passe injustement en France pour archaïque, grossier, ou primitif, dans le monde arabo-musulman il évoque une période d’âge d’or, de référence. Reprendre cette thématique c’est raviver « un rêve arabe ». Certes un « Un rêve éveillé qui sème la mort », mais « la dernière idéologie totalitaire crédible, à la fois idéaliste et réaliste »9 et capable de mobiliser les foules. Ce rêve arabe d’un retour en grâce et en gloire après des siècles d’humiliation peut sembler contradictoire avec l’idéal universaliste musulman, mais cette contradiction n’est pas nouvelle, et s’articule assez bien… surtout si des Arabes sont à la tête du projet. Quoi qu’il en soit, vainqueur ou vaincu, le Califat se sera attaché, à coup de symboles, à créer une mythologie capable de survivre à sa disparition et, dans le futur, de faire lui aussi rêver.
L’enfant caché du Printemps ?
L’EI est-il le représentant de cet Hiver islamique qui aurait succédé aux Printemps arabes, à moins qu’il ne les ait étouffés ? Ou bien son fils illégitime qui vient frapper à la porte ?
Le cas de l’Irak est un peu à part de ces événements puisque le pays a connu depuis 2003 une occupation étrangère et une première guerre confessionnelle. En 2011 et 2012, le régime de Nouri al-Maliki fait néanmoins face à un vaste mouvement de protestation sociale majoritairement sunnite auquel il répond par une une violente répression. Le conflit opposant sunnites et chiites redémarre donc, mais prend cette fois la forme d’une guerre ouverte entre le gouvernement de Bagdad et l’EI.
La situation syrienne de 2011 s’inscrit dans un schéma de départ plus classique. Celui de pays où, même lorsqu’ils en avaient pris l’initiative, les cadres corrompus des vieilles dictatures faisaient obstacle aux tentatives de réformes libérales. Un compromis satisfaisant les intérêts contradictoires des classes en présence supposait rien moins qu’un développement capitaliste autonome et pacifié dans la région – possibilité totalement exclue.
En Syrie, la politique d’infitâh (ouverture et libéralisation économique) des années 2000 profite évidemment au pouvoir alaouite mais aussi à une partie importante de la bourgeoisie urbaine sunnite avec laquelle il a fait alliance. Les victimes de ces réformes sont, on l’aura deviné, ouvriers, chômeurs et paysans. C’est dans les quartiers où ils vivent (multiethniques mais majoritairement sunnites) qu’éclate en mars-avril 2011 le soulèvement, vite rejoint par la mobilisation des intellectuels et classes moyennes émergentes, mécontents des limites du changement social et du progrès démocratique.
Face à la détermination du régime et de l’armée10, la féroce répression, mais aussi la poursuite des manifestations, une partie de la bourgeoisie syrienne a fait le choix de rompre avec le régime et de tout miser sur sa chute. Grâce à l’appui d’opposants vivant dans les capitales occidentales et au soutien de divers Etats (en particulier du Golfe) la révolte va prendre une tournure militaire11. On sait que « la guerre dévore la révolution », mais ici il y avait très peu à manger, et l’involution a été rapide. Entre un régime jouant la carte de la confessionnalisation, des apports extérieurs et un terreau fertile, le conflit va prendre l’aspect d’une opposition entre sunnites et chiites. Militarisation et rébellion rimant progressivement pour des centaines de groupes armées avec islamisme sinon salafisme et djihadisme. Mais après 2012 « la majorité des jeunes Syriens qui s’étaient soulevés contre le régime par esprit démocratique sont morts, partis en exil ou ont rejoint le djihadisme. Il n’y a plus de modérés »12.
L’aspect armé et confessionnel du conflit ne gomme pas pour autant tout aspect de classe et recoupe des oppositions préexistantes entre régions utiles et périphériques, villes et campagnes, centre-villes et quartiers pauvres. C’est dans ces derniers qu’est née la révolte, notamment de ces « quartiers informels »13 qui ceinturent les grandes villes syriennes, par exemple Alep où vivait une population majoritairement sunnite ayant fui les campagnes après la sécheresse de 2008. Les combats prendront fréquemment la forme d’affrontements entre des périphéries aux quartiers majoritairement rebelles et un centre-ville fidèle au régime. Il semble que beaucoup de rebelles djihadistes soient ainsi originaires des zones rurales les plus pauvres, celle que Damas abandonnera en premier. Leur irruption au cœur des villes a souvent été mal vécue par les habitants qui les percevaient comme « une sorte de lumpen-proletariat rural en quête de revanche sur la ville. ». Par exemple à Deïr ez-Zor et à Alep où la population a « froidement accueilli l’entrée dans la ville de rebelles venus des campagnes »14.
Nombre de ces rebelles feront allégeance à l’EI lorsque celui-ci entrera en Syrie en 2013. Ils sont donc physiquement le lien entre les révoltes de 2011 et le Califat qui se revendique lui-même comme « le seul véritable héritier » des Printemps arabes15. Il est en tout cas la conséquence, voire la réponse, à leur échec. La lutte contre la corruption qui paraît centrale pour l’EI fait assurément écho à celle que dénonçaient les manifestants de 2011. Par son respect des traditions, et son rejet de l’Occident et de sa démocratie mais aussi des dictatures, l’EI apporte un facteur éthique dont ne peuvent se prévaloir les démocrates laïcs. Et contre les démocrates islamistes, c’est la démocratie comme création occidentale qu’il condamne, et avec elle l’Occident tout entier, adhérant ainsi implicitement aux théories d’un choc des civilisations.
L’EI fait ceci, l’EI fait cela, mais c’est la bourgeoisie locale qui est aux manettes. On peut en effet dire que la signification véritable de dawla n’est qu’accessoire et voir dans l’EI un État comme un autre, à savoir une simple expression de la bourgeoisie locale, qui défend ses intérêts et réprime le prolétariat. Comme on peut le dire de la Hongrie de l’amiral Horthy, de l’Equateur de Rafael Correa et de la France de François Hollande. On peut aussi ajouter que les prolétaires servent toujours de chair à canon aux bourgeoisies qui s’affrontent. C’est vrai, mais le débat n’en est pas clos pour autant. La forte implication de prolétaires au sein de l’EI mérite d’être questionnée (comme leur présence au sein du NSDAP ou des Bonnets rouges).
Société de classes en Syrie, en Irak, comme partout, certainement, mais quid de la lutte des classes ? En Syrie la question ne se pose parfois presque plus tant l’exode des populations a été massif (4 millions d’émigrés, 8 à 10 millions de déplacés) : les premiers à partir ont été les plus riches (beaucoup de cadres et professions libérales), ceux qui restent sont surtout les plus pauvres. Une ville comme Deïr ez-Zor qui comptait entre 600 et 800 000 habitants n’en a conservé que quelques dizaines de milliers, ce qui bouleverse quelque peu le quotidien de la lutte des classes à l’usine ou au bureau.
Dans la partie irakienne, on l’a vu, la société s’est adaptée depuis des dizaines d’années pour survivre dans la guerre puis la guerre civile, mais l’activité du Califat satisfait néanmoins une partie de la classe capitaliste (commerçants, marchands, chefs de tribus). D’autant que les exécutions de fonctionnaires et notables corrompus ont l’avantage d’offrir des places à ceux qui n’avaient pu l’être, et que la nouvelle bureaucratie semble (pour l’instant) moins parasite que la précédente.
L’EI offre une porte de sortie aux plus pauvres, car outre son volet caritatif, il est un employeur potentiel pour le prolétariat surnuméraire qui n’a pas émigré. La mobilisation religieuse et la guerre de conquête (vers l’extérieur) procurent en premier lieu un revenu à des dizaines de milliers de prolétaires, donc de familles (les soldes sont versées avec régularité). L’ascension sociale au sein du mouvement peut y être rapide (contrairement à al-Qaïda dont les dirigeants étaient généralement issus d’élites sociales). Mais il s’y ajoute les projets d’infrastructures et des travaux de reconstructions qu’a entamés le régime, sorte de relance « keynésienne » financée par le trésor de guerre de l’EI. Contrôlant steppes et déserts, il assiste aussi, ou promet de le faire, les paysans pauvres et les bédouins de ces régions périphériques délaissées par les autres gouvernements.
Dans les zones d’Irak et de Syrie qu’il contrôle, l’EI semble donc opérer une jonction entre les intérêts d’une partie de la classe capitaliste mais aussi ceux d’une partie du prolétariat, forçant ainsi la création d’une même communauté vectrice de paix sociale. Pourtant si les origines sociales des dirigeants ne prouvent rien, on se souviendra qu’en dernier lieu, les choura et conseils consultatifs qui aident le Calife dans sa tâche [voir la première partie], sont constitués d’imams, de notables des villes et de chefs de tribus. On est donc loin des conseils ouvriers.
Islam supplementum ?
« Au milieu de ces dislocations, l’islam a ceci de remarquable qu’il offre une communauté immédiate (manifeste dans la solidarité effective qu’il organise), et s’affirme contre l’argent et contre les frontières. Ce dernier aspect n’est pas mineur. Pour un Français (musulman, catholique ou incroyant), la frontière compte peu, car il est libre de voyager tout en restant assuré d’un cadre national au sein duquel, tant qu’il obéit aux lois, il bénéficie d’une protection et d’une assistance minimales : en un mot, il a un Etat. La moitié des Africains et nombre d’Orientaux ignorent le bonheur de cette « vaste prison confortable » (Max Weber). Le territoire où ils vivent est susceptible d’être parcouru et ravagé par des bandes incontrôlées, leurs maigres biens dispersés, et leur famille déplacée ou décimée. Ils souffrent à la fois d’un appareil étatique dictatorial et de son effacement. Ils privilégieront donc d’autant mieux une communauté transnationale que l’État national est pour eux une imposture : l’oumma des croyants apparaît comme une issue, et la charia comme facteur de stabilité. »
Troploin, Le Présent d’une illusion, 2006.
Il semble qu’aucune autorité religieuse ne soit apte à juger de l’islamité ou non de l’État islamique16. Certains prétendent pourtant qu’il n’aurait « rien à voir avec l’islam ». Nous sommes d’autant plus mal placés pour juger de la chose que, pour nous, croire en dieu est évidemment synonyme d’aliénation. Nous nous bornerons donc à remarquer que l’EI explique et justifie lui-même l’ensemble de ses actes, écrits et propos par une lecture littéraliste du Coran et très rigoriste des hadiths.
Le problème ne réside pas dans l’excès de croyance, ni la solution dans sa modération. Il n’est pas plus irrationnel de croire au Paradis (et donc au peu d’importance de la vie terrestre), à l’imminence de l’Apocalypse, au retour du Califat, qu’à la « simple » existence d’un dieu. Et si l’on admet la réalité d’un Paradis, il suffit parfois d’un (grand) pas de plus pour l’estimer réalisable sur Terre.
Selon certains théologiens musulmans, de nombreux signes, à commencer par la guerre en Syrie, prouvent que la fin des temps approche, l’heure du combat final contre Satan. Le rétablissement du Califat disparu en 1258 avec la prise de Bagdad par les Mongols s’inscrit dans ce cadre et représente la « cristallisation d’un rêve ancien »17.
Dans des régions très fortement sécularisées comme la France, cela semble de la folie et il est tentant d’y répondre par le sarcasme. Habitués à des religions tolérées car tièdes, modérées et promptes au dialogue, nous avons peine à comprendre le martyr ou l’eschatologie, et plus encore la cohabitation d’une dimension politique (la prétention à l’hégémonie califale) et d’une dimension religieuse (la prétendue réalisation eschatologique de l’islam). Nous pensons aussitôt à un simulacre ou à une instrumentalisation. La religion n’est pourtant jamais exclusivement ni même particulièrement spirituelle : elle est également politique, culturelle, économique et militaire, un cadre social qui peut dans certains pays prendre des formes très concrètes (répartition des quartiers d’une ville en fonction des confessions comme par exemple à Beyrouth ou Belfast).
Mais cela, plus encore dans l’islam qui repose sur une orthopraxie : être musulman, c’est respecter des pratiques (en particulier les cinq piliers). Le respect de ses pratiques est donc lié à une identité, à l’appartenance à un groupe, une communauté qui, au Moyen-Orient, dépasse et englobe des cadres tribaux limités. Artificielle ? Tout autant que la nation ou le Baas qui ont montré leur inefficacité comme ciment idéologique d’une société devant réunir prolétaires et bourgeois. D’où l’importance portée par les militants du Califat au respect des pratiques qui participe de la création d’une homogénéité culturelle et religieuse (presque « reposante » après des années de guerre civile) ; d’où le fait de s’en prendre d’abord aux mauvais croyants (sunnites débauchés, corrompus, etc.). La tâche est d’autant plus urgente si l’Apocalypse approche, car « pour préparer la confrontation de la foi et de l’impiété, c’est la terre d’islam qui doit être purifiée des gouverneurs injustes, des oulémas corrompus, des croyants pervertis et des femmes impudiques. L’épée de vengeance s’abattra sur les hypocrites avant de se tourner contre les infidèles. »18 . Mais il ne s’agit pas seulement de sang à verser, mais d’un État à bâtir où les musulmans, les opprimés, pourront se réfugier et vivre pleinement leur religion tout en se préparant, matériellement et spirituellement, au combat final. Une pratique fait exister un territoire.
Quand la religion mobilise les foules, cela exclut-il la sincérité ? Question souvent posée pour les dirigeants du Califat et les anciens officiers baasistes, moins pour les simples militants de base (toujours cette dichotomie entre les manipulateurs et les imbéciles). On émet généralement des doutes sur la réalité d’adhésion à des valeurs ou idées qui nous révoltent.
En politique (comme dans la vie), il est rare d’être totalement cynique ou totalement naïf. Peu importe qu’Al Bagdadi croit en dieu ou uniquement en l’argent19 . Pour les anciens officiers irakiens, adhérer au parti Baas n’était pas pour autant adhérer à l’idéologie baasiste. On sait par contre que l’islam a été ressorti des cartons de l’histoire par Saddam Hussein à partir de 1991 et que le marxisme n’est pas un vaccin contre la religion (voir son influence chez les fondateurs du Hezbollah ou du Djihad islamique palestinien).
L’important, c’est la correspondance qui s’opère à un moment entre une croyance et une situation. Si l’histoire islamique est scandée de mouvements révolutionnaires qui ont instrumentalisé, plus ou moins habilement, la dynamique millénariste, les textes apocalyptiques connaissent depuis la fin des années 1970 un renouveau mondial amplifié à partir de 2001 (sur Internet ou en brochure). En 2008, Jean-Pierre Filiu, qui n’évoquait pas la vie politique française, écrivait qu’un « un groupe subversif, anxieux de retrouver le « chemin des masses » ou de se distinguer de formations rivales, peut être fort tenté de recourir à la thématique messianique : elle lui tiendrait lieu de discours de ralliement, de grille d’interprétation ou de récit refondateur, avec un impact redoutable. »20.
Avec l’EI c’est bien le cas, et ces discours prennent aujourd’hui un sens directement politique dans le monde musulman, et une concrétisation dans la guerre au Moyen Orient. Il est certainement absurde de penser qu’au XXIe siècle de grandes batailles doivent opposer en Syrie les Romains aux troupes musulmanes dirigées par le Mahdî (l’imam « bien guidé »), et que, sur le minaret blanc de la mosquée de Damas, Jésus apparaîtra pour participer à la bataille finale contre Satan21. Mais quand cette idée anime des dizaines de milliers de combattants convaincus de participer à une rupture historique révolutionnaire inaugurant une ère nouvelle, l’idée devient « force matérielle ». La comprendre, c’est saisir ses fondements sociaux, mais aussi mesurer « la distance culturelle espace-temps » (Salazar) qui nous sépare du djihadisme califal. Lorsqu’Engels étudiait la Guerre des Paysans au 16e siècle, sans imaginer que les idées (la Réforme, les croyances millénaristes) menaient le monde, il les prenait au sérieux comme facteur historique. Si nous avons du mal à le faire face à l’EI, c’est que nous tenons à tort la religion pour un moribond qui ne ferait que survivre.
Prolos, utopistes et réacs ?
« La réalité de la démocratie m’est alors apparue clairement : entretenir dans l’esprit des gens l’idée de liberté et les convaincre qu’ils sont un peuple libre tout… en projetant sur le devant de la scène des people et une fausse réalité afin de les distraire de ce qui se passe réellement, de ce fait alimentant parmi les Occidentaux une ignorance politique crasse »
Jake Bilardi, djihadiste australien22.
Les djihadistes étrangers font la une des journaux occidentaux et califaux. Combien sont-ils ? on l’ignore, des milliers en tout cas, peut-être entre 15 et 30 000, venus de presque une centaine de pays rejoindre l’EI23. La moitié sont originaires du Moyen-Orient (Saoudiens, Turcs, Jordaniens, etc.) et du Maghreb (principalement des Tunisiens), plusieurs milliers de l’Union européenne (dont 60 % de France, Grande-Bretagne et Allemagne). Parmi eux, 1 500 à 2 000 Français, dont déjà beaucoup sont revenus.
Tous ceux qui rejoignent le Califat ne le font pas pour s’engager dans son armée (30 à 100 000 hommes). Les femmes en premier lieu (10 % du total des volontaires, voir ci-dessous) sont exclues du front. Mais l’EI a lancé des appels à la hijra (immigration, hégire) pour tous les musulmans, en particulier aux cadres, ingénieurs, enseignants, etc. A leur arrivée, les volontaires se voient attribuer une tâche correspondant à leurs compétences et aux besoins du moment. Mais certains se contentent de répondre à l’appel à vivre en terre d’islam : des Français ont par exemple ouvert deux restaurants à Raqqa.
On n’expliquera pas l’ampleur du phénomène par le goût de l’aventure ou la fascination pour la violence : ces motifs existent mais n’ont rien de spécifique à l’EI. On n’y comprendra pas davantage en l’attribuant à l’ignorance, la pathologie, la petite enfance, les problèmes familiaux ou la manipulation mentale via Internet, explications qui servent surtout de gagne-pain à des spécialistes en « dé-radicalisation » pour ados djihadistes.24 Il n’y a pas de profil type du djihadiste mais deux groupes se dégagent :
Le premier comprend des jeunes prolétaires principalement issus de l’immigration maghrébine et originaires des banlieues. Il s’agit surtout d’hommes ayant dépassé la vingtaine. C’est un profil de djihadiste que les « spécialistes » considèrent comme classique, proche de qui existait dans les années 1990. La figure du petit caïd dealer de shit radicalisé en prison existe mais n’est pas la règle.
Le second groupe (en progression) rassemble des jeunes de classes moyennes (voire supérieures), dont beaucoup d’ados et de post-ados (30 à 40 %) et de filles (30 %). Ce phénomène est parait-il très sensible en Europe depuis 2013, époque à laquelle se dégrade fortement la situation en Syrie avec, entre autres, l’arrivée de l’EI.
Même s’ils sont pleins de haine pour la société, déboussolés ou en quête de sens, on comprend mal que ces jeunes soient attirés par un pays où l’on passe son temps à égorger et décapiter de pauvres gens. C’est peut-être que les exécutions et les horreurs largement diffusées par les médias mainstream, ne représentent en fait que 2 % des images diffusées sur internet par le secteur communication du Califat25.
Quête de justice
Ce que le contrôle social et la police nomment « radicalisation » a généralement pour origine un profond sentiment d’injustice sociale et une prise de conscience : par exemple des rapports de force « dominants/dominés » dans cette société (mais pas de son caractère de classes), du « système », des violences que subissent les populations syriennes et palestiniennes sous le regard passif des Occidentaux, etc.
On doit se demander pourquoi, à cet instant, les réponses de la Fédération anarchiste (simple exemple) ne s’imposent pas. La faiblesse de la diffusion du Monde Libertaire n’est sans doute pas seule en cause.
Non seulement les réponses de l’EI sont radicales dans leur stigmatisation de l’Occident décadent, des États corrompus du Golfe et du sionisme, mais elles s’appuient sur une pratique concrète et la possibilité de solutions immédiates : le Califat se présente comme un rempart militaire contre les atrocités du régime d’Assad, un soutien pour les populations (réalisations sociales, hôpitaux, orphelinats, etc.) et un outil de la volonté divine qu’il suffit de rejoindre pour changer le monde. Et s’il le faut le billet d’avion sera payé.
Religion de rupture
La conversion à l’islam est un passage obligé qui caractérise tous les djihadistes venus d’Occident. Parmi eux et elles, beaucoup de Français « de souche » (25 à 30 %) n’ayant pas été élevés dans la « culture » musulmane. Quant à ceux qui l’ont été, ils se considèrent généralement, eux aussi, comme des convertis ; ce sont les born again, ceux qui font un retour à l’islam26.
L’islam comble, comme on dit, le « vide métaphysique » typique de nos sociétés, celui d’une jeunesse en quête d’identité et de repères et, dans tous les cas, il est une rupture. En premier lieu d’avec l’Occident décadent ; certains auteurs évoquent même une jeunesse qui « incarne les idéaux de l’anti-Mai-68 »27 , en phase avec les auteurs réacs à la mode et, comme les jeunes manifestants de la Manif pour Tous, opposée à l’assouplissement des normes, à la dilution de l’autorité, à la famille recomposée, etc. Mais rupture également d’avec le milieu d’origine et familial, car l’islam marocain, comme l’algérien ou le français, n’est pas « le bon », alors que celui du Califat est présenté comme le plus proche du texte.
On tente généralement de décrédibiliser les djihadistes en se moquant de la rapidité de leur conversion et de leurs faibles connaissances religieuses (mais combien de catholiques sauraient expliquer la Sainte Trinité ?). Or, l’islam est une religion où la conversion est particulièrement aisée ; devenir musulman n’exige que de prononcer la chahada puis de respecter les cinq piliers. Libre ensuite au croyant de consacrer le reste de sa vie à l’étude des textes.
Antiracisme
L’EI affiche un discours antiraciste (là encore avec dénonciation de l’Occident) : ses combattants sont ceux d’une « armée multi-ethnique » et ses médias tiennent à montrer des images de djihadistes de toutes couleurs de peau. Le Califat a vocation à rassembler la communauté des croyants, y compris des ethnies qui lui restent jusqu’ici opposées ou qui, ailleurs, se déchirent. De nombreux Kurdes se battent ainsi dans son armée : ils auraient même représenté 50 % de ses effectifs lors de la bataille de Kobane28. Au moins un des sept dirigeants de l’EI est un turkmène irakien.
Populisme
Les volontaires sont aussi sensibles à l’appel à la révolte que lance le Califat. Celle des bons (les exclus, les victimes, ceux d’en bas, qui résistent et s’engagent) contre les mauvais (les riches, les corrompus, les « pourris », les élites, les intellectuels, la presse). Les clivages de classes importent ici peu, tout est une question de choix à faire pour rejoindre le camp du Bien, celui de l’EI.
« Le djihadisme califal comporte tous les attributs d’un populisme fort, celui qui opère des révolutions. […] Que ce « peuple » soit normé religieusement ne change rien au processus. Il est temps qu’on s’en aperçoive, car ce qui se profile est un mouvement de ré-enchantement populiste du monde. Une accumulation d’actes spontanés et d’actions de groupe suscite peu à peu un mouvement de conscience collective. Et ce mouvement, en s’amplifiant, devient la logique constitutive du « vrai, bon peuple », un surgissement brutal du « peuple » qui prend une forme politique irrésistible et qui se traduit, envers ceux qui ont été désignés comme l’ennemi, par une radicale hostilité » 29.
Figure du « héros négatif »
On a rapproché l’engagement djihadiste d’autres mobilisations militantes armées30. Si la comparaison est fausse, ce n’est pas seulement parce qu’une cause serait bonne (se battre contre le fascisme et pour la révolution) et une autre mauvaise (répandre de force une religion sur le monde). L’« exotisme romantique » offert par le djihad est très différent de ses précédents gauchistes et tiers-mondistes. Le début du 21e siècle coïncide avec la venue d’une des premières générations à croire que l’avenir ne sera pas meilleur que le présent, probablement pire, et que la politique ne pourra rien y changer. Lorsque semble s’éclipser tout projet politique collectif porteur d’espérance, peut apparaître le héros noir (couleur des pirates, des anarchistes, des fascistes et des djihadistes), l’extrémiste qui terrorise la société, figure détestable au plus haut point. Donc particulièrement fascinante.
Un féminisme califal ?
« Si on veut prendre le contre-pied de la culture occidentale,
la femme au foyer est une figure alternative. »31
Il n’existe aucune autorité féministe qualifiée pour juger du féminisme ou non de l’État islamique. Cela peut paraître surprenant mais, indubitablement, la question taraude les spécialistes et journalistes qui s’intéressent à la question des femmes djihadistes, et le mot féminisme revient sans cesse sous leurs plumes, diversement qualifié : « califal », « pseudo », «dévoyé», « tordu », « post », « anti », etc. Les plus djeun’s évoquant même un djihad version girl power.
C’est dans les années 1990 qu’est apparu un « féminisme islamique ». Les militantes qui s’en revendiquent puisent inspiration et justifications dans les sourates du Coran qui, selon elles, révèlent un message d’égalité et de justice. La période pré-islamique, la Jahiliya, ère de désordre et d’ignorance, aurait été caractérisée en Arabie par le laxisme, la promiscuité et une sexualité non-contrôlée. L’islam y met fin en codifiant précisément dans le Coran les questions de mariage, filiation, héritage, etc. ou en encadrant et limitant juridiquement des pratiques coutumières (comme la polygamie). Le contrôle des femmes et de leur sexualité qui en a découlé est donc historiquement perçu comme synonyme d’ordre, d’équilibre et de paix32. Il s’agirait là d’un grand progrès pour les femmes qui explique que Mahomet puisse être considéré comme « l’une des plus grandes figures universelles du féminisme »33.
L’EI ne se qualifie nullement de la sorte et ne se revendique pas du « féminisme islamique » mais, lui aussi, va chercher dans le Coran mais également dans les hadiths des réponses à la question de « la femme ». Le Califat peut agir contre les femmes tout en prétendant les placer au centre de la société et les protéger.
Les protéger ? Et les femmes chiites, chrétiennes ou Yezidis assassinées, violées ou réduites en esclavage ? [voir première partie] Si elles méritent un tel sort c’est que, dans la logique de l’EI, elles n’entrent juridiquement pas dans la catégorie « femmes » qui ne comprend que les femmes musulmanes. Cette vision est évidemment partagée par les militants et militantes du Califat, les plus motivées de ces dernières étant les djihadistes étrangères.34
« Militantes » et « motivées » car leur engagement est une chose sérieuse. Ici encore, le discours occidental dominant est plutôt de les considérer comme les victimes d’un vil embrigadement, de manipulation ou de maladie mentale ; bien plus que les hommes car bien moins capables de prendre ce genre de décision. Et puis, selon une vision essentialiste encore très répandue, « la femme » qui donne la vie ne peut naturellement pas rejoindre le camp du mal et de la mort. Mais, qu’on se rassure, l’EI est sur des positions similaires.
Les femmes représentent 10 % des volontaires étrangers. Parmi elles, plusieurs centaines d’Occidentales, dont beaucoup de Françaises et de Britanniques, la plupart jeunes (souvent entre 15 et 25 ans) et généralement mieux instruites que leurs homologues masculins, et plus souvent issues de classes moyennes. Pour certaines ce choix est une sorte d’émancipation (ou du moins une fuite) par rapport au milieu familial et culturel d’origine, du moins un acte d’autonomie et de prise de responsabilité, « en contraste flagrant avec la « stratégie culturelle » d’un islam implanté en Europe qui privilégie d’abord l’homme »35.
Leurs motivations sont similaires à celles des hommes : un sentiment d’injustice devant les souffrances du peuple syrien, une révolte contre les discriminations subies par les musulmanes en Occident, le désir d’apporter une aide concrète (plus humanitaire que militaire) mais aussi l’envie de vivre librement sa religion (voile intégral, non-mixité complète, etc.).
Si une poignée d’entre elles, très médiatisées, travaillent pour la police de Raqqa, la principale fonction des femmes du Califat est loin d’être secondaire : être épouse et mère. Pour ces femmes qui ne peuvent manier l’AK47 sur le front, c’est une forme de djihad : « Il n’y a pas de plus grande responsabilité pour elle que celle d’être la femme de son époux », et «la grandeur de sa position, le but de son existence est un devoir divin de la maternité»36.
Plutôt dévalorisé dans nos sociétés, le rôle traditionnel de mère/femme au foyer est présenté par le Califat comme celui « d’une actrice révolutionnaire d’une société radicalement alternative ». 37
Et puis il y a cette étrange « tentation de la dépendance »38, cette apaisante soumission. Mais celle de l’épouse au mari ne serait que relative, formelle, puisque tous deux sont directement soumis à Dieu (Colette Guillaumin parlerait peut-être d’« appropriation divine »). Mais le choix de l’époux n’est pas sans importance, on traverse des continents pour le trouver. Nous ne parlons pas d’un individu particulier, mais de l’homme idéal. Il existe, il risque sa vie au nom de Dieu sur le champ de bataille, c’est le djihadiste : un homme pieux, sincère, honnête, fidèle, courageux, fort, viril et protecteur, qui croit au mariage et la famille39. Un homme qui, les lecteurs de Soral et Zemmour le savent bien, n’existe plus en France. Des centaines de jeunes femmes partent en Syrie pour se marier et fonder une famille avec des hommes de ce genre. C’est leur tâche principale40. Des agences matrimoniales ont même été mises en place dans les villes du Califat afin de faciliter les unions entre djihadistes mais aussi avec des autochtones.
Les plumes de l’EI s’accordent avec les auteurs réactionnaires français41 pour proclamer « l’échec du modèle féminin occidental »42 qu’ils accusent de ne respecter ni les femmes (les obligeant par exemple à côtoyer les hommes, autorisant le nu mais interdisant le niqab) ni la famille (mariage gay, avortement). D’un constat auquel pourraient souscrire des féministes radicales, celui d’une fausse égalité d’autant plus perverse qu’elle tente de faire croire aux femmes qu’elles sont libres, l’EI passe à un discours qui promeut une logique de différence et de réelle complémentarité des sexes.
Il n’est pas simple de balayer d’un revers de main la « sous-culture du girl-power djihadiste » ou « l’empowerment à la sauce djihadiste » qui se fait jour sur les réseaux sociaux 43. Le féminisme ayant réalisé en Occident une partie de son programme, il est souvent caricaturé mais devenu consensuel, ses acquis vont de soi, l’égalité hommes-femmes est partout proclamé, la « théorie du genre » est enseignée à l’école… pourtant les inégalités persistent. De ces contradictions, l’islam extrême fait son miel et se donne des airs anticonformistes.
En accordant une importance si grande au mariage de ses militants, à leur famille (on a vu dans la première partie qu’il avait instauré diverses primes et allocations), le Califat ancre résolument son projet dans l’avenir. Il s’agit d’assurer la production de futurs combattants et prolétaires (la pilule est évidemment interdite sur son territoire). Les femmes djihadistes, sorte d’avant-garde, ont donc un rôle valorisé et sont particulièrement respectées et protégées.
« Particulièrement contrôlées, vous voulez dire ! Discours et hypocrisie patriarcaux que tout cela ! » Sans aucun doute, mais l’idéologie du Califat est ainsi faite et, quoi qu’on en pense, fonctionne.
La participation croissante des femmes djihadistes est néanmoins une source de soucis pour les hommes djihadistes, car l’initiative féminine ravive toujours dans leurs mémoires les conflits de la Jahiliya44. Olivier Roy évoque ainsi pour le djihad syrien une « modernisation paradoxale ».
Un Califat altermondialiste ?
« Contrairement à la « vieille » al-Qaïda, pyramidale, secrète, autoritaire, transnationale, Daesh se veut moderne, ouvert, enraciné et urbain »45
Ce qui saute aux yeux quand on se penche sur le Califat, ce sont la centralité de la religion, la violence outrancière et l’intolérance revendiquée. Le tout couplé à la visée totalitaire d’une harmonie sociale, à la recherche d’un équilibre interne46.
Pourtant, sortis de leur contexte, certains projets et pratiques du Califat renvoient un écho inattendu. Son programme comporte en effet la lutte contre la corruption et la spéculation financière (interdiction de l’usure), la création d’une monnaie alternative (pièces en or, argent et cuivre en référence aux dinars et dirhams abbassides, c’est-à-dire une « vraie » monnaie afin d’échapper au système monétaire dominant), la revalorisation des services publics, la décentralisation du pouvoir par l’autonomie régionale, le rejet de la démocratie parlementaire (et de la démocratie « tout court », l’EI prônant une sorte de « centralisme organique » sous domination divine), l’abolition des frontières, la lutte contre le racisme, sans oublier le rejet de la consommation effrénée et de la soumission aux marques.
Un discours qui semblerait altermondialiste s’il se référait au Monde Diplomatique et au Sous-Commandant Marcos, plutôt qu’au Coran et au Calife Ibrahim. Oui, l’EI se veut médiéval mais moderne, « égalitaire, universel et multiracial »47.
Les mots ont-ils ici encore un sens ? Ni plus ni moins qu’ailleurs. L’EI, en pratique ou en théorie, ne mène évidemment pas une critique du capitalisme, il cherche (et à travers lui une partie de la bourgeoisie locale) à modifier certains aspects qui lui semblent les moins licites, les plus gênants, à en adapter d’autres. Si certaines pratiques sont extrêmes, le discours résonne souvent fort creux. Et si l’on y découvre des rimes plus familières, mais ce n’est pas tant de « récupération » qu’il s’agit que de nivellement, vers le bas, ce qui n’a rien de nouveau : l’extrême droite dénonce elle aussi depuis longtemps les dérives et les excès du capitalisme. Capitalisme financier s’entend48. Source de tous les maux, d’autant qu’on y ajoute aisément des doses de conspirationnisme et d’antisémitisme. Rapports de classes, exploitation, plus-value et autres vieilleries passent donc à la trappe, le vocabulaire s’en trouve simplifié et tout le monde est d’accord. Mais l’EI, pour exister, doit centrer son discours sur le « sociétal ».
Face au mondialisme libéral d’inspiration occidentale qui domine la planète, l’EI oppose une alternative planétaire, un autre mondialisme qui revendique ouvertement la destruction des particularismes locaux, en premier lieu au sein de l’islam, où il combat les pratiques mystiques (soufisme) ou médico-magiques (maraboutisme).
Il est sur ce terrain en concurrence avec l’idéologie wahhabiste diffusée mondialement par la monarchie saoudienne. L’universalisme salafiste du Califat est toutefois différent, subversif, sinon de gauche, du moins populiste (il s’accorde assez bien à l’ancienne teinte socialiste des partis Baas) et il lui est facile de qualifier les Saoudiens d’apostats, de corrompus et d’alliés des Etats-Unis.
Pour dépasser son autre concurrent, la nébuleuse al-Qaïda aux promesses d’avenir radieux, l’EI bénéficie de la force d’attraction que représente la construction d’une « utopie » concrète sur le terrain. Car si les militants croient en un au-delà, ils souhaitent ne pas attendre demain pour édifier un monde meilleur, et préfèrent vivre dès aujourd’hui en accord avec leurs croyances. En bâtissant le Califat, ils prouvent la possibilité d’agir ici et maintenant pour changer le monde.
Quel changement ? Les promesses de lendemains enchantés ne faisant plus recette, le mot d’ordre du Califat est « Marche arrière toute ! » En État islamique comme en France, les nouveaux réactionnaires ne sont pas (que) des intellectuels, mais aussi des militants, dépolitisés au profit de valeurs, d’une éthique : born again salafistes, Manif pour Tous, défense de la famille, de traditions, d’un territoire, du sol, etc. Si l’irruption du capitalisme est la cause de tous les maux mais qu’il est devenu indépassable, que faire sinon revenir à « l’avant » et, dans ce cas, pourquoi pas le Moyen-Âge ? Celui d’un Âge d’or tant qu’à faire.
Pour ses militants, le Califat est la Dawla. Le terme est généralement traduit par État, mais il sous-entend aussi « l’idée de révolution, c’est-à-dire le bouleversement du monde vers la piété et la loi divine »49 . Révolution ou rétablissement d’un ordre ancien ? Dans la première partie, nous reprenions du Guépard la fameuse formule « Pour que tout reste comme avant, il faut que tout change » et ajoutions que le « comme avant » était d’importance. L’EI propose une identité pré-capitaliste, l’idéal de l’Arabie du VIIème siècle, un idéal de marchands et de guerriers, formule magique pour redonner du sens à la vie d’une jeunesse perdue et soumise aux valeurs de la modernité : individualisme, matérialisme, consommation et hédonisme50.
Pourtant, malgré son séparatisme et sa démesure, le discours califal, comme l’alternativisme plus raisonnable auquel nous sommes habitués, est un discours produit par le système dominant, et son projet une alternative au sein de ce qui existe. Le Califat ne peut survivre que relié économiquement au reste d’un monde capitaliste. Le goût des jihadistes pour les esclaves ne les conduit pas pour autant à instaurer ou restaurer un « mode de production esclavagiste », et le salariat règne à Mossoul autant qu’à Milan. Rêve éveillé et nouvelle phase du cauchemar, cette gigantesque ZAD réac autour du Tigre et de l’Euphrate ne peut être comprise et combattue que comme une variante monstrueuse d’un ordre capitaliste mondial dont elle se prétend l’ennemi.
Devant l’incertitude
« Pas de communisme dans l’islam »
Fatwa de l’Université al-Azhar, 1948.
Espoir pour certains, effroi pour beaucoup d’autres, l’EI n’est pas la Russie de 1919, et la partie est de toute façon mal engagée pour un Etat qui ne bénéficie pas de l’immensité ni de l’éloignement d’un territoire où construire son « utopie ». L’entrée relative de la Turquie au sein de la coalition internationale anti-Daech change la donne en perturbant ou bloquant des flux vitaux. Le temps s’écoulant particulièrement vite ces dernières années, le Califat ne pourra sans doute pas toucher à un quelconque pain blanc. Sauf surprise historique de taille, comme l’effondrement de l’armée syrienne, suivi d’une chute de Damas et de la déstabilisation du Liban, de la Jordanie ou de l’Arabie Saoudite51, la survie à moyen terme de cet État est peu probable.
L’EI a en effet tiré sa puissance, son prestige et ses finances de ses conquêtes guerrières. La stagnation des fronts, les replis tactiques et les incessants bombardements seront sa perte.
Après une longue période de containment les Occidentaux ont semble-t-il décidé de passer au rollback de l’EI. Leur stratégie avait jusque-là été prudente, rendre la vie quotidienne plus difficile pour la population locale : dès l’été 2014, parmi les premières cibles de l’USAF se trouvaient des centrales électriques, des moulins et des silos à grains. La multiplication de ces raids aériens depuis l’automne 2015 et l’avancée des troupes kurdes et chiites ont provoqué l’exode de populations à l’intérieur du territoire du Califat, son administration devant supporter des pertes de revenus et la gestion des réfugiés. Le matériel médical se fait rare (l’EI a demandé un bloc opératoire comme rançon pour un otage52), le ravitaillement se complique, les impôts augmentent et doivent être payés d’avance, etc.53 Les difficultés sur le front obligent les autorités à recourir dans certaines zones au service militaire ce qui provoque des défections de conscrits.
En fait, c’est le processus de normalisation et d’étatisation dont nous avons tenté l’esquisse dans la première partie qui est mis à mal. Le Califat va ainsi voir s’amoindrir les capacités « sociales » qui font sa force ; il ne pourra les compenser que par des augmentations d’impôts et une répression accrue, ce qui ne manquera pas de provoquer le retournement d’une partie de la population et de certains chefs de tribus. Les divergences d’intérêts risquent alors de resurgir (par exemple entre notables locaux et djihadistes étrangers).
La stratégie occidentale est peu délicate mais sans doute payante. A moins que, associée aux victimes civiles des bombardements et à l’avancée des troupes kurdes et chiites, elle n’ait l’effet inverse, et soude les habitants autour du Califat. Les chances qu’ils soient convaincus des bienfaits de la démocratie et de la laïcité sont par contre assez faibles. Comme celles d’un retour à une paix durable dans la région. Même condamné, le Califat mettra probablement du temps à mourir (et se poursuivra peut-être, sous des formes sans doute différentes, sur d’autres continents). Quant aux volontaires étrangers, ils ne semblent pas déradicalisés par le spectacle…
Projet utopique de construction d’un État sur des bases entièrement nouvelles, l’EI signifie moins une radicalisation de l’islam que l’islamisation d’une révolte, écho d’une confessionnalisation active un peu partout, de la droite conservatrice américaine aux banlieues françaises. Sa violence ne tient pas à un extrémisme propre à l’islam, mais au fait que le fanatisme religieux se déchaîne dans un contexte de guerre civile et d’interventions étrangères.
Il serait bien dommage, et dommageable, que la contestation sociale n’épouse dans les prochains temps les formes qu’esquisse aujourd’hui l’EI. Espérons que ce ne soit qu’un mauvais brouillon qui finisse à la corbeille. Chaque époque sécrète un type de contre-révolution qui lui est spécifique. Généralement celle-ci venait écraser et détourner la révolte des masses prolétariennes, à moins qu’elle n’exprime les limites même du mouvement. En ce début de XXIème il faut reconnaître que les formes contre-révolutionnaires sont dramatiquement préventives.
Qu’en sortira-t-il ? Des représailles, de nouveaux massacres, de nouveaux régimes autoritaires, de la haine, de la rancœur, et…
Sous prétexte que la fin de l’article approche, nous ne céderons pas à un optimisme de convenance qui nous imposerait de conclure, malgré tout, à l’inéluctabilité de la révolution. Quelques certitudes cependant. L’effondrement du Califat ne réglera aucune des causes qui ont favorisé son émergence et son succès. La solution ne s’esquissera pas seulement au Moyen Orient. Une période de guerre est abominable, d’autant plus si elle est civile et confessionnelle, et généralement peu favorable au prolétariat. Mais elle est aussi une période de grande incertitude qui ne masque parfois que très imparfaitement les rapports profonds structurant la société…
Tristan Leoni, décembre 2015
Quelques conseils bibliographiques :
1 / Sur l’État islamique (par ordre d’intérêt)
Pierre-Jean Luizard, Le Piège Daech. L’État islamique ou le retour de l’histoire, La Découverte, 2015, 192 p.
Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, L’État islamique. Anatomie du nouveau Califat, Bernard Giovanangeli Editeur, 2015, 192 p.
Philippe-Joseph Salazar, Paroles Armées. Comprendre et Combattre la Propagande Terroriste, Paris, Lemieux Editeur, 2015, 264 p.
Myriam Benraad, Irak, la revanche de l’histoire. De l’occupation étrangère à l’État islamique, Vendémiaire, 288 p.
2 / Sur la religion
Troploin, Le Présent d’une illusion, Lettre de Troploin, n° 7, juin 2006.
Maxime Rodinson, Mahomet, Seuil, 1994 [1961], 284 p.
Maxime Rodinson, Islam et capitalisme, Demopolis, 2014 [1966], 228 p.
Emmanuel Carrère, Le Royaume, POL, 2014, 640 p.
Gilbert Achcar, Marxisme, orientalisme, cosmopolitisme, Sinbad, Actes Sud, 2015, 256 p.
NOTES
1Derrière nos ordinateurs, nous préférerions qu’ils préfèrent le communisme ou tentent de le mettre en place.
2Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, L’État islamique. Anatomie du nouveau Califat, Bernard Giovanangeli Editeur, 2015, p. 100.
3Nous ne pensons pas que l’EI s’explique par des conspirations secrètes qu’il s’agirait de dévoiler pour résoudre la crise. De 2006 à 2015, plusieurs pays lui ont successivement apporté un soutien discret sous des formes très variées et souvent indirectes : offrir des millions de dollars, fermer les yeux sur tels trafics, concentrer la répression sur d’autres groupes, etc. Soutenir les ennemis de ses ennemis et entretenir chez eux la division sont des classiques (l’appui d’Israël au jeune Hamas ne suffit pas à expliquer le succès qu’à connu ce parti). Mais le modeste mouvement de guérilla des débuts, parfois utile, est devenu un proto-état autonome aux ambitions démesurées.
4Relisez la citation de Maxime Rodinson en exergue de la première partie.
5Les forces en présence semblent se battre pour contrôler, intactes, les installations essentielles (puits de pétrole, raffineries, barrage de Mossoul). Les Occidentaux se refusent jusqu’ici à bombarder les puits de pétrole de l’EI, et ont attendu l’automne 2015 pour s’attaquer aux camions-citernes civils.
6Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, op. cit., p. 101.
7Pierre-Jean Luizard, op. cit., p. 26.
8Au contraire des organisations kurdes qui déclarent reconnaître les frontières internationales et se sont appliquées en particulier à matérialiser celle séparant les Kurdistan syrien et irakien.
9Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, op. cit., p. 178.
10Dans ces pays, contrairement à la Tunisie ou l’Égypte, et pour diverses raisons, l’armée a décidé de ne pas lâcher le dictateur en place (Bachar al-Assad et Nouri al-Maliki).
11Nous ne parlons pas ici de l’auto-défense qu’ont pu mettre en œuvre des manifestants ou des villageois.
12Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, op. cit., p. 25-26.
13Valérie Clerc, « L’habitat des pauvres à Damas : de la crise du logement vide à la recrudescence des quartiers informels », Les Carnets de l’Ifpo, octobre 2012.
14Frantz Glasman, « Deïr ez-Zor, à l’est de la Syrie. Des islamistes, des tribus et du pétrole… », 8 décembre 2013, http://syrie.blog.lemonde.fr
15Pierre-Jean Luizard, op. cit., p. 35. L’expérience du Rojava s’inscrit dans un autre cadre. Suite à un accord, les troupes du PKK ont remplacé les troupes de Damas qui se sont partiellement retirées de cette zone. Tout vide institutionnel a donc été évité et le processus insurrectionnel a pris fin. Le PKK a ensuite instauré son programme communaliste « libertaire ».
Quant au « Printemps arabe », contrairement au pragmatisme d’al-Qaida et d’al- Nosra qui y voyaient une évolution susceptible à terme de leur être favorable, ce qui n’était encore que l’Etat islamique d’Irak l’avait dénoncé comme anti-islamiste. Abdel Bari Atwan, Islamic State. The Digital Caliphate, Saqi, 2015, pp. 69-71.
16Sur cette partie, lire en particulier Philippe-Joseph Salazar, Paroles Armées, Paris, Lemieux Editeur, 2015.
17Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, op. cit., p. 6.
18Jean-Pierre Filiu, L’Apocalypse dans l’islam, Fayard, 2008, p. 289.
19A noter toutefois que, pour l’instant, s’il dispose d’une Rolex, il n’a pas d’iPhone, ne vit pas dans un palais mais se cache des drones, ne roule pas en limousine mais en pick-up Toyota.
20Jean-Pierre Filiu, op.cit., p. 288.
21Selon le Coran et les hadiths c’est au Sham (la Syrie) qu’auront lieu les batailles cruciales de la fin des temps entre les musulmans et les armées romaines (les Byzantins ou l’OTAN selon les interprétations), Satan et consort.
22Philippe-Joseph Salazar, op. cit., p. 216.
23D’autres groupes islamistes armés, en particulier le Front Al-Nostra, reçoivent des volontaires étrangers mais en nombre plus réduit.
24La « déradicalisation » dont on parle beaucoup et qui ne s’applique pour l’instant qu’aux volontaires, a pour origine des projets européens expérimentaux destinés à « soigner » les néo-nazis. Pour les spécialistes actuels, le problème de la « radicalisation », processus qui aboutit à une action violente, peut aussi bien toucher les militants d’extrême, droite ou d’extrême gauche, les islamistes ou les défenseurs des animaux. Farhad Khosrokhavar, Radicalisation, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2014.
25Selon une étude des vidéos de propagande de l’EI, 52 % des images faisaient référence au « monde utopique » du Califat, 37 % à la guerre, et 2 % mettaient en scène des violences atroces. Cf. David Thomson, Le Secret des sources, France Culture, 12 décembre 2015.
26David Thomson, Les Français jihadistes, Les Arènes, 2014.
27Farhad Khosrokhavar, « Qui sont les jihadistes français ? », 20 novembre 2015 http://www.scienceshumaines.com
28Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, op. cit., p. 150. Vu les forces en présence, on peut en conclure qu’il y avait au moins autant de kurdes dans les rangs de l’EI que dans ceux des YPG.
29Philippe-Joseph Salazar, op. cit., p. 212, 222.
30Laurent Bonelli, « Brigadistes, djihadistes », Le Monde Diplomatique, août 2015.
31Géraldine Casutt, « Pourquoi les jeunes filles rejoignent les rangs de l’État islamique », madame.lefigaro.fr, 14 décembre 2015.
32Fatima Mernissi, Sexe idéologie islam, Tierce, 1983, p. 31, 83-84, 88.
33Zahra Ali, Féminismes islamiques, La Fabrique, 2012, p. 61.
34Paradoxe ? Au nom de la classe ouvrière, le PCF brisait des grèves et trouvait des ouvriers pour le soutenir.
35Philippe-Joseph Salazar, op. cit. p. 142.
36Brigade Al-Khansaa, Women of the Islamic State, A manifesto on women, 2015 (publication de militantes de l’EI). http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/women-of-the-islamic-state3.pdf
37Interview de Géraldine Casutt, Le Nouvel Observateur, 9 avril 2015.
38Ibid.
39Farhad Khosrokhavar, « Qui sont les jihadistes français ? », op. cit.
40La rumeur d’un « djihad du sexe » pour le « repos du guerrier » qui a longtemps circulé est une invention.
41Précisons qu’Alain Soral, pour qui l’EI est un pantin aux ordres du Mossad, est dénoncé dans Dar-al-Islam n°7 comme un « complotiste mécréant » pro-iranien.
42Brigade Al-Khansaa, op. cit.
43Hélène Février, Sylvie Braibant, « Les sirènes pseudo-féministes du djihadisme », http://information.tv5monde.com, 20 novembre 2015.
44Fatima Mernissi, op. cit., 1983, p. 88.
45Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, op. cit., p. 114.
46Pour une camarade un tantinet provocatrice, cette « recherche d’une pureté du vivre ensemble » fait écho à un formalisme que l’on peut trouver en milieu militant. En codifiant prises de parole, vocabulaire, comportements, il s’agit à tout prix d’éviter le conflit, la fitna.
47Olivier Hanne, « Le rêve d’Etat du djihadisme », Diplomatie, n° 77, novembre-décembre 2015, p. 44.
48De la même manière, si une frange de l’extrême droite est attirée par la lutte des ZAD, c’est qu’elle y décèle une orientation politique et rhétorique qui est la sienne : écologie, territoire, paysannerie, etc.
49Olivier Hanne, « Le rêve d’Etat du djihadisme », Diplomatie, n° 77, novembre-décembre 2015, p. 44.
50La critique de la modernité n’est pas celle de la technologie. Sur ce point l’EI reconnaît l’avance de l’Occident mais l’explique par le pillage des connaissances arabo-musulmanes par les Européens depuis le Moyen-Âge.
51Ou IIIème Guerre mondiale imprévue opposant OTAN et Russie et confirmant l’eschatologie califale.
52Luc Mathieu, « A Raqqa, l’ambiance s’est tendue, la paranoïa grandit », Libération, 16 septembre 2015.
53« Finances de l’EI : la guerre secrète », Le Monde, 29-30 novembre 2015.
Source: DDT21, 29 décembre 2015
Attachments
Comments
Ce texte fait suite et prolonge 'Califat & Barbarie', texte publié sur le blog DDT21 en deux épisodes en novembre et décembre 2015, considérant cette fois moins le l’État islamique lui-même que le sort de ses voisins immédiats, rebelles syriens, forces kurdes ou habitants cherchant à fuir cette zone de chaos.
«Serons-nous vaincus, et vous victorieux, si vous prenez Mossoul, Raqqa ou Syrte ? Bien sûr que non. La défaite, c’est de perdre le goût du combat »
Abou Mohammed al-Adnani,
porte-parole de l’EI, mai 2016
« Il me faudrait des prolétaires de location,
mais je ne sais pas où les trouver »
Nikolaï Erdman, 1925
L’État islamique (EI) reculant sur tous les fronts et Raqqa, sa capitale politique, semblant sur le point de tomber aux mains des forces armées réunies de la liberté, de la démocratie, de la laïcité et peut-être même du féminisme. C’était fin 2015, mais huit mois plus tard c’est toujours le cas. Mais si le Califat n’en finit pas de mourir, la situation a évolué et une page se tourne.
1 / Si vis pacem…
La question a toujours été celle de la volonté. Celle des pays impliqués dans la crise irako-syrienne d’en finir ou pas avec l’EI. C’est aujourd’hui le cas, on est passé d’une politique de containment à celle du roll-back. Chacun a trouvé de bonnes raisons pour faire de l’EI l’ennemi principal : mettre un terme à des agissements devenant trop gênants ; nécessité politique de réagir à des attentats (Liban, Sinaï, France)1 ; ne pas laisser le champ libre aux autres puissances, etc. Le sort des populations locales, on l’aura compris importe ici assez peu.
Bachar El Assad espère profiter de l’aubaine. Son armée, l’Armée arabe syrienne (AAS), a repris l’offensive et le contrôle de la plus grande partie de la Syrie « utile ». Elle bénéficie du soutien de diverses milices confessionnelles et politiques, du Hezbollah libanais et surtout de l’appui massif et direct de la Russie. Autre allié de poids, l’Iran qui a fait un retour officiel dans le concert des nations en tant que puissance régionale après la levée des sanctions en janvier 2016 (suite à l’accord de juillet 2015 sur son programme nucléaire).
Bien que menant surtout une guerre par proxy via les YPG et les milices chiites, les États-Unis s’impliquent toujours davantage en termes de troupes au sol en Irak comme en Syrie. Un déploiement qui n’est pas toujours apprécié par les populations locales.
Les pays qui avaient un temps essayé d’instrumentaliser l’EI (Turquie et pays du Golfe) ont depuis longtemps misé sur d’autres groupes et l’opposition syrienne, ne l’oublions pas, a été priée de ne plus exiger le départ d’Assad comme préalable à des négociations.
C’est que le temps d’une résolution politique, diplomatique et militaire de la crise syro-irakienne se profile. Mais l’objectif commun, en finir avec le Califat, ne fait pas une stratégie, encore moins un projet pour l’après-guerre. Ici les intérêts diffèrent ou s’opposent, et régler un problème risque d’en faire émerger d’autres. Déjà, sur le terrain, une fois l’EI expulsé, les tensions entre représentants autoproclamés de communautés sont sensibles. Quant aux exactions à l’encontre des populations arabes sunnites elles passeraient presque pour secondaires dans ce chaos si elles n’auguraient pas de tristes lendemains. Il ne manquera par conséquent pas de braises sous les cendres.
L’Irak se dirige vers un retour au statu quo ante, c’est-à-dire la domination politico-militaire chiite et kurde sur le pays et l’humiliation des populations sunnites.
En Syrie c’est un round final de négociations qui se dessine avec peut-être à terme un complet cessez-le-feu, un gouvernement d’union nationale et, dans quelques années, après des élections, Assad prenant sa retraite en Russie. Chacun met donc les bouchées doubles pour arriver en force à cette table où le pays sera découpé en zones d’influences. On cherche en particulier à rendre géographiquement cohérentes les zones contrôlées, à faire que situation militaire et projets politiques s’ajustent enfin. Par exemple en créant une région autonome sous influence turque dans le nord du pays, d’où les affrontements pour le contrôle d’Alep qui pourrait en être la capitale. La carte des combats, jusqu’ici en peau de léopard, tend à se simplifier.
La trêve entre régime et rebelles, entrée en vigueur en février 2016 dans certaines régions, est en partie respectée et permet aux troupes loyalistes de se concentrer contre l’EI et les islamistes les plus radicaux comme Al-Nosra (la branche syrienne d’Al Qaïda). En position de force, le régime a relancé un processus de « réconciliation » passant par la signature d’accords locaux avec de petites zones rebelles encerclées depuis des mois voire des années et à bout de souffle : cessez-le-feu, dépôt des armes, puis amnistie des rebelles. Un retour à la normale baasiste supervisée par l’ONU et la Russie.
Il est sans doute temps de choisir, une dernière fois, le bon camp : d’où les ruptures d’alliances, retournements et changements d’étiquettes, de noms et de drapeaux pour de nombreux groupes armées. Car en Syrie c’est à une curée chaotique que se livrent les parties prenantes sur la dépouille en peau de chagrin du Califat.
2 / Trouble dans le Califat
Fidèles à leur réputation : les Russes bombardent avec tant de brutalité (sic) qu’on en vient à croire qu’ils ne visent qu’hôpitaux et boulangeries ; les Occidentaux ne sont que prudence, précision et délicatesse2. Depuis plusieurs mois, c’est donc sous les bombes des aviations américaines et russes, que les troupes de l’EI affrontent une bien étrange coalition : l’AAS (et ses alliés), les YPG-FDS, Al-Nosra (et d’autres groupes islamistes), l’armée irakienne (en reconstruction), diverses milices chiites et des forces spéciales de 10 ou 15 pays différents ! La partie étant militairement perdue, le Califat a choisi de la faire durer. Il a abandonné les zones rurales faiblement peuplées et s’est replié là où résister est plus aisé (massifs montagneux) ou réellement stratégique, certaines villes dont il fait chèrement payer la prise. A ce jour, ses capacités militaires lui permettent encore de mener des contre-offensives là où on ne l’attend pas, et d’intensifier ses opérations de type terroriste.
En Irak, la reprise des villes sunnites suit toujours un même schéma : bombardements, encerclement, siège en règle (quitte à affamer la population)3, tentative de retourner les tribus contre l’EI, assaut prudent avec emploi massif de forces spéciales (armée, police) et de milices chiites et, enfin, vaste opération policière. Ramadi est ainsi prise en février 2016 après deux mois de combat de rue, Fallujah en juin au bout d’un mois. Le schéma est difficilement applicable à Mossoul, ville de plus de deux millions d’habitants, qui a accueilli les troupes de l’EI en libérateurs il y a deux ans. Plutôt que de livrer leur cité (et leur commerce) à la destruction, il est probable que les édiles et chefs tribaux, tout comme ils l’ont fait en 2014 avec les militaires chiites, demanderont aux soldats de l’EI de se retirer… et qu’ils refuseront, n’ayant plus guère d’endroit où se replier.
Un État ne peut pas tenir uniquement par la répression. Comme nous l’avons écrit, si l’EI a réussi à obtenir l’adhésion d’une partie de la population, des chefs de tribus et notables locaux c’est en apportant la sécurité et l’ordre nécessaires à la reprise d’une activité économique, et en améliorant le ravitaillement4. Les bombardements visent donc à détruire ses capacités économiques et gestionnaires (infrastructures logistiques, centrales électriques, etc.), le coupant progressivement d’une partie de son soutien populaire et contribuant à accélérer sa chute. De ce point de vue la structure étatique de l’EI est sans doute aujourd’hui en complète déliquescence. « L’ « État » Islamique a perdu du terrain en Syrie et en Irak et donc contrôle moins de populations. L’ « impôt » prélevé rentre moins bien puisqu’il a moins de « contribuables ». Quant aux sommes colossales saisies dans des établissements financiers lors des différentes conquêtes, particulièrement en Irak, c’est un peu comme les héritages, ils s’épuisent petit à petit. Il faut dire que gérer un « État », ça coûte cher. »5 Les salaires des fonctionnaires et les allocations ont été réduits, les taxes augmentées. Le temps d’une « économie » de guerre de prédation est revenu. Coupé du reste du monde, l’EI doit gérer en interne les flux de réfugiés fuyant combats, bombardements et pénurie alimentaire tout en ravitaillant prioritairement ses combattants. L’instauration de la conscription dans certains secteurs contribue également à la désaffection de la population alors que les exécutions de déserteurs (y compris de volontaires étrangers) se multiplient.
Le Califat est né et a prospéré sur l’effondrement de deux États mais aujourd’hui c’est lui, en tant qu’entité étatique implantée à cheval sur la frontière syro-irakienne, qui est en train de disparaître. Son attrait principal, la puissance, ayant disparu, restera la légende : celle qu’il s’est évertué à forger par sa propagande et son discours eschatologique (confirmé par la création d’une coalition planétaire contre lui). Restera aussi, pour ceux qui y avaient cru ou avaient bénéficié de ce régime, notamment chez les sunnites irakiens, une rancœur que l’EI continuera d’exploiter, même réduit à un réseau de guérilla local et international6.
Cherchant à comprendre comment fonctionnait le Califat, comment y vivaient au quotidien 8 à 10 millions d’habitants, nous n’avions pas évoqué jusqu’ici les wilayas (gouvernorat) « extérieures » de Libye, du Yémen, d’Égypte ou d’Afghanistan. Des unités militaires ayant fait allégeance à l’EI y contrôlent plus ou moins quelques zones ou localités sur le mode traditionnel de la guérilla, mais ne sont pas en mesure d’y instaurer une administration stable.
Exception notable, la Libye avec la tentative d’y transposer le modèle social de l’EI. En octobre 2014, après trois ans de guerre civile, un groupe implanté autour de Syrte, l’ancien fief du clan Kadhafi, fait allégeance au Calife Al-Baghdadi. Profitant de la marginalisation que subit la ville suite à la « révolution », il noue des alliances avec diverses tribus locales et milices armées et, progressivement, étend son contrôle sur une bande côtière de 200 km ainsi que, brièvement, sur la ville de Derna en Cyrénaïque. Un tribunal islamique et une police des mœurs y sont instaurés ainsi que les strictes règles de vie qui prévalent à Raqqa. Mais la fuite d’une grande partie des 120 000 habitants a complètement désorganisée la vie quotidienne. La route de la Syrie devenant de plus en plus difficile, la ville voit par contre affluer des milliers de combattants étrangers dont beaucoup de Tunisiens. Le discours antiraciste de l’EI est néanmoins à la peine car les djihadistes subsahariens (Somaliens, Sénégalais, Soudanais, etc.), très nombreux, sont mal acceptés par la population locale.
Les pays occidentaux ne souhaitant pas que se renouvelle l’expérience étatique califale en Afrique du Nord et qu’elle se propage à la Tunisie ou l’Algérie, une nouvelle intervention militaire internationale avait été envisagée. Elle aurait permis au passage de (tenter de) régler des questions préexistantes à l’implantation de l’EI comme celle de la régulation des flux de migrants (des négociations étaient en cours depuis 2008 avec Kadhafi à ce sujet) ou de l’exploitation pétrolière. Mais la solution trouvée, moins coûteuse et plus simple car ne nécessitant pas de réelle stratégie à long terme, a été d’appuyer, avec forces spéciales et bombardements, les milices islamistes locales ennemies de l’EI. A l’heure où nous écrivons ces lignes, et après deux mois de combats, les derniers défenseurs de Syrte se battent encore, bien que sans espoir, dans quelques quartiers du centre-ville. D’autres continueront probablement à lutter au nom du Califat plus au sud, dans le désert.
3 / « Rojava » ?
La Syrie comprenait avant guerre plusieurs zones discontinues de peuplement kurde le long de la frontière turque : Jazira, Kobane et Afrin, trois « cantons » d’un territoire nommé par certains « Rojava », « l’ouest » en kurde, « Kurdistan occidental » par extension. La population kurde était alors évaluée entre 1,5 et 3 millions de personnes, mais beaucoup d’entre elles, peut-être même la majorité, vivaient à Alep et Damas. Une population discriminée par les Assad mais que l’alliance entre le régime syrien et le PKK (de 1979 à 1998 afin de déstabiliser la Turquie) permettait de maintenir dans le calme. Il faudra attendre 2003 pour que le PKK créé une branche syrienne, le PYD, sans grande implantation. La zone connaîtra en 2004 une importante révolte populaire contre les discriminations.
En 2011 les manifestations hostiles au régime y sont massives, et les considérations communautaires sont, contrairement à 2004, reléguées au second plan. Jouant la carte de la communautarisation le régime accorde en avril la nationalité syrienne à 150 000 Kurdes qui en étaient privés depuis 1962 et libère des militants du PYD emprisonnés. Le parti fait alors son apparition dans le nord de la Syrie, avec notamment le retour d’exil de son dirigeant Salih Muslim Muhammad gracié par Damas7. En juillet, le régime retire militaires et policiers des trois cantons et les redéploie dans le reste du pays où ils participent à la répression. Le parti kurde prend alors possession, sans violence, des localités et bâtiments abandonnées. Dans ces zones, la contestation anti-Assad et pro-démocratique prend aussitôt fin8 et le PYD commence l’application de son programme, le « confédéralisme démocratique »9.
Trois ans plus tard, grâce à la médiatique bataille de Kobane, une partie de l’extrême gauche et des anarchistes français découvre le Rojava. Selon une logique militante déjà vue (Algérie, Nicaragua ou Chiapas), ils y détectent une réelle ou potentielle révolution et se lancent dans un soutien exalté. Ce processus n’est pourtant que la version postmoderne d’un banal mouvement de libération nationale, avec ses inévitables tares, mais visant ici à l’instauration d’une démocratie de type occidental mâtinée de participation citoyenne. Le PYD ne s’y trompe pas et cherche plutôt un soutien social-démocrate (PS, PC ou EELV pour la France). Une de ses particularités aura été de jouer sur la fibre féministe des Occidentaux en mettant systématiquement en avant, pour les journalistes, des femmes combattantes (qui, un œil attentif le remarquera, sont en réalité très rares en première ligne).
Nous ne reviendrons pas ici sur le caractère bien peu libertaire de ce parti et du régime du Rojava, ni sur ce prétendu processus révolutionnaire, les critiques ont été nombreuses10. La mode du Rojava est retombée mais a fait des dégâts en milieu militant11. Il est par exemple malaisé de dénoncer aujourd’hui l’impérialisme américain alors que l’on réclamait hier le soutien de l’OTAN aux YPG… Actuellement, mis à part un projet d’usine de compost bio, les infos provenant du Rojava sont surtout d’ordre militaire ou policier, et si quelques dizaines de maoïstes européens se battent encore dans les rangs des YPG, ils le font aux côtés de centaines de soldats américains des forces spéciales.
Le PYD a savamment profité du conflit syrien pour réaliser ses propres objectifs : réunir les trois cantons jusque-là séparés par des zones de peuplement arabe (parfois sciemment « arabisées » dans les années 1970) ou turkmène. Cela a permis au parti de devenir le partenaire incontournable des puissances impliquées dans le conflit car son projet s’accorde avec leur volonté d’en finir avec le Califat. Après le soutien de Washington, il a trouvé celui de Moscou où il a d’ailleurs ouvert ses premiers bureaux « diplomatiques » (puis à Prague, Berlin, Paris, etc.). Les YPG, qui comptent selon les estimations entre 5 000 et 50 000 combattants ( ! ), sont devenus les fameuses « troupes au sol » qu’aucun pays ne voulait déployer.
Pour convaincre le PYD de participer à la prise de la capitale de l’EI, les États-Unis ont dû promettre d’aider (militairement et diplomatiquement) à la réunification des trois cantons. Un accord a été conclu en octobre 2015 avec la création d’une nouvelle coalition militaire arabo-kurde, les Forces démocratiques syriennes (FDS), au sein desquelles les YPG représentent 75 à 80 % des combattants. Il est en effet plus seyant de soutenir une telle coalition que le parti frère du PKK classé « terroriste » par la « communauté internationale ». La participation de supplétifs arabes et syriaques est d’ailleurs une nécessité pour s’emparer de zone non-kurdes et surtout de Raqqa, dont les 300 000 habitants ne voient pas forcément d’un bon œil l’arrivée de troupes kurdes. Début 2016, l’opération devient urgente car plus au sud c’est l’AAS qui se rapproche de la ville. Les États-Unis ont donc déployé 500 hommes qui participent aux combats aux côtés des YPG-FDS. Vu le poids économique et symbolique de la ville, il n’est pas indifférent qu’elle tombe aux mains de pro-Russes ou des pro-Américains.
A l’ouest, en février 2016, les YPG participent à l’offensive lancée par l’AAS et le Hezbollah au nord d’Alep contre plusieurs groupes « rebelles » dont Al-Nosrah afin de couper le stratégique corridor d’Azaz. L’opération est menée avec le soutien de l’aviation russe et l’aval des États-Unis12. Plus au sud, où le prétexte d’unifier les cantons ne peut être invoqué, les YPG aident à plusieurs reprises les troupes d’Assad à parachever l’encerclement des quartiers « rebelles » d’Alep où vivent encore 200 000 habitants.
La collaboration entre les YPG et l’AAS n’est pas surprenante car la relation ambiguë entre l’administration de Damas et celle du Rojava remonte on l’a vu à 2011. Certains membres de l’opposition syrienne extérieure, y compris d’autres organisations kurdes, considérent même tout bonnement le PYD comme un représentant du régime d’Assad. Ce qui caractérise le rapport YPG/AAS depuis le début de la guerre c’est avant tout une coexistence pacifique profitable à leurs agendas respectifs. Mais tout comme l’alliance passée entre Afez el Assad et le PKK, celle entre Bachar el Assad et le PYD reste de circonstance et pourrait être brutalement rompue (d’autant qu’une partie des groupes rebelles sunnites qui ont rallié les FDS sont opposés à Assad). On le voit bien à Hasakeh et Qamishli, deux enclaves loyalistes au cœur du Rojava où checkpoints et combattants des deux camps se côtoient et où, depuis 2011 plusieurs accrochages ont eu lieu13. Les YPG auraient les moyens de s’en emparer mais la présence du régime sert leurs intérêts, l’aéroport de Qamishli assurant par exemple une liaison aérienne régulière entre le Rojava et le reste de la Syrie, permettant ainsi aux classes moyennes de la région (Kurdes et Arabes) de se rendre à Damas puis en zone loyaliste pour affaires, études, soins médicaux ou autres14. La conquête de ces deux villes par les YPG n’aura donc lieu qu’à la toute fin du conflit.
On ne sait plus trop aujourd’hui s’il faut encore parler du « Rojava » puisque à l’administration des trois cantons par le le PYD, a succédé en mars une simple « Région du Nord de la Syrie » autonome, aux contours flous et extensibles. Il s’agit d’apaiser les populations arabes ou chrétiennes pour qui l’hégémonie du PYD devient irritante (certaines localités arabes, comme Tell Abyad, ayant mal supporté leur rattachement à l’administration du canton de Kobane)15. Ce qui se profile c’est la création d’une région (de fait) autonome dans le nord de la Syrie, le long de la frontière turque, politiquement dominée par le PYD mais sous la protection militaire des États-Unis. Ces derniers ont sans doute promis à leur allié turc que cette région ne porterait pas le nom de… « Kurdistan ».
4 / Classes en ruine
Et les prolétaires dans tout ça ? Nous en parlons en fait depuis le début, mais sous la forme de chair à canon. Il est vrai que, si l’on ne se trouve pas déjà engagé de force dans un camp, choisir le métier des armes est dans certaines régions une chance de survie économique. « Tous les métiers disparaissant, il ne restait plus de choix aux jeunes hommes que de s’engager comme combattants »16. Et une chance de survie « tout court » dans ces guerres où les civils paient un plus lourd tribut que les soldats. « C’est vrai. Dans les guerres, le problème, c’est le civil. Si vous voulez rester vivant, mieux vaut prendre les armes » (Gérard Chaliand).
Une économie en lambeaux
Il faut d’abord se rendre compte que l’économie du pays est ravagée, comme les villes et les zones industrielles et agricoles. Entre mars 2011 et fin 2015 la guerre aurait coûté à l’État syrien près de 250 milliards de dollars (perte de production économique, destruction ou endommagement de capital, dépenses militaires extra-budgétaires)17. Son PIB s’est contracté de 55 % entre 2010 et 2015. Les revenus des droits de douane et des impôts ont fondu, ceux liés au secteur pétrolier diminuant de 95 %. Le produit intérieur brut agricole a baissé de 60 % et les surfaces cultivables ont été réduites de 6 millions à 3,6 millions d’hectares, provoquant une hausse considérable des prix des produits agricoles pourtant subventionnés. En fait il n’y a plus de marché national, seulement plusieurs régions économiques aux échanges limités.
Avant-guerre, l’UE était le principal partenaire commercial du pays, mais les sanctions économiques qu’elle a infligées à la Syrie ont tout changé. Entre 2012 et 2013, les importations en provenance de Syrie vers l’UE ont chuté de 53 % et les exportations européennes vers la Syrie de 36 %. Globalement, les exportations et les importations ont respectivement diminué de 89 et 60 % entre 2011 et 2014. C’est la Chine qui est devenue le premier fournisseur de biens à la Syrie, suivie par la Turquie et la Fédération de Russie.
La part des salaires dans le revenu des Syriens est en baisse à cause de la fermeture de nombreuses entreprises : dès 2011, si des patrons ont délocalisé leurs usines vers des zones plus sûres (sur la côte) d’autres se sont installés à l’étranger (Égypte, Turquie, Liban). Dans certaines régions tenues par les rebelles, des usines entières ont été démontées, vendues au marché noir puis remontées en Turquie. « Sur les 40 000 usines et ateliers qui fonctionnaient dans la province d’Alep, qui inclut à la fois la ville et ses environs, seules 4 000, soit 10 %, continuent de fonctionner. Environ 28 000 ont été partiellement ou entièrement détruites, alors qu’environ 8 000 autres usines ont été délocalisées en Turquie ou sur le littoral syrien, ou ont simplement arrêté de fonctionner »18
Si la plupart des grands complexes industriels tels que raffineries, centrales électriques ou cimenteries semblent intacts, l’économie a perdu entre 2,1 et 2,7 millions d’emplois. Les salaires des fonctionnaires sont aujourd’hui la principale ressource pour les Syriens (y compris dans certaines zones rebelles).
Le taux de chômage était en 2015 de 55 %, celui des jeunes de 78 % (contre respectivement 12 et 30 % en 2011). Aujourd’hui 83,4 % des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté (contre 28 % en 2010). Dans ce pays dévasté, la misère n’est compensée que par des petits boulots, l’établissement comme travailleurs indépendants, la débrouille, l’emprunt, la vente d’objets divers, etc. Beaucoup doivent leur survie à l’aide humanitaire, comme dans les quartiers loyalistes et autrefois « bourgeois » d’Alep de près d’un million d’habitants19.
Dans cette ville, 52 % des logements sont désormais inutilisables (principalement dans les quartiers informels). Une grande majorité de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, voire au sein de leur ville, doivent s’installer chez des particuliers en collocation ou chez des proches, occuper des immeubles inachevés ou endommagés ou squatter des appartements vides. A Lattaquié, ville sûre, 82 % des réfugiés sont locataires, souvent en collocation du fait de la hausse des loyers.
En zones « libérées »
En référence à la « Révolution » avortée du printemps 2011, les opposants à Assad sont encore parfois appelés « révolutionnaires ». Certains utilisent le même adjectif pour qualifier le processus d’auto-organisation mis en place dans les zones dites « libérées » ou « semi-libérées », c’est-à-dire non contrôlées par l’AAS, l’EI ou les YPG.
Dans les régions d’où les troupes loyalistes ont dû se retirer, la survie quotidienne est prise en charge à partir de l’été 2012 par la population elle-même. Les nombreux partis politiques de l’opposition syrienne à l’étranger, tout comme les syndicats, étaient inexistants dans le pays et n’ont pu encadrer le mouvement. Spontanément ou à l’initiative des réseaux de solidarité et de résistance constitués au printemps 2011, se forme une multitude d’associations, comités « populaires », « locaux » ou « de quartier », conseils locaux (regroupant des comités) ou municipaux (élus) qui vont assurer le fonctionnement des services publics vitaux ou gérer le ravitaillement. C’est ce que l’on va appeler les « institutions civiles », une auto-organisation qui, avec le temps, se transformera en auto-administration20. Le fait que des comités aient eu un fonctionnement non hiérarchique basé sur l’entraide explique que certains aient pu y voir une influence libertaire21. Mais, heureusement, les anarchistes ne sont pas les seuls à s’organiser lorsqu’il s’agit de survivre.
Dans l’attente du retour d’une autorité, les administrateurs rebelles cherchent en fait à accomplir les tâches que l’État, absent de ces zones, ne peut effectuer. Les plus compétents pour remettre en route les services publics étant les anciens fonctionnaires, ils sont évidemment mis à contribution, y compris parfois les policiers. C’est d’autant plus pratique que Damas continue souvent à verser leurs salaires.
« Il faut d’abord faire régner l’ordre et reconstituer, parfois en s’appuyant sur des agents expérimentés naguère en fonction, les services de police. Il faut réorganiser les tribunaux et recommencer à rendre la Justice. Il faut tenir à jour l’état-civil et fournir aux habitants les documents officiels dont ils ont besoin. Il faut permettre aux banques de fonctionner en toute sécurité. Il faut approvisionner les marchés malgré le blocus et les pénuries de carburant. Il faut faire fonctionner les boulangeries. Il faut organiser des centres de soin clandestins pour prévenir leur destruction par l’aviation du régime. Il faut apporter des secours aux familles nécessiteuses et aux parents de détenus. Il faut fournir abri et provisions aux réfugiés jetés sur les routes par la destruction de leurs maisons. Il faut collecter les ordures, entretenir la voirie, réparer les bâtiments indispensables. Il faut relancer les écoles. Etc., etc. »22
Les premières institutions remises sur pied sont donc fréquemment la police et la justice23. La création d’une police doit permettre d’assurer « la sécurité » en ces temps où des hommes en armes sont omniprésents. Réalité ou fantasme, il est significatif que circule la rumeur de la libération par Assad de milliers de prisonniers de droit commun au début du soulèvement. Une police efficace permet aussi d’éloigner hors de la ville les groupes armés encombrants qui, spontanément, veulent jouer ce rôle24.
En ce qui concerne les tribunaux l’enjeu est aussi politique pour la rébellion qui, combattant une dictature, se doit de rendre la justice justement. Mais comment faire, en particulier lorsque les magistrats ont fui, et sur quel droit s’appuyer ? Ce sont les cheikhs, les avocats et les étudiants en Droit qui sont au début mis à contribution. Si parfois on continue à appliquer le Droit civil syrien, et que d’autres optent pour le code de l’Union arabe (un droit civil et pénal basé sur la charia créé en 1996 par la Ligue arabe) c’est le plus souvent la Charia qui garde sa légitimité auprès de la population, surtout dans les campagnes25.
Le maintien de l’ordre social existant (propriété privée, argent, salariat, etc.) et le rôle des classes moyennes rendent ce type de structures indispensable d’où, face au chaos, la nécessaire recherche d’une autorité, c’est-à-dire d’un monopole de la violence.
« Libéré » ne signifie pas forcément « démocratique », d’autant que l’organisation d’élections s’avère difficile. Le contrôle de ces institutions est un enjeu de pouvoir. Désignés, nommés ou élus, on retrouve ainsi aux manettes des multiples conseils beaucoup de personnalités issues du mouvement de 2011 (des classes moyennes), mais aussi des notables locaux, des représentants des structures claniques ou de groupes militaires locaux.
Dès l’automne 2012, l’opposition extérieure lance un processus d’intégration et de centralisation des institutions civiles et organise en Turquie des réunions de « grands électeurs ». De nombreux comités choisissent d’y adhérer afin de bénéficier du réseau de redistribution de l’aide humanitaire et financière internationale dont ils ont absolument besoin, les ressources locales étant taries par impossibilité de percevoir taxes et impôts.
Cependant, la priorité des financeurs allant toujours aux combattants, ces institutions vont devoir cohabiter avec de multiples groupes armés. Le monopole de la violence est en effet celui qui permet tous les autres.
Militarisation de la révolte
Au printemps 2011, Assad fait rapidement appel à l’armée, qui en tant que corps lui reste fidèle26, pour mener une violente répression. De modestes groupes armés d’autodéfense se constituent alors afin d’escorter les cortèges de manifestants. Mais avec l’afflux de déserteurs et l’abandon de certains territoires par le régime (notamment les zones rurales les plus pauvres faute de troupes disponibles), des groupes armés autonomes se constituent durant l’été à partir d’initiatives locales. Les combats se généralisent à la fin de l’année car ces groupes, qui se perçoivent comme la préfiguration d’une nouvelle armée nationale, se créent un peu partout. C’est seulement plus tard, à partir de 2012, que l’opposition extérieure tentera de les coordonner en une véritable armée, l’Armée syrienne libre (ASL), mais ce sera un échec.
Ce passage à la lutte armée, qui devient rapidement une militarisation, ne fait pas l’unanimité. La violence ne risque-t-elle pas de discréditer le mouvement ? Dans plusieurs villes, Homs par exemple, ce débat reflète en partie l’opposition entre les habitants des quartiers populaires et ruraux (plus « pratiques ») et les élites urbaines composées d’étudiants et de professions libérales, lesquelles dirigeaient les manifestations pacifistes. La militarisation est vécue par beaucoup d’entre elles comme une dépossession de la révolution27 (malgré des exceptions, comme l’Université d’Alep qui crée son propre groupe armé).
Si la plupart des combattants sont issus des milieux populaires et ruraux, la composition du commandement est plus complexe car la guerre redistribue en partie les cartes. Les compétences, la bravoure, la capacité de se procurer des armes comptent, donnant une place privilégiée aux officiers déserteurs. Mais si une position de notabilité avant-guerre ne suffit pas à faire un chef militaire, elle s’avère un atout, tout comme la (bonne) appartenance tribale. Autre critère, l’apport financier initial, qui explique le rôle dirigeant d’artisans, de cheikhs ou de trafiquants, car récupérer les armes de l’AAS n’est ni simple ni suffisant, et créer et entretenir une unité, même à effectif réduit, nécessite d’importantes ressources. Une balle de 7,62 (pour AK47) pouvait au début du conflit coûter jusqu’à deux dollars. D’où des anecdotes surprenantes, celle par exemple du commerçant qui vend l’ensemble de ses biens pour équiper et salarier une unité de 30 hommes durant trois mois… 28 Période durant laquelle il s’agira de trouver des sponsors en publiant sur Youtube ses exploits.
Et c’est bien parce que l’opposition extérieure s’est montrée incapable de financer ces groupes, en particulier de verser des soldes, qu’aucune coordination n’a été possible et que les hommes en armes ont dû trouver par eux-mêmes l’argent nécessaire, sur le terrain ou à l’étranger. D’où rapidement la compétition et les rivalités, avant même les affrontements.
Et si un groupe prend de l’ampleur, son budget fait de même. Prédation, contrôle et taxation des flux, etc., sont le fruit d’une « logique d’accumulation de la puissance militaire », d’une recherche de monopole, car tant qu’un groupe ne l’a pas obtenu le chaos règne dans le secteur et l’économie en pâtit. Dans les zones pétrolifères, les revenus des entrepreneurs locaux leur permettent d’entretenir assez de combattants pour repousser la plupart des intrus et protéger leurs installations29.
On comprend l’avantage que prendront les groupes disposant de ressources et soutiens extérieurs car une telle militarisation aurait été impossible sans aides étrangères, celle notamment des monarchies du Golfe et, dans une moindre mesure, des pays occidentaux (la France, malgré l’embargo imposé par l’UE, livre des armes à certains groupes dès 2012). Si l’opposition extérieure a été au début réticente, une partie de la bourgeoisie syrienne, comptant sur un soutien international, voire une intervention militaire contre Assad, a fait fonctionner réseaux et contacts et poussé à la militarisation
Les groupes armés un tant soit peu pérennes, car disposant de leur autonomie financière, vont renâcler à se soumettre aux autorités civiles, d’autant plus s’ils viennent de zones rurales et sont mal accueillis par les citadins30. Ils ont au contraire tendance à se poser en gestionnaires en se dotant d’une branche politique. D’où, là aussi, le poids grandissant de ceux bénéficiant d’un soutien extérieur, celui par exemple des Frères Musulmans, et dont les capacités de gestion du quotidien sont supérieures à celles de leurs rivaux. De plus, leur aisance financière fait qu’ils sont moins tentés de pratiquer racket, pillage et rançonnage, et sont donc mieux perçus par la population (c’est le cas d’Al Nosra ou de l’EI).
On ne passe évidemment pas de groupes autonomes de déserteurs constitués spontanément à un chaos généralisé où des centaines de milices, fréquemment islamistes et subventionnées par l’étranger, s’affrontent en des coalitions mouvantes et temporaires aussi rapidement que nous le résumons ici. Mais, dès l’automne 2012, s’amorce une compétition entre les groupes se revendiquant plus ou moins de l’ASL et ceux qui annoncent vouloir instaurer une administration islamique en Syrie ; excepté dans le sud ce sont ces derniers qui dominent. La situation empire à partir du printemps 2013 du fait de l’intervention d’acteurs extérieurs.
Sens dessus dessous ?
Bourgeois et prolétaires ne sont pas égaux devant la mort, ni devant la guerre mais, dans les deux cas, une dose d’incertitude est toujours au rendez-vous.
Combats et bombardements concernent avant tout les quartiers prolétaires des villes syriennes, notamment ces quartiers périphériques dits « informels » où les victimes de la crise et de l’exode rural s’entassaient avant-guerre et qui ont été des foyers de révolte en 2011. Les centres-villes et les quartiers bourgeois étant eux généralement du côté loyaliste, ils ont au moins échappé aux plus violents bombardements.
Ici certains ont plus que leur vie à y perdre. Les membres des classes moyennes propriétaires de biens immobiliers par exemple ou bien les artisans et commerçants, peuvent se trouver déclassés en un instant à cause de la maladresse d’un pilote de Soukhoï. La dévaluation de la livre syrienne n’a ruiné que les petits épargnants, non les bourgeois titulaires de comptes à l’étranger.
Si certaines familles perdent leurs avoirs, des profiteurs de guerre prospèrent, trafiquent et investissent. Un chef de guerre devient aisément chef d’entreprise. Les hiérarchies se remodèlent, très partiellement.
C’est surtout une minorité des classes moyennes syriennes impliquées dans les protestations de 2011 qui tire profit des nouvelles institutions et se retrouve aux postes de responsabilité. Grâce à leur niveau scolaire et à leurs compétences techniques, de nouveaux cadres émergent, plus expérimentés, plus âgés que ceux qui animaient le mouvement en 2011 (à Idlib il faut par exemple disposer d’un diplôme universitaire pour être élu)31. Le rôle des membres des classes moyennes est central du fait de l’absence des anciennes élites qui ont rapidement fui à l’étranger ou vivent dans les secteurs loyalistes. D‘anciennes familles dominantes, marginalisées par le régime baasiste, font par contre leur retour sur le devant de la scène politique. « Dans ce contexte d’isolement croissant des individus, une minorité voit son capital social s’accroître du fait de son appartenance aux réseaux protestataires […] Il reste que le capital antérieur des acteurs détermine assez largement la distribution des positions de pouvoir au sein des nouvelles institutions. Tandis que les ruraux et les classes populaires jouent un rôle dominant dans les institutions militaires, les classes moyennes s’imposent dans l’administration civile renaissante et les élites dans les institutions de représentation à l’extérieur de la Syrie »32.
L’accord de cessation des hostilités entré en vigueur en février, redonne dans ces zones un peu de place aux civils. Médias bourgeois et militants ont vite annoncé la reprise dans plusieurs villes des manifestations anti-Assad du vendredi. Comme si, après cinq ans d’interruption, la « révolution » syrienne pouvait tranquillement reprendre son cours. On est en fait bien loin des foules qui emplissaient les avenues en 2011, les rassemblements ont été particulièrement modestes, par exemple 200 manifestants à Alep (sur 200 000 habitants des quartiers rebelles) et ne se sont pas répétés. Il est vrai que dans certaines villes ils ont entraîné des tensions, voire des affrontements, avec les groupes armés locaux comme Al Nosra. Rien d’étonnant si l’on repense à l’opposition entre urbains et ruraux, les groupes islamistes armés représentant la « culture conservatrice de la partie rurale »33.
Alors qu’en 2011 les femmes occupaient généralement une place spécifique dans les cortèges (au centre où à l’arrière), elles sont complètement absentes des récentes manifestations34. Si au départ, pour certaines femmes, l’implication dans la « révolution » a pu être un moyen de s’affranchir des normes sociales (pour d’autres cela a été le veuvage), l’arrivée tardive des religieux au travers de l’administration judiciaire, et leur poids politique y ont mis un frein.
Le soulèvement prolétarien de 2011 a été rejoint et pris en main par les classes moyennes. La guerre leur avait coupé toute perspective mais, aujourd’hui, tout pour elles paraît redevenir possible. Les prolétaires, eux, étaient fort mal placés pour tirer profit de ces années de guerre civile. Ils risquent de l’être tout autant si la paix revient.
5 / Sur la route des prolétaires
Sur une population syrienne estimée à 22 millions en 2015, 6,5 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays (dont 1,7 millions vivant actuellement dans des camps), et 6 millions officiellement enregistrées dans les pays voisins (Égypte, Irak, Jordanie, Liban et Turquie)35. A noter qu’après 2003, des centaines de milliers d’Irakiens (peut-être 1,5 million) avaient déjà trouvé refuge en Syrie. Ce serait selon l’ONU « la plus grande crise humanitaire du monde depuis la Seconde Guerre mondiale ». Si de nombreux réfugiés ont tenté de rejoindre l’Europe depuis 2011, la « crise des migrants » de 2015 bat tous les records36, le continent n’ayant pas connu de mouvements de population d’une telle ampleur depuis l’immédiat après-guerre (1945-1947). Ce sont néanmoins les pays voisins de la Syrie qui « accueillent » le plus de réfugiés.
La Turquie abrite ainsi sans doute plus de 3 millions de réfugiés syriens, dont 10 à 15 % dans des camps proches de la frontière syrienne, et des centaines de milliers à Istanbul. Comme il n’y a pas d’obligation de visa pour les Syriens, seule une minorité bénéficie d’un statut de réfugié donnant droit à un permis de travail, et la majorité recourt donc à l’économie informelle (fin 2015, 400 000 réfugiés syriens travailleraient illégalement dans le pays). Mais la Turquie n’est souvent qu’une étape pour les migrants à destination de l’Europe.
Le Liban, qui comptait initialement 4 millions d’habitants, a officiellement reçu en 2016 1,2 million de Syriens, mais plus vraisemblablement 2 millions. Comme juridiquement aucun camp de réfugiés n’y existe, ils doivent s’entasser à plusieurs familles dans des logements précaires, des abris rudimentaires, des garages ou sous des tentes. La moitié d’entre eux occupent un emploi non qualifié ou peu qualifié dans la construction, le gardiennage et l’agriculture, de manière illégale pour la quasi-totalité. Ces trois secteurs employaient déjà beaucoup de Syriens et d’immigrés avant-guerre, et ce sont eux qui pâtissent de la baisse des salaires due à la situation : le revenu mensuel moyen d’un ouvrier syrien est d’environ 38 % inférieur au salaire minimum libanais (450 dollars)37.
La montée d’une xénophobie anti-syrienne et les conflits entre réfugiés s’ajoutant à la fragilité économique et sociale du pays et aux attentats, le risque est grand de voir déborder le conflit syrien sur son petit voisin.
Deutschland über alles
Pour l’Europe, les chiffres sont incertains, notamment en raison de la mobilité des migrants. Près de 1,3 million de réfugiés ont déposé en 2015 une « demande de protection internationale » dans un État de l’UE, plus du double de l’année précédente. Entre la moitié et le tiers d’entre eux seraient Syriens (au moins 400 000, soit deux fois plus qu’en 2014), 20 % Afghans (autour de 180 000, quatre fois plus qu’en 2014) et 10 % Irakiens (120 000 soit sept fois plus). Mais au delà du nombre, ce qui va susciter bien de l’intérêt ce sont les qualités et qualifications supposées de ces migrants.
En septembre 2015 le Président du MEDEF, juge ainsi que « les migrants sont un atout pour la France » car ils « ont souvent un fort niveau d’éducation, sont la plupart du temps jeunes, formés et n’ont qu’une envie, vivre en paix et pouvoir élever une famille ». Le Ministre de l’Économie, déclare que l’afflux de réfugiés constitue une « opportunité économique, parce qu’il s’agit de femmes et d’hommes qui ont aussi des qualifications remarquables ». Mais les migrants « boudent » la France qui a mauvaise réputation du point de vue de l’accueil ou de l’économie. Seuls 10 000 réfugiés syriens ont été accueillis depuis 2011 et en 2015, environ 5 000 y ont fait une demande d’asile, soit 1,3 % des demandes déposées en Europe.
Chacun le sait, les migrants veulent dans leur très grande majorité rejoindre l’Allemagne, qui a enregistré plus d’un million de demandeurs d’asile en 2015 38. Un engouement populaire s’est manifesté chez une partie des Allemands pour dire « willkommen ! » mais, bien qu’animés de bons sentiments, beaucoup soulignaient que ces réfugiés n’étaient pas des immigrés comme les autres, qu’ils étaient tous très qualifiés, éduqués et déjà bilingues. A preuve, tous les migrants interrogés par les journalistes parlaient un parfait anglais et étaient avocats, ingénieurs ou enseignants… Des remarques qui s’avéreront pratiques lorsque quelques mois plus tard il s’agira de faire le tri entre bons et mauvais arrivants. Mais, au-delà du déploiement d’arguments moraux, le débat sur l’accueil des migrants en Allemagne les a surtout considérés comme une force de travail potentielle sinon providentielle.
Accueil et rentabilité
L’Allemagne est en effet confrontée depuis des années à une pénurie de main d’œuvre et à des difficultés démographiques comme le vieillissement de la population et une faible natalité. A la rentrée scolaire de 2015, 80 000 postes d’apprentis sont restés non pourvus dans un pays qui compte un million d’emplois vacants notamment dans l’artisanat.
Pour beaucoup de « spécialistes » la solution réside dans l’immigré, d’autant qu’il offre l’avantage d’être déjà en âge de travailler, donc de réduire les coûts de reproduction de la force de travail : « l’entretien et l’éducation d’un être humain pendant les vingt premières années de sa vie coûtent environ 200 000 euros »39. Mais de 2000 à 2010 le solde migratoire est resté négatif en Allemagne, le nombre de demandeurs d’asile n’ayant recommencé à augmenter qu’à partir de 2008. En 2014, le pays a enregistré un solde migratoire de 550 000 personnes, sur 1,46 million d’arrivées dans le pays. Il s’agit donc de trouver les bons immigrés, mais aussi de les garder.
Experts et enquêteurs vont donc chercher à savoir si le fameux « médecin syrien » est bien représentatif de ces « nouveaux » migrants. En réalité, leur profil varie en fonction des périodes et des destinations. Les premiers à partir sont théoriquement les plus qualifiés, du moins ceux susceptibles de trouver rapidement un travail et de l’argent, et donc de faire ensuite venir leur famille.
Pour l’ONU, environ la moitié des réfugiés syriens sont âgés de moins de 17 ans, mais les autres sont « dans leurs années productives » (rappelons que l’apprentissage commence à 15 ans outre-Rhin). Selon le HCR, ceux qui atteignent l’Europe sont majoritairement des jeunes hommes célibataires ayant une formation secondaire ou supérieure40.
A l’automne 2015, c’est d’abord avec satisfaction que le patronat allemand a accueilli la « crise des migrants ». Le PDG de Daimler annonce vouloir recruter directement dans les centres d’accueil : « La plupart des réfugiés sont jeunes, bien formés et très motivés. C’est exactement le genre de personne que nous recherchons ». Selon des chercheurs proches du patronat « il y a une nouvelle qualité dans l’accueil par rapport aux précédentes vagues d’immigration, où nous n’avions pas cherché à retenir les gens. Aujourd’hui, on veut intégrer les travailleurs à long terme et on fait beaucoup plus pour l’intégration. »41
Le patronat allemand insiste en réalité depuis plusieurs années auprès du gouvernement afin qu’il simplifie et facilite les démarches d’accueil et de régularisation. Il réclame en particulier la règle dite du « 3+2 » : l’assurance qu’un demandeur d’asile en formation pourra rester en Allemagne les trois années de sa formation, suivies de deux années permettant à son employeur de rentabiliser l’investissement engagé42.
En novembre 2014, sous la pression du patronat, le temps de séjour nécessaire aux réfugiés pour travailler légalement passait de neuf à trois mois mais aujourd’hui la Fédération allemande des industries (BDI équivalent du MEDEF) voudrait que cette période soit à nouveau réduite. En août 2015, le délai pour accéder aux aides à la formation a été raccourci de 4 ans à 15 mois.
Autre « obstacle » à éliminer celui d’une sorte de « préférence nationale » obligeant de soumettre l’embauche d’un requérant à l’Agence pour l’emploi censée vérifier qu’aucun candidat allemand ou membre de l’UE ne peut prétendre à ce travail. Ce dispositif a été considérablement allégé depuis novembre 2015 et, de plus, l’Agence pour l’emploi diffuse une brochure expliquant aux entreprises comment contourner la législation, par exemple en recourant à des stages ou des formations43. En avril 2016, cette règle a été suspendue pour trois ans.
Bémols et malentendus
Les migrants syriens, pour nous limiter à eux, fuient la guerre, tentent de survivre, ont parfois tout perdu, rêvent de refaire leur vie et, pour les plus optimistes, de retourner un jour dans une Syrie pacifiée. Ce qui est certain c’est qu’ils n’ont pas parcouru des milliers de kilomètres par plaisir, par goût du nomadisme, pas pour « remplacer » ou revivifier un prolétariat européen que certains jugent trop bien nourri et trop soumis, ni pour résoudre le problème de main d’œuvre du patronat allemand. Et ce dernier, aussi puissant soit-il, n’a pas fomenté des guerres pour en tirer de nouveaux prolétaires, il profite plus prosaïquement de cette situation. Le flux de migrants n’est pas un don du ciel, juste le fruit de carnages.
Entre les enquêtes et la réalité il y a comme un écart. Le premier obstacle à l’employabilité rapide des migrants est leur méconnaissance complète de la langue, parfois même de l’alphabet latin. Pire, bon nombre d’entre eux se révèlent même analphabètes. S’y ajoute la question des diplômes et de leur équivalence, du moins lorsqu’ils en possèdent car, selon certaines études, 80 % d’entre eux sont en fait en dessous du niveau et de la formation d’un simple OS allemand44.
Les intégrer au marché du travail s’annonce difficile, mais le patronat se dit prêt à investir dans leur formation, prudemment car les réfugiés ont seulement un titre de séjour de trois ans, c’est-à-dire le temps nécessaire à leur mise à niveau. « Chez Daimler, 40 demandeurs d’asile ont entamé un stage au mois de novembre […]. Chaque jour, ils suivent pendant deux heures et demie une formation dans les ateliers de production et enchaînent avec trois heures et demie de cours d’allemand. D’autres cours de ce type devraient commencer cette année. Le groupe annonce que plusieurs centaines de demandeurs d’asile devraient pouvoir bénéficier d’un tel programme en 2016. Les salariés du groupe sont encouragés par la direction à participer à un système de parrainage permettant l’intégration des nouveaux venus. »45
Cette politique d’accueil a le soutien de la BDI et de l’Assemblée des chambres de commerce mais laisse dubitatifs certains patrons, en particulier ceux des fédérations du BTP ou des Machines-outils46. Il faudra en effet du temps et beaucoup d’argent, les experts l’ont calculé : la productivité moyenne d’un réfugié étant inférieure à celle d’un salarié allemand, avant qu’il produise plus qu’il ne coûte à l’État, il s’écoulera entre 5 et 7 ans47. A moyen ou à long terme, 4 à 10 ans en fonction des scénarios, l’intégration réussie des réfugiés apportera des bénéfices nets. Pourtant l’ONU se veut rassurante : si seule une minorité s’insére dans l’économie, « l’investissement est rentable »48.
Pour l’instant la prudence règne car entre l’automne 2015 et juin 2016, seuls 54 réfugiés ont été embauchés au sein des 30 entreprises de l’indice Dax ! Par contre 131 000 se sont inscrits à l’Agence fédérale pour l’emploi, et les trois-quarts sans formation professionnelle49. Il semble toutefois que Daimler finance la formation de réfugiés afin de les répartir par la suite chez certains de ces sous-traitants50.
En attendant, il se dit que les réfugiés ne doivent pas sombrer dans l’oisiveté. D’autant que la logistique de leur accueil qui incombe en dernière instance aux municipalités, repose en grande partie sur des bénévoles qui avec le temps se font rares. Le gouvernement a donc décidé d’autoriser les demandeurs d’asile à « bénéficier » des fameux ein euro jobs (travaux d’intérêt général rémunérés à 1,05 € de l’heure et réservés à ceux qui vivent de l’équivalent du RSA) pour qu’ils effectuent les tâches liées à leur propre accueil (nettoyage des lieux d’hébergement, cuisine, etc.). Les réfugiés n’ont en effet pas le droit d’occuper des emplois et de travailler dans des formes classiques tant qu’ils ne sont pas reconnus officiellement comme bénéficiant de l’asile. C’est donc un moyen de contourner ces difficultés. Depuis avril 2016, 4 000 migrants travaillent dans les 75 centres d’hébergement de Berlin, 9 000 en Bavière et le gouvernement a décidé de créer 100 000 postes de ce type (dont seront exclus les migrants issus de pays classés sûrs, l’Albanie ou le Kosovo par exemple).
Outre, dans un premier temps, une inévitable augmentation du chômage quelles conséquences aura l’arrivée soudaine d’un million de nouveaux prolétaires ? Pour les experts onusiens, l’incidence sur les salaires et l’emploi des travailleurs autochtones devrait être « petite ou inexistante », avec certes « une certaine pression sur les emplois à faible valeur ajoutée et les salaires les plus bas »51. Un syndicaliste soulignait en avril dans la presse que les personnes touchées le plus fortement par le chômage et le sous-emploi sont les moins qualifiés et que les nouveaux réfugiés ont également tendance à appartenir à ce groupe. Le plus probable, c’est une mise en concurrence accrue d’un précariat de plus en plus segmenté (ne serait-ce que par le traitement différencié des migrants) et l’augmentation de fractures racistes (y compris entre migrants de fraîche date et immigrés installés depuis longtemps) dont profitera le patronat.
Car l’éloge de la Willkommenskultur, cette « culture de bienvenue » qui serait spécifique à ce pays, et les images de migrants accueillis par des Allemands souriants, ont masqué un autre phénomène, la montée depuis quelques années de la xénophobie, avec des attaques contre des centres de demandeurs d’asile, ou les imposantes manifestations à l’initiative de PEGIDA dans l’ex-Allemagne de l’Est. Les agressions de la nuit du Nouvel An à Cologne et dans d’autres villes allemandes ont sans doute contribué au revirement d’une partie de l’opinion52. Depuis, la thématique anti-réfugiés adoptée par le parti eurosceptique AfD (Alternative für Deutschland) lui a permis de réaliser une poussée importante aux élections régionales de mars dernier.
L’épisode « crise des migrants » est provisoirement passé et les flux de réfugiés sont en net recul (92 000 entrées en Allemagne en janvier 2016, 16 000 en juin). La fermeture de la « route des Balkans » et l’entrée en vigueur de l’accord entre l’UE et la Turquie l’expliquent en partie.
Aux frontières du réel ?
« Stop ! ». Tel est le message implicite lancé en mars dernier par le patron des patrons allemands et son homologue français dans une tribune commune, exigeant une « initiative rapide » européenne, les flux de réfugiés devant « être ramenés sous contrôle et sensiblement réduits ». L’accord conclu le 18 mars 2016 entre l’UE et la Turquie doit leur donner satisfaction. En échange de quelques milliards d’euros, d’une libéralisation des visas et d’une reprise des négociations sur son adhésion à l’UE, Ankara contrôle désormais les migrants sur son territoire.
On le voit, la « Forteresse Europe » est avant tout (et pour l’instant) un phantasme pour gauchistes et fascistes car l’économie de l’UE a besoin chaque année de centaines de milliers d’immigrés. Pour les États membres, par définition au service des capitalistes, il s’agit surtout de réguler les flux existants. Assez cyniquement, car la mort est au rendez-vous, les obstacles sur la route des migrants agissent comme un filtre ne laissant idéalement passer que « des candidats en bonne santé physique et mentale, disposant d’argent et de ressources personnelles ou familiales, et fortement motivés »53. Or, l‘agence Frontex qui est au centre d’un dispositif censé coordonner l’action de garde-côtes s’est montrée en 2015 assez inefficace à en croire les gouvernants. Il a été nécessaire de mobiliser les ONG et de sympathiques jeunes humanitaires pour participer au tri et au fichage des migrants dans les camps de Grèce. Ces fameux « centres d’enregistrement et d’identification pour les réfugiés », les « hotspots », servent en particulier à séparer migrants économiques et réfugiés, les premiers voués à l’expulsion, les seconds à l’hospitalité, en un mélange bien compris de fermeté et de charité. L’action des ONG permet aussi de maintenir l’aide apportée par les populations locales dans un stricte cadre de charité et de compassion et non, éventuellement, celui d’une solidarité entre prolétaires.
Que faire ensuite des migrants ? Le problème est que les États ont des intérêts, des taux de chômage et des besoins de main-d’œuvre différents… et qui ne coïncident pas forcément avec les souhaits, les rêves, les possibilités ou l’inventivité des migrants (le monde est mal fait). Répartir et relocaliser les réfugiés est un casse-tête. La Pologne ne veut par exemple pas de migrants mais le Portugal souhaiterait lui en recevoir environ une dizaine de milliers pour repeupler certaines régions agricoles54.
Le nécessaire contrôle des flux de migrants s’est vu compliqué par l’utilisation des réfugiés comme arme diplomatique (par la Grèce ou surtout la Turquie ouvrant ou fermant « les vannes » pour faire pression sur l’UE) ou comme arme de guerre (provoquer la fuite de civils pour saturer de réfugiés les territoires adverses et les déstabiliser, ainsi que l’a fait Assad contre la Turquie).
La « crise des migrants » de 2015 n’aura peut-être été qu’un test grandeur nature en prévision des prochaines décennies, peu concluant car marqué par une perte de contrôle, une gestion improvisée, des décisions dans l’urgence et surtout l’inadéquation des dispositifs actuels. Frontex va donc être remplacé par une nouvelle Agence européenne de garde-côtes et des frontières aux pouvoirs renforcés, autorisée désormais à imposer la présence de ses unités à tout État de l’UE. 55 Il y a de la réforme des politiques migratoires dans l’air.
6 / Du rêve de révolution
Quel lendemain attend la Syrie ? En tout cas, géants du BTP et industriels s’y préparent. L’ONU estimant le coût des destructions de logements et infrastructures à 90 milliards de dollars (79 milliards d’euros), le chantier de reconstruction sera immense. Les projets de pipeline et de gaz off-shore vont ressortir des cartons. Mais qui sera le mieux placé, et comment se répartir le marché ? En fonction de zones d’influence ?
Dans le pays même, la guerre a réglé de manière sévère le problème du prolétariat surnuméraire, mais c’est sans compter les dévastations, les usines détruites, déplacés, démontées et volées. Faudra-t-il en fin de compte importer de la main d’œuvre ? D’autant que depuis 2011 l’éducation et la formation professionnelle n’ont pas été la priorité de Damas, et qu’une partie de la force de travail, probablement la mieux qualifiée et éduquée, s’est exilée. L’archevêque d’Alep l’a évoqué de son point de vue, celui des chrétiens syriens, mais son jugement vaut pour les autres « communautés » : « Avec l’arrivée de centaines de milliers de réfugiés en Europe, j’ai peur de l’avenir. Je sens comme si une déportation de notre population était organisée, surtout de notre population productive, ceux qui pouvaient reconstruire le pays et l’Église. C’est la classe moyenne, la charnière et la colonne vertébrale de notre société, qui est en train d’être absorbée »56.
Quant aux prolétaires, ils ont sans doute été trop massacrés, divisés, confessionnalisés et communautarisés pour qu’on puisse espérer d’eux un sursaut dans les prochaines années. Les temps de guerre offrent parfois des possibilités de rupture radicale grâce à la fragilité et à l’effondrement de l’État, comme en 1871 à Paris, en 1917 en Russie et en 1918 en Allemagne, mais la guerre civile étouffe bien souvent (sinon presque toujours) les perspectives.
Faudrait-il malgré tout positiver ? En cherchant bien ? Il est certes réconfortant d’avoir des héros, de l’espoir, une croyance, mais de là à sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « La révolution ! La révolution ! »… Et d’essayer de se convaincre et de convaincre que ce qui se passe est « très intéressant ». Parce que « des gens » font « quelque chose ». La propagande est toujours une activité navrante mais ici, dans les champs de ruines syriens qui sont pour lui le summum de l’urbanisme, le militant européen désillusionné est à la recherche de cette pépite qui prouverait qu’il a raison, que le filon existe. Le terme « révolution » a été utilisé pour décrire tel ou tel processus en cours en Syrie, mais souvent par des militants ou des journalistes qui n’y voient que le synonyme d’une « vraie » réforme. Parfois par d’autres, plus habitués d’une critique radicale et qui savent pourtant que les mots ont un sens. Erreur lexicale ? L’état du prolétariat en France, le désenchantement, le prisme déformant et hypnotique de l’AK47 sont-ils des explications suffisantes ?
Autogérer la survie dans une ville en ruine, les armes à la main, tout en singeant la société écroulée… Nous ne mettrons pas le mot « révolution » sur ce cauchemar.
Pourquoi la révolte prolétarienne de Syrie a-t-elle échoué en 2011, tout comme la « révolution » démocratique qui l’a suivie ? Est-ce uniquement à cause de phénomènes exogènes ? Pourquoi, face au délitement de l’État, cherche-t-on à le suppléer, à préparer/faciliter son retour. Pourquoi l’activité minimale d’une population livrée à elle-même dans la guerre – se débrouiller pour survivre – s’écrase-t-elle sur le mur de la réalité ? Faire reculer l’État est nécessaire mais insuffisant, rétablir la « normalité » c’est préparer son retour. Trouver son idéal de révolution dans les limites même de ce type de processus, c’est se condamner à des échecs cuisants, par exemple quant aux question du rapport à la violence, à la militarisation ou au pragmatisme57. Nous ne savons évidemment pas comment, concrètement, les prolétaires aboliront les classes, nous n’avons pas de modèle. Mais peut-être un jour serons-nous à notre tour confrontés à l’apocalypse (la révélation), et prétendrons-nous à un minimum d’utilité, comme par exemple en poussant à une sortie du chaos par le haut, en tentant d’en finir avec l’État, l’armée, l’argent, le salariat, etc. Il faudra pour cela que nous ayons, au moins, des rêves un peu plus ambitieux.
Tristan Leoni, juillet 2016
CONSEILS BIBLIOGRAPHIQUES
« Califat et Barbarie. Première partie : de l’État », novembre 2015.
« Califat et Barbarie. Deuxième partie : de l’utopie », décembre 2015.
G.D., « Brouillards de guerre », juin 2016.
***
Adam Baczko, Gilles Dorronsoro, Arthur Quesnay, Syrie. Anatomie d’une guerre civile, CNRS éditions, 2016, 416 p.
Michel Korinman (dir.), Daech. Menace sur les civilisations, L’Esprit du Temps, 2015, 384 p.
Pierre-Jean Luizard, Béligh Nabli, Wassim Nasr, Pierre Razoux, « Table ronde, ouverte à la presse, de spécialistes du Moyen-Orient », Rapport fait au nom de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 , tome II, Assemblée nationale, p. 680-697.
Sur le Rojava
Tristan Leoni, G. D., « Kurdistan ? », janvier 2015.
TKGV [initiales des auteurs], « Lettre à des amis « Rojavistes », mai 2016.
« Deux guerres locales », Internationale Situationniste, n°11, octobre 1967.
Sur les migrants
Henri Simon, « L’Industrie du migrant. Mutations et migrations : une longue histoire de la vie sur terre », Échanges, n° 154, Hiver 2015-2016, p.11-36.
Felix Baum, « From Welcome to Farewell: Germany, the refugee crisis and the global surplus proletariat », juillet 2016.
Antithesi, « Vogelfrei. Migration, deportations, capital and its state », juin 2016.
NOTES
1 Si les attentats, par exemple ceux de novembre 2015 en France, peuvent s’avérer bien utiles en termes de politique intérieure pour certains gouvernements, leur multiplication devient gênante.
2Les États-Unis assurent 90 % de ces bombardements, la France à peine 5 %.
3Car affamer une ville, lui couper l’eau, l’électricité et même internet ne sont pas des « pratiques de barbares », juste le B. A.-BA de la guerre de siège utilisé par tous.
4Voir « Califat et Barbarie. Première partie : de l’État », novembre 2015.
5Alain Rodier, « L’épreuve de vérité ? », Atlantico, 28 janvier 2016.
6Se rapprochant par la forme d’Al-Qaïda qui, à l’inverse, a eu tendance depuis 2014 à se territorialiser en particulier au Yemen et en Syrie.
7Christophe Ayad, « Les Kurdes syriens profitent de la guerre pour faire avancer leurs revendications », Le Monde, 25 septembre 2012,
8Dans ces zones ainsi que dans le quartier kurde d’Alep, le PYD aurait lui-même réprimé les manifestants, information récemment confirmée dans Adam Baczko, Gilles Dorronsoro, Arthur Quesnay, Syrie. Anatomie d’une guerre civile, CNRS éditions, 2016, p. 87.
9Même les partisans les plus convaincus du PYD doivent reconnaître qu’il s’agit là d’une « injonction par le haut » et « pas le fruit d’un élan populaire spontané ». Cf. Mathieu Léonard, « Le Kurdistan, nouvelle utopie », Le Crieur, n° 4, juin 2016, p. 130-134.
10On lira entre autres « « J’ai vu le futur, et ça fonctionne. » – Questions critiques pour les partisans de la révolution au Rojava », mai 2015.
11Lire la Lettre à des amis « rojavistes », TKGV, mai 2016.
12Quelques jours avant l’offensive, le 31 janvier 2016, l’envoyé spécial du président Barack Obama, Brett Mc Gurk, visitait Kobane et rencontrait les responsables du PYD et des YPG.
13Dernier en date en mars 2016 : des heurts entre policiers kurdes et miliciens pro-Assad à un checkpoint dégénèrent en trois jours de combats, temps nécessaire pour que la tension redescende et que les officiers de chaque camp reprennent le contrôle de leurs troupes. L’arrivée d’officiers supérieurs, notamment russes, permet d’aboutir à un cessez-le-feu dans la ville et d’ouvrir des négociations sur l’échange de prisonniers et le retour aux positions antérieures.
14Michel Korinman (dir.), Daech. Menace sur les civilisations, L’Esprit du Temps, 2015, p. 280-281.
15Wladimir van Wilgenburg, « Les Kurdes syriens cherchent à prendre Raqqa en s’alliant à une nouvelle force arabe », Middle East Eye, octobre 2015.
16Catherine Gouëset, « Syrie: cinq ans de guerre dans les faubourgs de Damas », L’Express, 15 mars 2016.
17Jihad Yazigi, « La guerre continue à détruire, mais aussi à créer de nouvelles structures », Le Commerce du Levant, mars 2016.
18Jihad Yazigi, « Que reste-t-il du tissu industriel syrien? », Le Commerce du Levant, mai 2016.
19Laure Stephan, « Dans les quartiers ouest, une vie en sursis », Le Monde, 6-7 mars 2016.
20« « Cessez-le-feu » en Syrie », CQFD, n° 142, avril 2016.
21Notamment celle de l’anarchiste syrien Omar Aziz. Voir Leila Shrooms, « La base sociale de l’opposition civile syrienne », avanti4.be, octobre 2013 et Christophe Ayad, « Mort en détention de Omar Aziz, père des comités locaux de la révolution syrienne », Le Monde, 26 février 2013.
22Ignace Leverrier, « La mise en place en Syrie des organisations de la société civile », Colloque Ilasouria.01, octobre 2013.
23Adam Baczko, Gilles Dorronsoro, Arthur Quesnay, op. cit., p. 35. A noter que l’EI fait de même lorsqu’il s’empare d’une localité.
24Au printemps 2013, grâce au soutien financier des Etats-Unis et de l’UE, les policiers d’Alep ont bénéficié d’une formation délivrée par une société de sécurité privée britannique.Adam Baczko, Gilles Dorronsoro, Arthur Quesnay, op. cit, p. 155.
25Adam Baczko, Gilles Dorronsoro, Arthur Quesnay, op. cit, p. 36.
26Contrairement aux armées tunisienne et égyptienne très proches des pays occidentaux.
27Adam Baczko, Gilles Dorronsoro, Arthur Quesnay, op. cit, p. 127, 286-287.
28Ibid, p. 132.
29Ibid, p. 308.
30Voir « Califat et Barbarie. Deuxième partie : de l’utopie », décembre 2015. Chapitre intitulé « L’enfant caché du Printemps ? ».
31Ibid, p. 282.
32Ibid, p. 278.
33« « Cessez-le-feu » en Syrie », op. cit..
34Voir par exemple https://syriafreedomforever.wordpress.com , un site anti-Assad qui compile photos et vidéos de plusieurs villes.
35ONU & Université Saint Andrews, Syria at War: Five Years On, 2016, 36 p.
36Les différents organismes tentent d’établir une différence entre réfugiés (fuyant la guerre et relevant de la Convention de Genève) et migrants économiques (recherchant du travail) alors que les deux se couplent souvent. La distinction est donc purement juridique, varie en fonction des pays et permet de diviser et trier les immigrés.
37Jeanine JALKH, « Réfugiés syriens : le risque de l’effet boomerang », L’Orient le Jour, 30 juin 2016.
38Selon une étude réalisée par le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) entre avril et septembre 2015 auprès des Syriens arrivant sur le sol européen, 50 % veulent aller en Allemagne et seulement 0,4 % en France. Ces chiffres sont évidemment à prendre avec toutes les pincettes nécessaires d’autant que les réfugiés ont sans doute vite compris que les humanitaires étaient aussi des auxiliaires de police. UNHCR, Syrian Refugee Arrivals In Greece, 2015, 15 p.
39Wildcat, « Migration, réfugiés et force de travail », Échanges, printemps 2016.
4081 % seraient des hommes, 69 % âgés entre 18 et 35 ans et 86 % auraient un niveau bac et études supérieures. Données discutables, comme on va le voir. Et 58 % disent leur intention de faire venir leur famille dans leur pays d’accueil. UNHCR, op. cit.
41Cécile Boutelet, « En Allemagne, les patrons souhaitent faciliter l’embauche des réfugiés », Le Monde, 9 septembre 2015.
42« L’afflux de migrants profite aux patrons allemands », Le Temps, 2 septembre 2015.
44Pascal Hugues, « Réfugiés : un miracle économique pour l’Allemagne ? », Le Point, 1er février 2016.
45La Deutsche Bahn et Siemens ont lancé des programmes similaires. Pascal Hugues, op. cit.
46Jean-Philippe Lacour, « Migrants : l’enthousiasme des industriels allemands retombe », Les Echos, 20 octobre 2015.
47Pascal Hugues, op. cit.
48ONU & Université Saint Andrews, Syria at War: Five Years On, 2016, 36 p.
49« Les réfugiés en Allemagne restent aux portes du Dax », Les Échos, 5 juillet 2016
50Pascal Hugues, op. cit.
51ONU & Université Saint Andrews, Syria at War: Five Years On, 2016, 36 p.
52Seule une minorité des suspects interpellés est originaire de Syrie. Sur cet événement lire le Bulletin n° 9 (février 2016) de Mouvement Communiste, « Cologne : les attaques contre les femmes sont le produit du patriarcat et font le jeu des racistes anti-immigrés ».
53Wildcat, op. cit.
54 Julia Mourri, « Le Portugal veut accueillir plus de migrants: les réfugiés aident au développement du pays », leplus.nouvelobs.com, 23 février 2016.
55Charles de Marcilly, « Crise des réfugiés : l’UE face aux défis migratoires », Diplomatie, n°31, février-mars 2016.
57Penser par exemple qu’une alliance « provisoire » avec ces jeunes gens si doués au combat (djihadistes d’Al Nosra ou Navy seals) ne prête pas à conséquences.
Source: DDT21, 21 juillet 2016
Attachments
Comments

Comme nous le faisons régulièrement avec des textes dont nous ne revendiquons pas forcément ni la totalité du contenu, ni obligatoirement la dynamique militante ou le corps programmatique de leurs auteurs (collectifs ou individuels), nous reproduisons sur notre blog le nouvel article de Tristan Leoni sur l’État islamique et le conflit syro-irakien, initialement publié sur le blog DDT21 Douter de tout… | Douter de tout… pour tenir l’essentiel.
« Petit à petit, je dresse la liste de l’alphabet des ruines. Tout cela signifie quelque chose.
Cela ne peut pas ne pas avoir de sens.
La guerre nous parle… »
David B., La Lecture des ruines, 2001
Peut-on lire dans les ruines comme dans les lignes de la main ? La capitale politique de l’État islamique (EI) est tombée le 17 octobre 2017, épilogue annoncé d’une bataille qui a véritablement débuté quatre mois plus tôt. Pourtant, pas de foule en liesse dans les rues pour accueillir les libérateurs, et pour cause. Durant cette période, la population est passée de plus de 300 000 habitants (dont un tiers de réfugiés) à quasiment zéro. Le camp du Bien étant précis, on ne compterait qu’entre un et deux mille civils tués sous les bombardements ; les autres ont fui l’avancée des combats et tentent aujourd’hui de survivre sur les routes ou dans des camps de réfugiés.
La prise de Raqqa est hautement symbolique puisque la cité, aux mains de l’EI depuis juin 2013, avait été sa capitale politique (même si son administration avait été transférée plusieurs mois auparavant à Mayadine, à 175 km en aval sur l’Euphrate). Un mois plus tard, à Abou Kamal, une bataille d’une importance stratégique – sur laquelle nous reviendrons – signait véritablement la fin du Califat en tant qu’entité territoriale protoétatique. L’effondrement de l’EI semble refermer une parenthèse, celle de l’affrontement entre le Mal et le reste du monde ; désormais, l’actualité syrienne sera celle du conflit initial, cette guerre civile qui a mis fin et fait suite à la contestation sociale de 20111. En dépit des années d’un processus de libanisation qui a vu s’affronter des centaines de milices et groupes armés plus ou moins soutenus par des puissances étrangères, le conflit touche à sa fin.
Les prolétaires avaient eu le choix entre se faire tout petits, émigrer ou choisir un camp (le métier de soldat, le seul en tension dans la région, ayant l’avantage de fournir un salaire et un repas). Mais, désormais, la normalisation approchant, chacun se prépare à une exploitation plus rationnelle et plus classique de toute cette main-d’œuvre qu’on imagine docilisée par des pluies de bombes et de ruines.
Zéro partout, la balle au centre ?
La partie est jouée ; l’éviction des milices islamistes des quartiers orientaux d’Alep, en décembre 2016, en aura été le tournant. Le régime de Damas restera en place et la Syrie, ravagée par la guerre, sera découpée en zones d’influence (russe, turque ou américaine) ; les combats de 2017, et probablement ceux de 2018, n’ayant pour objet que d’en préciser les contours.
Le succès du camp loyaliste, qui n’est pas loin d’une victoire à la Pyrrhus, est surtout celui de la Russie. Avec une présence militaire limitée (donc peu coûteuse), elle confirme son implantation dans le pays, multiplie les ventes d’armes dans la région et renforce sa stature internationale en se posant en puissance incontournable au Proche-Orient et en Méditerranée orientale. À l’efficacité de son corps expéditionnaire s’ajoutent en effet les percées diplomatiques : court-circuitant les infructueuses négociations de Genève, c’est Moscou qui, à partir de janvier 2017, prend en main le processus de paix en Syrie en lançant les rounds de discussion d’Astana avec l’Iran, la Turquie et certains groupes rebelles islamistes. L’autre grand vainqueur est l’Iran, qui, en Syrie comme en Irak, accroît son influence tout comme, dans une moindre mesure, son allié, le Hezbollah libanais. Quant à la Turquie, après bien des revirements diplomatiques, elle a fini à l’été 2016 par se rapprocher du trio Russie-Iran-Syrie, cherchant à s’imposer, elle aussi, comme un acteur incontournable dans la région (ne serait-ce que par les milices islamistes et les territoires qu’elle contrôle désormais dans le nord de la Syrie). Cela montre à ceux qui en doutaient que nous n’avons évidemment pas affaire à un conflit confessionnel opposant sunnites et chiites.
Quant aux États-Unis (et à ses supplétifs occidentaux), bien que marginalisés car n’ayant jamais eu de véritable stratégie en Syrie, et contrairement aux promesses de Donald Trump, ils conservent prudemment un pied dans la porte syrienne. À peu de frais, ils se taillent une zone d’influence dont le seul intérêt est d’empêcher que la victoire russo-iranienne ne soit totale et donc de satisfaire Israël et l’Arabie saoudite. Donald Trump, que d’aucuns qualifient d’« islamophobe », se voit ainsi gratifié par le prince Mohammed ben Salman du titre de « vrai ami des musulmans ».
Les forces en lice
Le Califat
Dans ce jeu d’échec-poker qu’est devenu le conflit syrien, le joueur EI tenait en main des cartes maîtresses (territoires, villes, routes et sites stratégiques, bases aériennes, puits de pétrole, etc.) ; pour chacun des autres joueurs se coalisant contre lui, il s’agit de reprendre un maximum de cartes, qui, dans un futur proche, pourront s’échanger dans le cadre de négociations. D’où la cohue à laquelle nous avons assisté depuis un an.
À partir de l’été 2016, le territoire de l’EI s’est réduit comme peau de chagrin sous les coups de boutoir de toutes les armées de la région (turque, kurde, syriennes, irakienne, etc.) jusqu’à la perte de Mossoul, en juillet 2017, et de Raqqa, en octobre. Il a néanmoins été capable jusqu’à la fin, tout en défendant ses places fortes jusqu’à leurs derniers combattants, de lancer de farouches contre-offensives sur les arrières ou les flancs de ses adversaires. En 2014, selon les estimations hautes, il alignait entre 80 000 et 100 000 soldats ; à l’été 2017, ils n’étaient sans doute plus qu’autour de 10 000. L’armée américaine évoque 80 000 combattants de l’EI tués depuis 2014 ! À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’armée du Califat est réduite à quelques milliers de partisans dispersés dans le désert, les montagnes et campagnes reculées d’Irak et de Syrie. Mais, si les officiers de l’EI ont fait preuve de réelles qualités militaires couplées au fanatisme de leurs troupes, cette lente agonie s’explique aussi par la faible coordination de ses adversaires, voire les bâtons que chacun tentait de glisser dans les roues de l’autre.
Bien que l’appareil administratif, économique et social installé dans le Califat ait été méthodiquement mis à bas par les bombardements occidentaux2 afin que les habitants se retournent, il n’y a pas eu de grandes révoltes (les destructions ont peut-être même eu pour effet de rendre la population encore plus dépendante du proto-État). Jusqu’au dernier moment, et notamment par une sévère coercition, l’EI a su conserver le contrôle de ses troupes et de la population ; s’y est ajoutée la crainte des libérateurs, qu’ils soient chiites (à Mossoul) ou kurdes (à Raqqa). Quant aux tribus, elles ont attendu le changement de propriétaire définitif avant de modifier leur allégeance.
Mais la défaite militaire ne signifie pourtant pas la fin de l’EI ; en mai 2016, Abou Mohammed al-Adnani, porte-parole de l’organisation, avait prévenu : « Serons-nous vaincus, et vous victorieux, si vous prenez Mossoul, Raqqa ou Syrte ? Bien sûr que non. La défaite, c’est de perdre le goût du combat. » Les cadres chargés de sa propagande se sont attelés, depuis les studios et bureaux de Raqqa, à forger une légende qui perdurera et qui servira de référence pour les futurs djihadistes. Bien que promouvant à l’origine un djihadisme très localisé, territorialisé, et cherchant dans une optique eschatologique à construire un véritable État, l’EI est désormais condamné, pour des années, à une activité de réseau terroriste et de guérilla à travers le monde (Sahel, Afrique du Nord, Sinaï, Irak, Afghanistan, Philippines…). Il s’y était préparé, mais son avenir est incertain : disparition progressive au profit d’autres groupes ? Retour en force ? Changement de nom ? Montée en puissance de sa frange radicale3 ? Transformation en une affaire principalement européenne (les djihadistes occidentaux étant les moins intéressés par les logiques nationales4) ?
La Syrie loyaliste
Paradoxalement, les succès militaires du camp loyaliste ont également contribué à l’affaiblissement de l’État syrien. Outre une dépendance économique croissante à l’égard de la Russie et de l’Iran, une tendance à la libanisation du pays s’est fait jour, c’est-à-dire une dilution du pouvoir au profit des milices.
Bien que centrale dans la reconquête du territoire, l’armée syrienne restée fidèle au gouvernement (sous le nom officiel d’Armée arabe syrienne, AAS) est en difficulté malgré les 100 000 à 150 000 hommes qui la composent (dont peut-être 50 000 sont opérationnels). Usée par six années d’un conflit durant lequel elle a subi de lourdes pertes (sur les probables 500 000 morts du conflit, environ 100 000 sont des combattants loyalistes), et peinant à recruter, elle a dû s’adjoindre au fil des années de plus en plus de groupes et unités paramilitaires.
Il y a tout d’abord les milices locales et les « comités populaires », créés au début du conflit par les pro-Assad, réunis au sein des Forces de défense nationale (environ 100 000 hommes), qui recrutent notamment, mais pas uniquement, parmi les minorités ethniques et religieuses (chrétiens, alaouites, chiites, druzes…), et dans les camps palestiniens (ce qui se fait aussi du côté « rebelle »). D’autres unités, parfois préexistantes au conflit, sont, elles, liées à des organisations politiques (Baas, Parti social-nationaliste syrien, ou marxistes-léninistes), aux tribus sunnites (surtout depuis la reconquête de l’est du pays, entamée en 2017), ou à des hommes d’affaires proches du régime, qui les ont directement constituées et financées. Une multiplication des milices qui entraîne une dilution du contrôle hiérarchique et le développement de pratiques délictueuses (pillage, vol, racket).
Au sein même de l’armée régulière, cette tendance à la libanisation est sensible. En effet, pour faire face à la crise, l’état-major syrien a donné plus de marges de manœuvre aux officiers sur le terrain, et des commandants d’unités en ont profité pour prendre beaucoup d’autonomie (quitte à assurer leur autofinancement) ; cela expliquerait les difficultés et les dysfonctionnements dans la chaîne de commandement qu’a connus l’AAS, voire l’emploi – tactiquement peu rentable et politiquement contre-productif – d’armes chimiques.
Cette situation est compliquée par la présence croissante d’unités militaires étrangères (40 000 à 60 000 hommes) issues de l’arc chiite, en premier lieu de l’Iran, qui fournit des conseillers militaires et des forces spéciales (les Forces Al-Qods), et du Hezbollah libanais. S’y ajoutent des milices irakiennes et d’autres petites unités, notamment composées d’Hazaras afghans (réfugiés en Iran, ils sont motivés par la solde et l’obtention promise de la nationalité iranienne).
Ce tableau des effectifs paraît impressionnant, mais, alors que les unités les moins aguerries ont dû contrôler un très vaste territoire et une multitude de fronts secondaires, les troupes les plus opérationnelles étaient continuellement sollicitées et transportées d’un bout à l’autre du pays. Elles n’auraient pu rétablir l’équilibre avec les armées islamistes, puis infléchir le rapport des forces en leur faveur, sans l’aide de Moscou. Bien que d’un volume restreint – 5 000 hommes environ comptant logisticiens, instructeurs, conseillers et spetsnaz (forces spéciales russes), et surtout d’une cinquantaine d’aéronefs de combats –, le contingent russe va se révéler d’une grande efficacité (il convient d’ajouter à ce dispositif 3 000 hommes de sociétés militaires privées russes5).
En zones rebelles
La défaite des militaires rebelles annoncée, les soutiens et bailleurs de fonds qui faisaient leur force s’en désintéressent progressivement. Les principaux d’entre eux sont d’ailleurs très divisés, Arabie saoudite et Émirats arabes unis contre Qatar et Turquie. Et, si les deux derniers tendent à se rapprocher des positions de la Russie voire de l’Iran, les deux premiers sont englués dans la guerre du Yémen. Les États-Unis ont également cessé, début 2017, leurs infructueuses et coûteuses tentatives pour constituer ou contrôler des groupes islamistes armés « modérés » en Syrie, et ont fini par se tourner vers les Kurdes des YPG (France et Grande-Bretagne ont fait de même), qui sont difficilement classables parmi les « rebelles6 » et sur lesquels nous reviendrons .
Ces groupes, au nombre de plusieurs centaines, changent régulièrement de nom et s’assemblent en des coalitions militaires tout aussi mouvantes. En 2016, le total de leurs combattants était estimé entre 100 000 et 150 000. Le sigle ASL (Armée syrienne libre), que quelques dizaines de groupes arborent, surtout dans le sud du pays, ne renvoie ni à une armée ni à une coordination ; il s’agit juste d’une étiquette qui, parfois, peut s’avérer commode.
En 2017, deux puissantes coordinations émergent de cette multitude et la polarisent. En premier lieu, Hayat Tahrir al-Cham (HTC), né en janvier 2017 de la coordination de groupes rebelles issus notamment de l’ex-Front Al-Nosra (ex-branche syrienne d’Al-Qaïda), compterait environ 30 000 combattants (dont beaucoup de volontaires étrangers), principalement dans la province d’Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Sa rivale est Ahrar al-Cham, une coordination de groupes salafistes créée en 2011, qui rassemblerait entre 10 000 et 25 000 combattants dispersés dans plusieurs provinces. Ces deux organisations, qui ont transformé en place forte la province d’Idlib (deux millions d’habitants7), sont de véritables armées lourdement équipées. Lorsqu’elles s’allient, elles sont capables de rivaliser avec les troupes de Damas, les surclassant parfois en nombre et en matériel (mis à part l’aviation, qui compense plus ou moins ce déficit), comme lors de la bataille d’Alep (été 2016) ou celle de Hama (mars-avril 2017). Mais elles sont aussi capables de s’affronter pour le contrôle de villes ou de postes-frontières avec la Turquie, c’est-à-dire pour le contrôle du commerce, de l’aide humanitaire et des « taxes ». Les deux coordinations ayant des idéologies assez proches (l’une djihadiste, l’autre davantage frériste) et des objectifs globalement similaires – l’instauration en Syrie d’un régime islamique régi par la charia –, certains groupes passent aisément de l’une à l’autre.
La séparation entre Al-Nosra et Al-Qaïda, longtemps considérée comme fictive, a tendance à devenir une réalité – les radicaux reprochant à HTC leurs compromis, compromissions et déviations doctrinales. Le fils d’Oussama ben Laden, Hamza, probablement le futur chef d’Al-Qaïda, a appelé en septembre 2017 au djihad en Syrie, sans mentionner l’ancienne filiale. La réémergence d’une Al-Qaïda officielle dans ce pays devient donc une possibilité. Au niveau international, cette organisation a pu se développer à l’ombre d’un EI qui attirait toute l’attention et les coups, et elle dispose désormais de solides implantations territoriales (Sahel, Yémen).
La région d’Idlib étant devenue, depuis mai 2017, une zone de désescalade (voir plus bas), des troupes d’interposition russes, turques et iraniennes devraient théoriquement s’y déployer entre rebelles et loyalistes ; qu’en sera-t-il des groupes islamistes qui en ont fait leur bastion ? La Turquie ne verrait par exemple pas d’un mauvais œil la création, autour d’Ahrar al-Cham et des autres groupes qu’elle contrôle, d’une nouvelle « armée nationale » aux ordres d’une administration intérimaire. Quant à HTC, il est probable qu’elle devra se soumettre ou affronter les armées syrienne et turque. Depuis fin novembre, les combats avec l’AAS s’intensifient. Pour 2018 se préparent donc de nouveaux massacres.
À noter que, si les groupes islamistes disposent du quasi-monopole de la violence, cela ne signifie pas qu’ils bénéficient de l’assentiment de la population dans les zones où ils sont actifs. Elle peut même, parfois, s’opposer à eux : ainsi les habitants de plusieurs localités d’Idlib, en juillet 2017, ont manifesté contre la présence de HTC et empêché qu’il ne s’empare de l’administration locale8. Les habitants de la Syrie ne rêvent pas que d’un État islamique ou de dictature old school, il en est même qui espèrent l’instauration d’une démocratie telle que nous la connaissons en France. Enfin, s’il existe des anarchistes ou des communistes de conseils en Syrie, il faut malheureusement reconnaître que les dynamiques qui ont cours dans ce pays depuis cinq ou six ans ne vont guère dans leur sens.
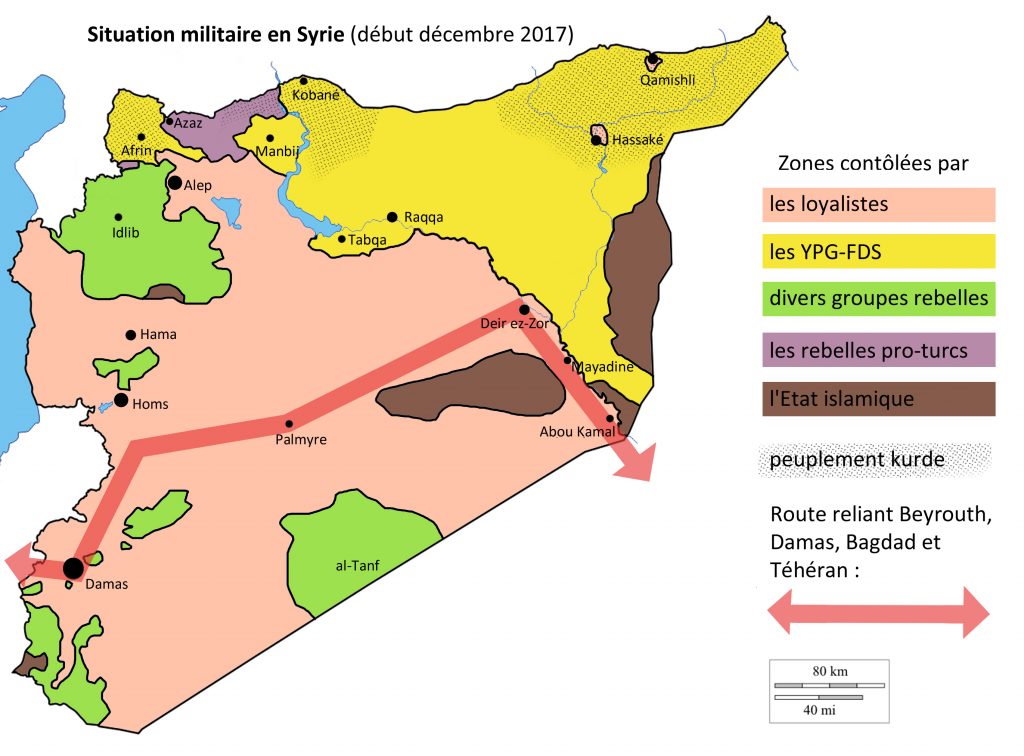
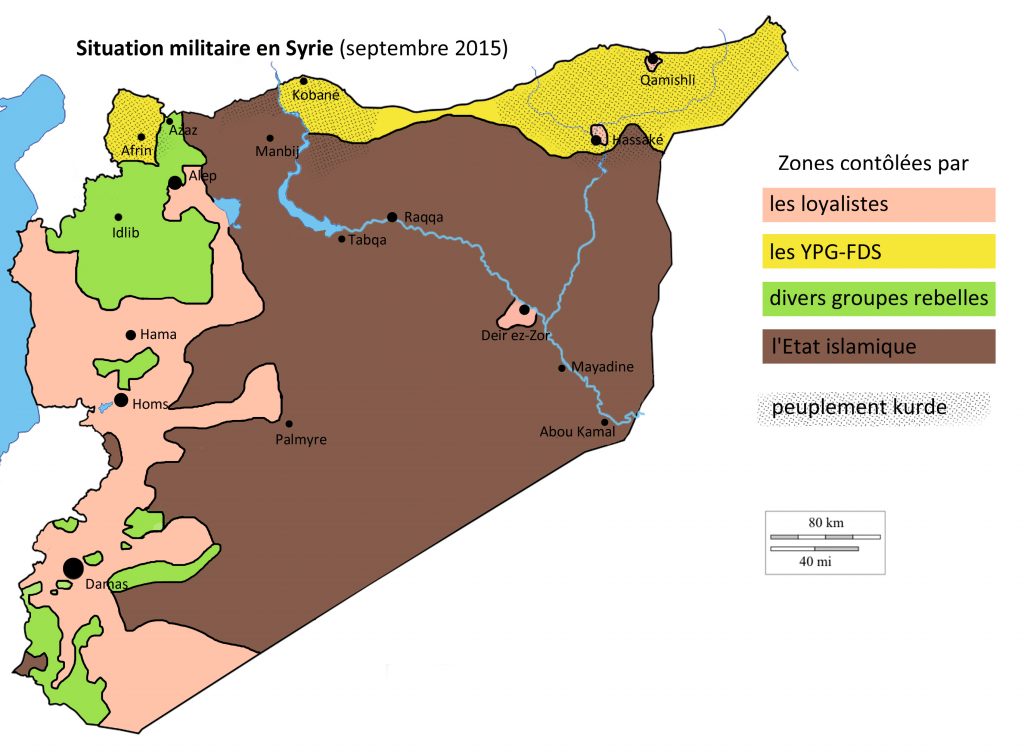
Guerre de course
Un rapide retour sur l’évolution de la situation et certains événements survenus depuis la rédaction de notre dernier article sur le sujet, en juillet 20169, nous semble nécessaire. L’effondrement progressif du Califat s’accompagne d’une rivalité entre les autres acteurs en présence pour s’emparer d’un maximum de territoire. C’est à plusieurs courses de vitesse qu’on assiste pour s’emparer de telle ou telle localité ou bien couper la route à l’autre, au risque de multiplier les accrochages plus ou moins contrôlés entre les combattants des diverses armées en lice.
Pourtant, ce qui caractérise la période c’est la poursuite et l’extension d’un processus de « déconfliction » entamé début 2016. Parallèlement à son intervention armée, la Russie a en effet mis en place un Centre de réconciliation, auquel personne ne croyait au départ ; c’est pourtant un classique de la contre-insurrection que de diviser les rebelles en proposant trêves, réintégrations et amnisties aux plus modérés. Dans ce cadre ont été signés une série d’accords locaux concernant des zones ou localités assiégées par les forces loyalistes depuis des années10, et prévoyant un processus précis : reddition de la place ; possibilité du transfert de ceux qui le souhaitent (généralement les combattants, leurs familles et les personnes les plus engagées politiquement) vers une autre région rebelle – transfert effectué sous le contrôle de la Russie, de l’ONU ou du Croissant rouge ; déploiement de la police militaire russe, mise en place d’une aide humanitaire, amnistie des rebelles – la Russie pesant de son poids sur Damas pour éviter répression et représailles.
À un autre niveau, les accords de cessez-le-feu régulièrement conclus, et rompus, entre les principaux belligérants laissent la place, à partir de janvier 2017, au processus de paix d’Astana, où, sous l’égide de la Russie, de l’Iran et de la Turquie, le régime de Damas et de certains groupes rebelles actifs sur le terrain discutent de la résolution des questions militaires et pratiques (contrairement aux négociations de Genève, auxquelles participe une opposition syrienne en exil sans lien avec les groupes combattants). Là encore, il s’agit de diviser les rebelles (dont certains sont soutenus par la Turquie) : entre ceux avec qui on peut négocier (redditions, ralliements et amnisties) et ceux qui seront considérés par tous comme des terroristes. Quatre enclaves rebelles ont ainsi été désignées, en mai 2017, comme des « zones de désescalade », notamment la région d’Idlib, et où les combats devaient progressivement cesser. D’autres accords, locaux, complètent la carte : par exemple, autour de la ville Tall Rifaat (proche du canton d’Afrin), tenue par les YPG, mais menacée par des miliciens pro-Turcs11.
Exclus de l’ensemble de ces accords, HTC et ses alliés vont tout au long de l’année profiter des offensives que mène l’AAS dans l’est du pays contre l’EI pour lancer, depuis la région d’Idlib, des attaques contre les positions loyalistes d’Alep et de Hama.
Un autre aspect de cette phase du conflit aura été, à l’est, la lutte entre Russie et États-Unis (respectivement représentés par l’AAS et les YPG) pour s’emparer du territoire contrôlé par l’EI, surtout à partir de l’effondrement de celui-ci, à l’été 2017. Si Damas cherche à rasseoir son autorité, l’enjeu est pour Washington de lui ôter le contrôle de la frontière syro-irakienne et d’empêcher l’ouverture d’une route qui, le long de l’Euphrate, relierait l’arc chiite Beyrouth-Damas-Bagdad-Téhéran. L’objectif des deux armées est alors d’atteindre et de conquérir la ville frontière d’Abou Kamal12. Toutes proportions gardées, on a pu comparer cette situation avec la course pour Berlin, Prague et Vienne entre alliés, en 194513. Mais, à l’époque, Russes, Américains et Anglais s’étaient entendus sur le partage de zones d’occupation et d’influence ; ce n’est peut-être pas le cas en Syrie, même si un minimum d’entente est nécessaire pour que les inévitables accrochages lors de la jonction entre AAS et YPG ne dégénèrent en conflit ouvert. Le risque est d’autant plus grand que chacun des camps utilise des milices supplétives connues pour leur indiscipline, et use du langage du bombardement pour signifier à l’autre les limites à ne pas dépasser.
Les États-Unis ont mené une première tentative depuis le Sud, en juin 2017 : ayant constitué et équipé en Jordanie plusieurs groupes rebelles, ils les ont envoyés, depuis Al-Tanf, s’emparer d’Abou Kamal ; malgré l’appui de forces spéciales américaines, britanniques et norvégiennes (!), ces groupes seront bloqués par l’avancée de l’AAS. Devant cet échec, les États-Unis changent définitivement leur fusil d’épaule et optent pour l’utilisation des YPG-FDS afin d’atteindre cette fameuse ville par le nord, depuis la rive gauche de l’Euphrate (nous développerons cette question du rôle des forces kurdes dans le chapitre suivant). Cette course pour la prise d’Abou Kamal sera finalement remportée par le régime syrien en novembre, grâce à une opération conjointe de l’AAS et de milices chiites ayant traversé la frontière irakienne. La conquête de cette ville, la dernière tenue par l’EI (que ce soit en Syrie ou en Irak), marque aussi l’échec du projet américain.
Rojava en surpoids
Parmi les actuels grands vainqueurs du conflit syrien se trouve sans aucun doute le PYD (la branche syrienne du PKK). Les troupes de ce parti kurde14, les YPG, contrôlent désormais près d’un quart de la Syrie, à la fin de l’année 2017 ; certains de leurs combattants montent aujourd’hui la garde à plus de 200 km des zones de peuplement kurde. L’expérience « libertaire » du Rojava a-t-elle progressé au rythme de son infanterie légère ?
Dark Victory in Raqqa
La chute de la capitale califale, hyper médiatisée, n’a pourtant pas fait les choux gras des sites militants. On est loin des envolées lyriques de l’automne 2014, lors de la bataille de Kobané, et il y a de quoi l’être.
Le mot libération est pour certains même un peu exagéré en ce qui concerne Raqqa. Après quatre mois de combats acharnés et de lourds bombardements15, la ville est quasiment rasée, aux quatre cinquièmes inhabitable, et le nombre de ses habitants, qui était d’environ 300 000, est tombé à zéro16. Les habitants, et ceux d’autres localités alentour, qui ont fui les combats se retrouvent sur les routes ou dans des camps de réfugiés. À la suite de longues négociations entre les YPG, l’armée américaine et l’EI (via les notables et chefs de tribus locaux, les quelques milliers de survivants avaient été évacués du centre-ville assiégé, tout comme les derniers combattants et leurs familles, qui ont pu rejoindre les bastions du Califat17.
Mais il faut reconnaître que nombre d’habitants ont aussi fui la nouvelle « occupation » qu’ils voyaient poindre, celle des YPG, qui jouissent, dans ces contrées, d’une réputation détestable faite de nettoyage ethnique, d’exactions, de racisme, de service militaire obligatoire (y compris pour les femmes), etc.18 Cette réputation est entretenue par certaines tribus de la région qui, soit restées fidèles au régime de Damas, soit ayant choisi l’allégeance à l’EI – tribus et familles sont souvent divisées sur ces questions –, conservent une profonde hostilité vis-à-vis des Kurdes… même si, au fond, la question est celle d’une rivalité pour l’achat des fertiles terres agricoles de la région19. Loin de ces basses considérations, les cheikhs les plus sérieux savent que la couleur des uniformes importe peu, l’essentiel étant que l’ordre et la sécurité perdurent et que les affaires puissent reprendre.
Créer deux, trois… de nombreux cantons
Mais reprenons. Depuis la bataille de Kobané de l’automne 2014, coup d’arrêt à l’avancée de l’EI, les YPG ont entrepris un lent grignotage d’importants territoires contrôlés par l’EI, des groupes islamistes ou l’ASL, bien au-delà de leur point de départ. L’objectif premier était pour eux de créer une continuité territoriale entre les trois zones de peuplement kurde du nord de la Syrie, les « cantons » de Djézireh, Kobané et Afrin ; ce qui impliquait la conquête des zones, majoritairement peuplées d’Arabes, qui les séparaient. Un objectif contrecarré par la Turquie, qui, depuis août 2016, contrôle l’un de ces territoires, via des groupes islamistes. À noter que certaines zones, notamment à l’est d’Afrin, ont été conquises en février 2016 en collaboration avec l’AAS.
En octobre 2015, à l’initiative des États-Unis, sont créées les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition militaire qui doit faciliter la reconquête de régions tenues par l’EI où les Kurdes sont minoritaires ou absents ; à cet effet, elle agrège aux YPG plusieurs groupes armés arabes. L’importante progression territoriale que vont dès lors mener les FDS n’aurait pas été possible sans le soutien des États-Unis : aide logistique, livraisons d’armes, formation, appui de forces spéciales et de l’aviation. Le déploiement au sol de soldats, aux côtés des YPG, reste néanmoins assez modeste et discret ; et, si plusieurs bases américaines ont été construites au Rojava, ce sont surtout des bases opérationnelles, et seules deux sont de type stratégique et disposent de pistes d’atterrissage pour avions gros porteurs20. Le nombre de combattants des forces spéciales auprès des YPG-FDS a, lui, progressivement grimpé pour se stabiliser à 900 (auxquels s’ajoutent les militaires français et britanniques). Quelques moyens plus lourds ont complété le dispositif : une unité blindée de rangers, déployée début 2017 autour de Manbij (ville arabe conquise par les YPG) afin qu’elle ne soit plus menacée par les Turcs ; des unités de marines (génie et artillerie dans le cadre de l’offensive sur Raqqa21). En mai 2017, Donald Trump a aussi autorisé des livraisons de matériel lourd aux YPG, notamment de nombreux véhicules blindés de transport des troupes ou du génie (type de matériel jusque-là réservé aux unités arabes des FDS afin de ne pas froisser Ankara)22. Les YPG disposent désormais d’une panoplie de missiles antichars américains, russes et français, théoriquement exclus de ces livraisons d’armes.
En échange de ce soutien, qui lui permet d’atteindre ses objectifs propres, le PYD a accepté de fournir les fameuses « troupes aux sols » qui ont tant manqué aux États-Unis ; c’est à elles qu’a incombé la tâche de prendre Raqqa et de couper l’axe routier Beyrouth-Damas-Bagdad-Téhéran. Cette dernière opération a finalement été un échec pour la stratégie étasunienne, mais a néanmoins permis aux YPG-FDS de conquérir toute la rive nord de l’Euphrate et, prise non négligeable, de mettre la main sur les plus importants champs gaziers et pétroliers de la Syrie.
Le chemin de Damas
Cette nouvelle situation complique évidemment les relations entre le PYD et le gouvernement syrien. Rappelons ici que ce parti ne demande pas l’indépendance du Kurdistan syrien, mais uniquement, dans le cadre et les frontières de l’État syrien existant, l’établissement d’un fonctionnement de type fédéral offrant aux régions une large autonomie. Quels que soient les accords conclus entre eux depuis 2011 – et quoi qu’on en pense –, il a toujours été nécessaire au Rojava d’entretenir de bonnes relations avec Damas pour assurer le fonctionnement de son économie, au moins par liaison aérienne et, depuis que ç’a été à nouveau possible, par la route. Par exemple, si une part du pétrole extrait dans le canton de Djézireh est raffinée artisanalement, la plus grosse est vendue au gouvernement de Damas, qui, en retour, vend au PYD du carburant. Ces accords permettent aussi le désenclavement du canton d’Afrin et, via les zones loyalistes, une liaison routière avec les autres cantons (y compris pour les convois militaires des YPG).
Certains commentateurs et militants français préfèrent évacuer ces questions et cherchent au contraire à démontrer l’existence d’une animosité entre Damas et le Rojava, en mettant l’accent sur les quelques jours d’accrochages qui ont opposé forces loyalistes et YPG dans des villes encerclées par ces derniers (tensions rapidement apaisées grâce à la médiation russe). C’est passer sous silence la coexistence pacifique qui lie les deux armées depuis des années (parfois au sein d’une même ville) – voire leur étroite collaboration à divers moments cruciaux, le cas le plus emblématique étant celui de la conquête des quartiers orientaux d’Alep23 –, qui explique pourtant le ressentiment de beaucoup de « rebelles » à l’égard des YPG.
Néanmoins, et logiquement, la jonction AAS-FDS le long de l’Euphrate et au détriment de l’EI, à l’automne 2017, a été émaillée de plusieurs accrochages qui, les États-Unis et la Russie y veillant, sont restés sans suites.
« Et quel futur ? »
Au cours de l’année 2017, les États-Unis ont soutenu un renforcement de la composante arabe des FDS, en incorporant des recrues arabes aux YPG, mais aussi en intégrant aux FDS diverses forces opposées à Assad dans le nord-est du pays : des unités conservant l’étiquette ASL, des petites milices islamistes (y compris d’anciens alliés de la branche syrienne d’Al-Qaïda) et les groupes armés de certaines tribus. Les FDS aligneraient ainsi à l’automne 2017 environ 80 000 combattants, parmi lesquels 60 000 YPG (dont un tiers de femmes24). On voit que, si la composante kurde perd mécaniquement de son importance, elle demeure centrale.
La situation est plus complexe sur le terrain politique, car les victoires militaires des YPG et l’extension territoriale du Rojava ne sont pas sans poser problème. En effet, si dans les trois cantons initiaux, majoritairement peuplés de Kurdes, le PYD peut dominer la scène politique – en s’appuyant sur quelques petits alliés et une multitude d’associations sous son contrôle et en conservant le monopole de l’armement –, il n’en va plus de même dans les zones mixtes ou dans les zones majoritairement peuplées d’Arabes. Le PYD doit s’adapter à ses nouveaux alliés : si certains croient au modèle occidental de la démocratie, d’autres promeuvent un fonctionnement et une éthique bien peu libertaires… Les institutions implantées dans certaines villes arabes, en ruine et dépeuplées, comme Tabqa et Raqqa ont donc dû donner une place importante à des notables et à des chefs tribaux (parfois alliés à l’EI quelques jours plus tôt), mais en ont vexé d’autres25.
Autre complication : si, à la fin de 2016, le nom de Rojava (« Kurdistan occidental » en kurde) a été abandonné au profit d’une « Fédération démocratique de la Syrie du Nord » afin de ne pas froisser les minorités arabes26, l’extension territoriale a aussi modifié la composition démographique de cette entité administrative, et les Kurdes n’y sont probablement plus majoritaires. Les récents combats ayant vidé de leur population de nombreuses localités, il est impossible de savoir combien d’habitants survivent aujourd’hui sur ce territoire, mais on comprend que le retour des réfugiés représente désormais un enjeu politique27. Les combattants YPG se trouvent donc dans une situation pour le moins inconfortable28… D’autant que s’y ajoute une autre question, celle du service militaire obligatoire, d’une durée de neuf à dix mois pour au moins un membre de chaque famille. Déjà présent dans les cantons kurdes, il s’étend progressivement en 2017 aux autres régions contrôlées par les YPG : l’état-major a en effet annoncé vouloir dépasser la barre des 100 000 combattants d’ici à la fin de l’année29. Les YPG incorporent donc de plus en plus de jeunes Arabes, dont beaucoup ont participé aux combats de Raqqa – l’encadrement et les officiers demeurant évidemment kurdes. En novembre ont ainsi eu lieu des manifestations contre la conscription autour des villes de Tabqa et de Manbij, accompagnées d’une grève des commerçants, événements qualifiés par les YPG de manipulations des services turcs et syriens30.
L’histoire récente nous a montré qu’une armée qui apporte la démocratie dans un territoire sans y avoir été formellement invitée peut rapidement devenir pour sa population une armée d’occupation. C’est bien ce qui risque d’arriver aux YPG dans les zones majoritairement arabes. D’ores et déjà, Ankara joue de son influence dans la région et appuie des mouvements de protestation arabes contre l’autorité kurde qui pourraient fort bien, dans un futur proche, prendre la forme d’une guérilla islamiste et d’attentats. Il est donc probable que le PYD devra progressivement se replier sur les régions de peuplement kurde et rétrocéder certaines villes (ainsi que les principaux champs pétroliers) aux autorités de Damas ou à une administration intérimaire sous autorité américaine.
Dans ces conditions, à quoi ressemblera le Rojava dans les prochaines années ? Qu’on se rassure, la livraison d’armes et de blindés n’a sans doute été qu’une partie du marché conclu ; Washington s’est très probablement engagé à soutenir un processus de fédéralisation de la Syrie et la constitution d’une région kurde, donc à maintenir, ne serait-ce que symboliquement, une présence militaire sur place. Mais combien de temps ? Car, sans protecteur, le Rojava se retrouverait en mauvaise posture entre Damas et Ankara. À moins de trouver un remplaçant31. La Russie est bien là, qui soutient elle aussi la vision fédérale du PYD, place le canton d’Afrin sous sa protection (en y déployant les blindés de sa police militaire) et joue les facilitateurs avec le gouvernement de Damas. Mais elle reste avant tout l’allié de ce dernier. La création d’une Syrie fédérale et d’une région du Nord bénéficiant d’une large autonomie est peut-être en bonne voie – avec, à terme, une situation semblable à celle du Kurdistan irakien. Le système politique qui y régnera sera sans doute encore longtemps loin des schémas occidentaux, mais plus encore, d’une « utopie libertaire ».
« Et quelle société ? »
Dans les milieux d’extrême gauche occidentaux, même les derniers admirateurs de « l’utopie libertaire » du Rojava doivent reconnaître « l’aspect étatique » de cette « expérience », ses « institutions protoétatiques », le poids du PYD, le service militaire obligatoire, le culte du chef, le respect de la propriété privée, etc.32 Ils gardent malgré tout l’espoir qu’avec le temps la situation puisse évoluer positivement. En attendant, on parle beaucoup de ces communes que le PYD met en place dans les villages et les quartiers. Pourtant, loin des conseils ouvriers, elles sont surtout des conseils de quartier aux pouvoirs limités, consultatifs, et au rôle de médiateurs judiciaires de première instance. Le reste du fonctionnement politique et administratif, semble-t-il très bureaucratique, est, lui, calqué sur les institutions démocratiques occidentales – ce qui, il est vrai, est une nouveauté en Syrie.
Le régime en place au Rojava annonce aussi une « volonté de défendre une forme d’organisation de la société respectueuse de l’égalité hommes femmes et de la diversité linguistique33 » et « une société fraternelle, démocratique, écologique et émancipatrice pour tous sans distinction de genre, d’ethnie ou de confession34 ». C’est très bien, tout comme l’instauration de l’égalité hommes/femmes dans tous les domaines. Mais n’est-ce toutefois pas un peu exagéré de qualifier ces principes de « révolutionnaires » ? Et, lorsqu’on précise « pour des sociétés patriarcales35 », faut-il comprendre « pour ces gens-là » ? Car nous ne voyons pas très bien en quoi des « révolutionnaires » auraient à soutenir et encenser un tel processus, sauf à croire, dans un élan orientaliste à rebours, que c’est très bien pour eux, ou à penser (peut-être à la suite de récentes découvertes théoriques) que l’établissement d’une démocratie parlementaire sur le modèle occidental est désormais une étape indispensable pour une future révolution sociale.
Si la confusion était possible en 2014, il est incompréhensible qu’en 2017 certains décèlent au Rojava une expérience « révolutionnaire », « libertaire », voire « autogestionnaire ». Nous n’y reviendrons pas. Le mot « révolution » a largement été galvaudé dans le langage courant, au point de ne plus avoir de sens politique précis. Il semble qu’il en aille désormais de même dans les milieux d’extrême gauche ou anarchistes, où ce mot est de plus en plus souvent synonyme d’évolution vers davantage de démocratie. En sus de perdre des batailles, si nous perdons les mots, c’est l’utopie elle-même qui se trouve amoindrie.
En Irak, case départ ?
Lancée en octobre 2016, la bataille pour reprendre à l’EI la ville de Mossoul s’est officiellement terminée en juillet 2017, entraînant de très lourdes pertes dans les rangs des forces irakiennes, des dizaines de milliers de morts, et sans doute autant parmi les civils. Les deux tiers des 1,5 million d’habitants ont fui les combats et les bombardements. D’un point de vue humanitaire, cette bataille n’a rien à envier à celle d’Alep. Le reste du pays a été progressivement repris, à la suite de violents combats, par une armée irakienne reconstituée – après la débâcle de 2014 – et par une foultitude de milices. Les plus dynamiques de ces dernières sont les Hachd al-Chaabi, « Unités de mobilisation populaire » (UMP) : une coalition de dizaines de milices majoritairement chiites (avec quelques exceptions sunnites ou chrétiennes). Si certaines avaient participé à la lutte contre l’occupation américaine après 2003, la plupart se sont constituées durant l’été 2014, à la suite d’une fatwa lancée par le grand ayatollah Ali al-Sistani. Alors que l’armée régulière peinait à recruter, les UMP ont vu affluer des milliers de volontaires, principalement des jeunes chômeurs. Fortes d’environ 100 000 hommes, elles ont participé à tous les combats, y compris dans les zones et localités sunnites (sauf à l’intérieur de Mossoul).
Bien que fortement soutenues par l’Iran, les UMP n’ont pas d’unité politique, sinon un fort nationalisme irakien, et sont divisées en plusieurs factions, dont les chefs joueront certainement un rôle politique à l’avenir36. Même si certains, comme le leader chiite Moqtada al-Sadr (qui cherche le soutien des populations sunnites37), y ont appelé, il est peu probable que l’on procède à leur démantèlement, notamment parce que, depuis trois ans, elles sont une source de revenus pour des dizaines de milliers de familles chiites.
Beaucoup pensaient que le Kurdistan irakien sortirait victorieux de ce conflit qui lui avait permis de prendre le contrôle de zones abandonnées par l’armée irakienne en 2014 ou reprises à l’EI, notamment la ville de Kirkouk et sa zone pétrolière. C’était oublier que cette région était divisée entre deux clans rivaux (l’un lié à Ankara, l’autre se tournant vers Téhéran), gangrenée par la corruption et le népotisme, conséquences d’une économie fondée sur la rente pétrolière. Le référendum d’indépendance de septembre 2017 était sans doute un moyen de faire monter les enchères avec Bagdad, mais il a rencontré une hostilité internationale unanime : feu vert pour les UMP, qui n’ont mis que quelques jours à reprendre le contrôle des territoires disputés… la débandade des peshmergas empâtés a entraîné pour le Kurdistan la perte de 50 % de ses revenus pétroliers et le report sine die de l’indépendance.
L’Irak est-il revenu au statu quo ante de 2013 – domination de chiites arrogants et marginalisation des sunnites –, celui qui avait prévalu à la naissance et au succès de l’EI ? À peu de chose près. Mis à part que les Kurdes, affaiblis, ne pourront plus contrebalancer ce déséquilibre.
Mis à part que le pouvoir chiite, en sus de l’aide américaine, bénéficie désormais d’un fort soutien de Téhéran et, dans une moindre mesure, de Moscou.
Mis à part que le pays n’a jamais été si ravagé par la guerre (des centaines de milliards de dollars seraient nécessaires pour sa reconstruction, un milliard pour la seule ville de Mossoul).
Mis à part que le pays regorge toujours de ce pétrole qui, avant l’épisode califal, était exporté à 60 % vers l’Asie et à 20 % vers le marché américain et le reste de l’Europe.
Mis à part que, d’ores et déjà, des groupes islamistes sunnites ont déclaré qu’ils mèneraient la guérilla contre les troupes américaines et l’armée de Bagdad.
Reconstruction de la Syrie
Une large partie de la Syrie est en ruine, et son économie, dans un état désastreux, aurait fait un bond de trente ans en arrière, avec un PIB diminué de 55 % entre 2010 et 2015 et un secteur industriel réduit de moitié par les destructions et les vols38. La reconstruction du pays coûterait des centaines de milliards de dollars. Détruit ou endommagé, tout est à reconstruire – deux millions de logements, des milliers d’écoles, des dizaines d’hôpitaux, les routes, les réseaux d’eau et d’électricité, etc.
Ce n’est pourtant pas parce qu’un pays ou une région est en ruine qu’il doit être reconstruit. Et par qui ? Pourquoi ? Le gouvernement syrien ne le fera pas par générosité, il en a besoin pour restaurer son autorité et un semblant de paix sociale, et les régions qui se sont révélées les plus hostiles à lui ne recevront pas une attention prioritaire. Les intervenants extérieurs ne sont pas plus philanthropes, on le voit bien à Raqqa : l’aviation occidentale a rasé la ville, et les YPG l’ont conquise ; mais qui va payer, ne serait-ce que pour y rétablir l’eau ou l’électricité ? (D’autant qu’on ne sait qui contrôlera la ville dans un an.)
L’idée de reconstruction à grande échelle ne devient vraiment crédible pour le gouvernement syrien qu’à partir de l’intervention russe, en septembre 2015. Car on comprend que, avec ou sans Assad, ce pouvoir restera en place ; la conquête des quartiers est d’Alep, en décembre 2016, l’a confirmé aux sceptiques. Pour les proches du régime, enrichis grâce à l’économie de guerre, il s’agit de se préparer au retour de la paix, donc à refaire des affaires as usual – certains voyant dans ce champ de ruines l’opportunité de poursuivre les réformes libérales entamées avant 2011. Dans cette perspective, l’État syrien a procédé à des adaptations législatives favorisant le partenariat public-privé et les privatisations39. Il s’agit aussi de faire revenir les patrons syriens qui ont installé leurs activités dans d’autres pays de la région au début du conflit, notamment les industriels du textile, qui exploitent actuellement de la main-d’œuvre égyptienne40.
Le signe le plus frappant de cette reconstruction annoncée, qui n’est donc que le prolongement de l’avant-guerre par d’autres moyens, est celui de l’aménagement urbain : on voit fleurir de spectaculaires projets, qui ne sont parfois qu’une resucée de plans antérieurs au conflit, lesquels avaient contribué au mécontentement de la population, comme le rêve du maire de Homs de transformer sa ville en un Las Vegas oriental. Il s’agit soit de rénover les centres-villes endommagés, soit, comme c’est le cas le plus souvent, de restructurer les vastes « quartiers informels » des périphéries, où résidait le prolétariat précaire en provenance des campagnes et d’où est partie la révolte de 2011. Beaucoup de ces quartiers ont été le théâtre d’âpres combats et sont désormais réduits à des champs de ruines… Idéal pour faire table rase et implanter des ensembles immobiliers où loger les classes moyennes et la bourgeoisie restées fidèles au régime41. La guerre facilite la gentrification.
Se pose toutefois la question du financement. Ni l’État syrien – dont les caisses sont vides et l’endettement, fortement accru (surtout auprès de l’Iran et de la Russie) – ni les acteurs privés locaux ne pourront l’assumer complètement. D’où, dans le cadre des réformes libérales, la recherche d’investissements étrangers. Persistance d’une certaine insécurité, capitalisme des copains, magouilles et corruption restent évidemment des freins – on fait donc beaucoup de projets –, mais n’empêchent pas le gouvernement syrien de redoubler d’efforts. Conventions et forums professionnels internationaux dédiés à la reconstruction se succèdent à Damas comme à l’étranger (Beyrouth, Aman ou Pékin en 2017), occasions de rencontrer de potentiels partenaires ou investisseurs venus de Russie ou d’Iran, mais aussi de Jordanie, de Biélorussie, d’Afrique du Sud, d’Inde, de Malaisie voire de pays du Golfe et d’Irak42. Le Brésil est, lui, en train de rétablir des relations diplomatiques avec Damas pour obtenir des marchés. Quant au Liban, il est aux premières loges : les patrons du BTP espèrent profiter de son expérience43, et le pays se rêve en porte d’entrée pour les chantiers de Syrie via la zone économique spéciale de Tripoli – en cours de construction, elle prévoit agrandissement du port, construction d’autoroutes et réactivation du réseau ferroviaire (détruit pendant la guerre civile libanaise). Les Européens, entravés par les sanctions économiques de l’UE, sont quasiment absents de ces discussions. Bachar al-Assad a d’ailleurs déclaré en août, sans surprise, que les pays qui avaient aidé les « terroristes » (entendez les pays occidentaux et ceux du Golfe qui ont financé les groupes islamistes armés) seront exclus du partage du gâteau de la reconstruction. Les géants français du BTP hériteront au mieux de niches inoccupées, comme la reconstruction du patrimoine historique, financée par l’Unesco44. Damas privilégie les pays émergents (qui ont su faire de preuve de neutralité), la Chine et, en premier lieu, la Russie et l’Iran. Pour ces trois derniers pays, la Syrie représente, outre de possibles marchés commerciaux, une zone stratégique entre l’Asie et l’Europe, notamment pour le passage des hydrocarbures.
En avril 2016, la Russie a signé avec la Syrie un premier contrat d’environ un milliard de dollars pour relancer l’énergie, les infrastructures, le commerce, la finance et d’autres secteurs économiques. Les entreprises russes ont déjà pris des positions dans le secteur des hydrocarbures (une des plus faibles productions de la région) et ont entamé, dès septembre 2015, l’exploration des réserves offshore de gaz et pétrole du pays.
Le poids économique de l’Iran en Syrie est, lui, croissant, notamment depuis la perte des champs pétrolifères de l’est du pays en 2013, qui a obligé Damas à se fournir en hydrocarbures auprès de Téhéran. Les signatures d’accords de crédits entre les deux pays se succèdent (notamment pour l’importation de pétrole iranien), souvent en contrepartie de contrats d’investissements très favorables à l’Iran, dans le secteur minier (le phosphate), le BTP, les télécommunications ou la vente de terres agricoles45. À noter que les particuliers iraniens (en particulier les militaires) profitent de la crise pour acheter terrains et résidences secondaires à Damas46.
Pékin a toujours discrètement soutenu le gouvernement de la Syrie, pays où elle avait commencé à investir avant-guerre, notamment dans les hydrocarbures. Les entreprises chinoises n’ont jamais cessé de travailler dans le pays (en 2013, elles équipaient en fibre optique les territoires tenus par le régime). Bien que très courtisée par Damas du fait de ses capacités de financement et des performances de ses entreprises, la Chine reste prudente47 (notamment à cause des sanctions économiques et bancaires). Un autre frein réside dans la faiblesse des ressources naturelles syriennes, qui, mis à part les hydrocarbures du Nord-Est (tenus par les YPG), sont déjà aux mains des Russes et des Iraniens, et contre lesquelles Pékin échange généralement ses investissements. On évoque néanmoins des projets dans le solaire. Reste qu’à long terme la Syrie s’inscrit parfaitement dans le projet chinois de construction des « routes de la soie » (corridor routier, ferroviaire et énergétique), qui doivent relier l’Extrême-Orient à l’Europe. Un premier projet d’investissement, de deux milliards de dollars, a toutefois été annoncé en juillet 2017 pour la création d’un parc industriel où déployer, dans un premier temps, quelque 150 entreprises chinoises48 et où travailleraient 40 000 ouvriers syriens.
Demain
Ouvriers et prolétaires semblent très absents de ce texte. Mais, comme nous avons pu l’écrire auparavant, « nous en parlons en fait depuis le début, mais sous la forme de chair à canon » – centaines de milliers de combattants qui s’entre-tuent à travers la Syrie. Une minorité trop active qui fait la guerre au milieu d’une majorité qui la subit.
Sur les 22 millions d’habitants que comptait la Syrie en 2011, six millions ont fui à l’étranger et sept millions ont été déplacés à l’intérieur du pays (ce qui équivaudrait à 18 et 21 millions d’habitants pour la France). Pour la première fois, depuis le début de l’année, on observe un flux de retour des réfugiés vers leur foyer, près de 600 000 en août (à 80 %, des déplacés internes49). Des retours qui s’effectuent à mesure que Damas restaure son autorité sur les zones jusqu’alors tenues par les groupes islamistes ou l’EI. Le régime est certes toujours une dictature, mais il ne bombarde pas les zones qu’il contrôle, ce qui, dans la phase actuelle du conflit et pour les populations qui y vivent, constitue un avantage certain. S’il est peu probable que les réfugiés partis en Europe ou en Amérique du Nord, notamment ceux issus de minorités (les chrétiens), retournent un jour dans leur pays, ce sera sans doute le cas des plus pauvres, ceux qui vivent dans des conditions très précaires en Turquie, au Liban ou en Jordanie. Mais, si la sécurisation et la désescalade militaire vont croissant, l’état catastrophique de l’économie du pays et l’ampleur des destructions restent des freins au retour. Le taux de chômage atteignait 60 % en 2016, et celui des jeunes, 78 % en 201550 – d’où l’intérêt du métier des armes. C’est désormais 83 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, contre un tiers en 2010. On comprend que la lutte des classes soit au point mort.
Nous évoquions en introduction un prolétariat docilisé par des pluies de bombes et de ruines. Mais s’y ajoute le fait qu’il a été divisé, confessionnalisé et communautarisé par la guerre civile. Un état appelé à perdurer, même si un vaste processus de reconstruction s’enclenchait, car la Syrie ne dispose pas d’assez de capacités économiques et industrielles, ni d’assez de soutiens financiers extérieurs pour entamer une période de Trente Glorieuses débouchant sur le plein emploi et, hypothétiquement, sur l’affirmation d’un prolétariat qui serait alors en position de force…
Le départ de 6 millions de Syriens et la mort de peut-être 500 000 autres ne règlent pas les questions que l’État devait affronter avant-guerre (trop forte croissance démographique, fort taux de chômage des jeunes) et qui avaient joué dans le déclenchement de la révolte. Car le pays est en ruine, et l’armée de réserve des travailleurs déjà bien nombreuse. Qu’en sera-t-il à plus long terme ? Bien que le capital réserve parfois d’étranges surprises aux travailleurs, la Syrie n’a pas encore besoin de recourir à une main-d’œuvre immigrée… sauf en ce qui concerne les travailleurs qualifiés, qui ont massivement émigré en Europe (par exemple, ceux du secteur hospitalier et sanitaire), d’autant que la formation professionnelle en Syrie est perturbée ou interrompue depuis six ans ; idem pour les postes très qualifiés comme ceux d’ingénieurs. De ce point de vue, la question du chômage des jeunes diplômés, épineuse en 2011, est résolue. Mais, sans reconstruction et investissements étrangers majeurs, le pays est condamné à demeurer une terre d’émigration.
Tout ça pour ça ? Comme si le stupéfiant et inadmissible épisode califal et les années de guerre civile en Syrie n’avaient servi à rien, sinon à modifier quelques zones d’influences, rebattant les cartes d’alliances et préparant les futurs conflits. Le grand jeu habituel.
Quelles leçons tirer de cette catastrophe que nous ne connaissions déjà ? La guerre est une catastrophe, en premier lieu pour les prolétaires qui la subissent et la font, la guerre civile y ajoutant ses atrocités51. Était-il nécessaire de le préciser ?… Que le maniement des armes, en tant qu’activité séparée, étouffe toute expression de la lutte des classes ? Mais que cela n’empêche pas les prolétaires d’être particulièrement actifs ? – les bannières les plus mobilisatrices n’étant malheureusement pas pour l’instant les plus émancipatrices. Que les questions confessionnelles, ethniques et nationales sont au centre des discours (que ce soit de manière exclusive ou inclusive) au détriment des véritables enjeux et, surtout, des intérêts des populations ?
Que dire de plus sans se répéter ni paraître trop négatif52 ? Dans ce chaos, et en particulier dans la guerre civile syrienne, il y a une chose à voir et qui crève les yeux tant elle est partout : c’est justement tout ce que la révolution n’est pas ; que ce soit en matière d’auto-organisation, de survie, d’activité militaire, d’alternatives, d’utopies protoétatiques, etc. Il n’y a pas de modèle à y trouver, ni d’ailleurs de contre-modèle. La révolution ne sera certes pas un dîner de gala53, loin de là, mais elle ne ressemblera pas à ces ignobles guerres civiles dont le capitalisme contemporain a le secret ; voilà un point positif.
Tristan Leoni, décembre 2017
Note additionnelle sur la question des sources
Il nous a été reproché à plusieurs reprises d’utiliser des sources qui ne devraient pas l’être, par exemple Le Figaro ; des remarques qui sous-entendent que Libération – par exemple – parce que « de gauche », serait une source d’information beaucoup plus fiable. Oui, nous l’avouons, nous lisons des journaux et consultons des sites avec lesquels nous ne sommes pas en accord politique. Heureusement. Il serait difficile d’écrire de tels articles, n’importe quel article, ou même de réfléchir, en ne lisant que la presse militante (laquelle d’ailleurs ?). Nous savons aussi qu’une info trouvée sur un site influencé par la Russie, l’Iran ou le Qatar n’a quasiment aucune valeur sous nos cieux (il faut tenter de la trouver ailleurs ou l’oublier), alors que telle autre, trouvée dans Le Monde, paraîtra estimable.
Signaler nos sources afin que chacun puisse s’y reporter, se faire un avis, éventuellement différent du nôtre, nous paraît important ; nous le faisons sans doute trop, mais pas assez pour certains (on peut toujours contacter l’auteur pour en savoir plus). Quant à ceux qui croient que faire référence à un article paru dans Les Échos c’est prêter allégeance au Medef, on devine qu’ils lisent assez peu. Nous leur signalons néanmoins avoir déjà cité des infos tirées de : Atlantico, Le Figaro, Le Monde, Le Crieur, L’Express, Le Commerce du Levant, CQFD, Le Point, RTL, RFI, L’Orient le Jour, Échanges, Orient XXI, Le Temps, Le Nouvel Observateur, Les Échos, Raids, Afrique-Asie, Sciences humaines, Libération, Marianne, Vice News, France 24, Financial Times, Politique étrangère, RMC, France culture, Diplomatie, Le Monde diplomatique, TV5 Monde, etc. Auxquels il convient d’ajouter Dar al-Islam, la revue francophone de l’EI.
Tel mauvais coucheur peut donc aisément y trouver une source qui ne lui convient pas et qui confirme ce qu’il pense de l’article avant de l’avoir lu… quant à critiquer un texte avec ce seul angle d’attaque, cela montre que, sur le fond, on n’a rien à dire. Mais il est vrai que désormais les mots n’ont plus de sens, et que, dans une démarche quasi ésotérique, il s’agit de déconstruire les textes pour en découvrir le sens caché et, surtout, les intentions (parfois inconscientes) de l’auteur. Dire que, à une autre époque, pour comprendre un texte, il suffisait de le lire – son auteur s’étant même appliqué, avec plus ou moins de bonheur, à choisir les mots à cet effet…
NOTES :
1Cet article est la suite d’une série d’articles : « Califat et barbarie » (première et deuxième partie en décembre 2015) et « En attendant Raqqa » (juillet 2016). Certaines questions y ont été traitées précédemment (comme ici le passage d’une contestation sociale à une guerre civile faisant intervenir des acteurs internationaux). On s’y reportera donc.
2Les aviations russe et syrienne ont fait de même dans la région d’Idlib afin que ne se mettent pas en place de telles structures.
3L’EI était-il dirigé par la frange modérée du mouvement ? En tout cas, une tendance extrémiste existait au sein du Califat, mais, minoritaire, elle est restée dans « l’opposition » et, en 2017, fut même réprimée. Romain Caillet, « Les dissidents radicaux de l’État islamique », blog Jihadologie sur liberation.fr, 8 juin 2017.
4Romain Caillet dans L’Invité des matins, France culture, 1er novembre 2017.
5Michel Goya, « Syrie : le modèle de l’intervention russe », DSI, no 132, novembre-décembre 2017, p. 70-73.
6Les États-Unis et leur allié jordanien soutiennent néanmoins les groupes, principalement étiquetés ASL, qui contrôlent la zone longeant la frontière avec la Jordanie et le Golan.
7La moitié des habitants de cette zone sont des réfugiés dont la présence est un enjeu. Ankara veille à ce qu’ils puissent y bénéficier d’une aide humanitaire et n’aient pas besoin de passer la frontière. HTC en est conscient et mène avec la Turquie le jeu que celle-ci mène avec l’UE. Les camps de réfugiés sont aussi un lieu de recrutement idéal.
8Delphine Minoui, « Syrie : au cœur de la province d’Idlib, un fragile îlot de résistance », Le Figaro, 27 juillet 2017.
9Tristan Leoni, « Califat et barbarie : En attendant Raqqa », juillet 2016.
10La surprenante longueur de certains sièges s’explique par les spécificités de cette guerre civile : les intérêts financiers, les liens familiaux, claniques ou tribaux, la corruption et la sociologie du checkpoint font que, par exemple, les échanges économiques et commerciaux perdurent entre régions rebelles assiégées et territoire loyaliste.
11Syrian War Report, 7 septembre 2017.
12Trois axes routiers relient la Syrie et l’Irak : le premier, au nord, traverse les bastions des YPG ; le second, à Al-Tanf, au sud, est occupé par l’armée américaine ; le troisième, à Abou Kamal, au centre, est tenu par l’EI.
13Danyves, « L’Est syrien, enjeu véritable des quatrièmes négociations d’Astana pour la paix en Syrie », blog de Danyves, Mediapart, 18 mai 2017.
14Est-il nécessaire de préciser que le fait d’évoquer les actions d’une organisation politico-militaire (le PYD-YPG, qui ne représente qu’une partie des Kurdes de Syrie, sans doute une minorité), ce n’est pas « critiquer les Kurdes », le « peuple kurde » ou le prolétariat kurde ? Nous ne développons pas ici tous les points qui, concernant le Rojava, l’avaient été dans notre article précédent, « Califat et barbarie : En attendant Raqqa », dans la « Lettre à des amis rojavistes » (mai 2016) et dans « Kurdistan ? » (janvier 2015).
15Sans doute est-ce l’utilisation par Damas d’armes chimiques qui autorise les Occidentaux à bombarder Raqqa ou Tabqa avec des obus au phosphore blanc, munitions interdites par toutes les conventions internationales… Luc Mathieu, « À Raqqa, des obus au phosphore blanc », Libération, 11 juin 2017.
16Luke Mogelson, « Dark Victory in Raqqa », The New Yorker, 6 novembre 2017.
17Ce type d’accord est d’une grande banalité dans le conflit syrien, mais, les médias étant alors concentrés sur Raqqa, il a provoqué stupeur et incompréhension ; les conspirationnistes y voyant même la preuve de la collusion entre l’EI et Washington.
18Antoine Hasday, « À Raqqa, les tribus arabes accepteront-elles un pouvoir kurde ? », Slate.fr, 11 juillet 2017.
19Andrew J. Tabler, Eyeing Raqqa. A Tale of Four Tribes, The Washington Institute, mars 2017, p. 7-8.
20En juillet 2017, la Turquie avait cherché à gêner Washington en divulguant, via l’agence de presse Anadolu, la localisation et les effectifs de douze bases américaines installées au Kurdistan syrien (l’une d’entre elles accueillait les éléments des forces spéciales françaises).
21Alexandre Alati, « Objectif Raqqa. Les moyens d’appui US en Syrie », Raids, no 375, octobre 2017, p. 48-57. Fin novembre, le retrait d’un bataillon de marines a été annoncé, voir Laurent Lagneau, « L’EI ayant été défait à Raqqa, plus de 400 militaires américains vont quitter la Syrie », opex360.com, 30 novembre 2017.
22Laurent Lagneau, « Le président Trump approuve la livraison d’armes aux milices kurdes syriennes », opex360.com, 10 mai 2017.
23La fermeture du corridor d’Azaz, en février 2016, par une offensive conjointe de l’AAS, du Hezbollah et des YPG contre les « rebelles », peut être considérée comme les prémices d’un étouffement de la ville, dont il était un important axe de ravitaillement. À Alep, en juillet, c’est depuis le quartier kurde de Sheikh Maqsoud que les YPG vont aider les troupes de Damas à couper la route stratégique du Castello, dernière voie de ravitaillement des quartiers rebelles, dès lors complètement encerclés et qui seront progressivement reconquis par l’AAS.
24Des combattantes parfois regroupées au sein d’unités spécifiques, les YPJ, dont il est difficile de déterminer le réel poids tant il a été médiatisé par les chargés de com du PYD (puis par les presses bourgeoise et militante occidentales). Un œil un minimum attentif remarquera que, si les femmes YPG-YPJ sont massivement présentes lors des cérémonies, points presse et reportages de journalistes accrédités à l’arrière du front (généralement dans des uniformes propres), elles sont beaucoup plus rares sur les images tournées au cœur des combats.
25« Syrian Kurds face fresh test ruling Arab regions after Isis », Financial Times, 30 novembre 2017.
26Le mot « Rojava » ne serait-il utilisé que par les Occidentaux ? Le serment de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord est le suivant : « Au nom de Dieu tout puissant et du sang des Martyrs, je jure de respecter le Contrat social et ses articles, de préserver les droits démocratiques des peuples et les valeurs des Martyrs, de protéger la liberté, la sécurité et la paix des régions de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord, de préserver l’unité de la Syrie, et de travailler à atteindre la justice dans la société en accord avec les principes de la nation démocratique. »
27Fabrice Balanche, « Un Kurdistan indépendant peut-il vraiment émerger du chaos syrien ? », Le Figaro, 26 août 2016.
28En octobre, l’interdiction faite aux habitants de Raqqa de retourner dans leur ville a entraîné des manifestations dans les camps de réfugiés. Elle était motivée par des questions de déminage et par des nécessités policières, car les YPG (aidés des services occidentaux) devaient repérer, parmi les civils lambda, les partisans, fonctionnaires ou combattants de l’EI. Au bout de trois semaines, les premiers habitants ont été autorisés à rentrer chez eux. Néanmoins, vu l’état de Raqqa et l’impréparation dans la gestion des réfugiés, il est probable que des dizaines de milliers d’entre eux passent l’hiver dans des camps faits de tentes.
29Tom Perry, « Syrian Kurdish YPG aims to expand force to over 100 000 », Reuters, 20 mars 2017.
30Si, comme c’était le cas dans les années 1970-1980, il existait en France un discours antimilitariste, les militants des organisations ad hoc s’intéresseraient à ces événements. Car parmi les milliers de migrants originaires de Syrie qui ont trouvé refuge en Europe se trouvent, de fait, beaucoup de déserteurs ou réfractaires à la conscription, qu’ils soient de zone loyaliste ou kurde. Même l’OFPRA, dans les documents qui lui servent à étudier le parcours des réfugiés, a relevé l’instauration du service militaire obligatoire dans les cantons kurdes, voir OFPRA-DIDR, Conflit syrien. Les régions kurdes de Syrie, chronologie et bibliographie, OFPRA, 29 janvier 2016.
31D’aucuns évoquent l’Arabie saoudite, à condition que les YPG restent une épine dans le pied de ses adversaires (Turquie, Iran, Qatar). Alain Rodier, « Iran : pourquoi Téhéran tient ses Kurdes ? », Note d’actualité, no 482, CF2R, 6 septembre 2017, et Aron Lund, « Winter is coming : Who will rebuild Raqqa ? », irinnews.org, 23 octobre 2017.
32« Entretien avec Pierre Bance », Le Comptoir [comptoir.org], 20 octobre 2017.
33Groupe d’amitié France-Syrie du Sénat, « Entretien avec M. Khaled Issa, représentant du Rojava en France », juin 2016.
34Page « Le contrat social » sur le site de la représentation du Rojava en France, rojavafrance.fr.
35« Entretien avec Pierre Bance », op. cit.
36« Milices chiites, principale menace de l’après-Daech ? », Cultures monde, France culture, 7 novembre 2017.
37Il s’agirait pour lui de limiter l’influence de l’Iran quitte, éventuellement, à se rapprocher de l’Arabie saoudite. Tim Kennedy, « Rééquilibrer les liens avec l’Irak », Arabies, no 367, novembre 2017, p. 34-39.
38Voir le chapitre « Une économie en lambeaux » dans « Califat et barbarie : En attendant Raqqa », et, pour des chiffres actualisés, William Plummer, Isabelle de Foucaud, « Le désastre de l’économie syrienne après six ans de guerre », Le Figaro, 7 avril 2017.
39 Benjamin Barthe, « Reconstruction en Syrie : les entreprises acquises au régime favorisées », Le Monde, 3 avril 2017.
40L’Égypte, qui ne compte pas laisser partir ces investisseurs, a annoncé la construction d’une zone industrielle dédiée aux entrepreneurs syriens qui devrait regrouper 70 à 80 entreprises de divers secteurs, notamment le textile, l’alimentation et les produits pharmaceutiques. « Ministry of trade studies launching Syrian industrial zone in Egypt », Al-Bawaba Egypt, 4 avril 2017.
41Tom Rollin, « Syria’s reconstruction plans take shape », al-monitor.com, 22 mai 2017.
42Mohammed Ghazal, à Amman, « Les promoteurs arabes réfléchissent à la reconstruction de la Syrie », almashareq.com, 10 août 2017.
43Certains ont pris de l’avance, comme ce cimentier beyrouthin qui, dès 2012, achetait un terrain et construisait un dépôt à Homs pour être en bonne place le jour J. Philippine de Clermont-Tonnerre, « Syrie : le Liban aux avant-postes de la reconstruction », TV5 Monde, 17 septembre 2016.
44Alexis Feertchak, « Pour sa reconstruction, la Syrie se tourne vers l’Asie », Le Figaro, 12 septembre 2017.
45Jihad Yazigi, « Les pénuries mettent en lumière la fragilité syrienne », Le Commerce du Levant, mars 2017.
46Renaud Toffier, Syrie, Irak : le temps de la reconstruction, lefigaro.fr, 9 août 2017, 17 min.
47Jihad Yazigi, « La Chine hésite à développer sa relation économique avec Damas », Le Commerce du Levant, août 2017.
48« China to Invest US$2 Billion in the Reconstruction of Syria », chinascope.org, juillet 2017.
« The New Silk Road will go through Syria », Asia Times, 13 juillet 2017.
49« Syrie : mouvement de retour de réfugiés et de déplacés depuis le début de l’année », RFI, 1er juillet 2017, « Syrie : plus de 600 000 Syriens sont rentrés chez eux depuis janvier », Europe 1, 14 août 2017.
50Syria at War, Five Years On, ESCWA and University of St Andrews, 2016.
51Et si, dans l’histoire, des guerres interétatiques ont pu donner lieu à de grands mouvements prolétariens (Commune de Paris, révolutions russes de 1905 et 1917), jamais ce ne fut le cas des guerres civiles. On pouvait rêver d’une Commune de Bagdad en 2003, pas d’une Commune de Mossoul en 2017.
52Notamment par rapport à la conclusion de notre précédent article que nous pourrions en grande partie reproduire ici. Voir « Califat et barbarie : En attendant Raqqa », juillet 2016.
53Sur cette question, voir Les Amis de 4 millions de jeunes travailleurs, Un monde sans argent : le communisme, 1976 ; Bruno Astarian, Activité de crise et communisation, 2010 ; Gilles Dauvé, De la crise à la communisation, Entremonde, 2017, 176 p.
Comments
https://www.autistici.org/tridnivalka/califat-et-barbarie-la-lutte-finale/
Nous estimons que cet article, malgré sa forme quelque peu « académique » et son style « objectiviste » (multiples références journalistiques sensées lui donner un vernis de « sérieux »), compile et synthétise toute une série d’informations importantes et de lectures diverses, et il représente également un grand intérêt pour les nombreuses discussions militantes au niveau international sur les évolutions de ces dernières années du front politico-militaire de la « guerre civile en Syrie » et de la très médiatique « guerre contre le terrorisme » et « contre l’État Islamique » en particulier.
Nous n’avons à ce jour ni la force, ni le temps et l’énergie militante pour traduire la totalité de ce texte en anglais, en tchèque ou en espagnol (par exemple), mais nous tenons cependant à affirmer ici notre farouche volonté à centraliser toute initiative émanant de camarades capables d’assumer avec nous cette tâche de traduction dans ces langues ou dans d’autres encore. Nous lançons donc un appel et proposons déjà la traduction dans plusieurs langues d’un petit extrait de ce texte, plus spécifiquement axé sur la critique des illusions vis-à-vis de ladite « Révolution du Rojava » et de ses structures politico-militaires toujours plus fortement intégrées aux dispositifs militaires étatiques : fournitures d’armements par les USA, coordination des campagnes militaires avec les USA, la Russie et la Syrie, construction de bases militaires américaines, présence de troupes des forces spéciales occidentales au sein de la coordination des milices rojavistes, etc.
L’article a été initialement publié à l’adresse suivante :
https://ddt21.noblogs.org/?page_id=1906
L’article est également disponible en PDF au format A4 :
https://ddt21.noblogs.org/files/2017/12/Califat-et-barbarie-La-Lutte-finale.pdf
Les trois articles précédents de la série « Califat et barbarie » sont disponibles aux adresses suivantes :
« Califat et barbarie » première partie (décembre 2015) :
https://ddt21.noblogs.org/?page_id=667
« Califat et barbarie » deuxième partie (décembre 2015) :
https://ddt21.noblogs.org/?page_id=728
« Califat et barbarie : En attendant Raqqa » (juillet 2016) :
https://ddt21.noblogs.org/?page_id=1030

As we do regularly with texts which we do not necessarily claim neither the totality of contents, nor the militant dynamics or the programmatic body of their authors (whether they are collectives or individuals), we reproduce (for the moment only in French) on our blog the new article of Tristan Leoni on the Islamic State and the Syrian-Iraqi conflict, originally published on the blog DDT21 Douter de tout… | Douter de tout… pour tenir l’essentiel [DDT21 Doubting about everything… | Doubting about everything… to hold the essentials].
We believe that this article, despite its somewhat “academic” form and its “objectivist” style (multiple journalistic references that are supposed to give it a veneer of “seriousness”), compiles and synthesizes a whole series of important information and readings. It also represents a great relevance for many militant discussions at the international level on recent evolution of the politico-military front of the “civil war in Syria” and the very media “war on terror” and “against the Islamic State” in particular.
So far, we have neither the force nor the time and the militant energy to translate the whole text in English, Czech or Spanish (for example). Nevertheless we want to affirm here our fierce desire to centralize any initiative coming from comrades able to take on with us this task of translation in these or other languages. We are therefore issuing an appeal and we are already proposing the translation into several languages of a small excerpt from this text. It is more specifically focusing on the critics of the illusions towards the so-called “Rojava Revolution” and its politico-military structures always more heavily integrated into state military systems: weapons supplied by the US, coordination of military campaigns with the US, Russia and Syria, construction of US military bases, presence of Western special forces troops within the coordination of Rojavist militias, etc.
The article was originally published in French at the following address:
https://ddt21.noblogs.org/?page_id=1906
The article is also available in French in PDF format A4:
https://ddt21.noblogs.org/files/2017/12/Califat-et-barbarie-La-Lutte-finale.pdf
The three previous articles in French in the series “Caliphate and barbarism” are available at the following addresses:
“Caliphate and barbarism” first part (December 2015):
https://ddt21.noblogs.org/?page_id=667
“Caliphate and barbarism” part two (December 2015):
https://ddt21.noblogs.org/?page_id=728
“Caliphate and barbarism: Waiting for Raqqa” (July 2016):
https://ddt21.noblogs.org/?page_id=1030
Even the last admirers of Rojava’s “libertarian utopia” in Western far-left circles must recognize “the state aspect” of this “experience”, its “proto-state institutions”, the weight of the PYD, the compulsory military service, the leader cult, the respect for private property, etc. They still hope that with time the situation can develop positively. In the meantime it is talked a lot about the communes that the PYD sets up in villages and neighborhoods. Yet, far from the workers’ councils, they are mainly district councils with limited and consultative powers, and with the role of first instance judicial mediators. The rest of the political and administrative functioning, which seems to be very bureaucratic, is modeled on the Western democratic institutions – which, it is true, is a novelty in Syria.
The regime in power in Rojava also announces a “will to defend a form of organization of society that respects gender equality and linguistic diversity” and “a fraternal, democratic, ecological and emancipatory society for all without distinction of gender, ethnicity or faith”. This is very good, as it is for the establishment of gender equality in all areas. But isn’t it a little exaggerated to call these principles “revolutionary”? And when it’s said “for patriarchal societies”, should we understand “for these people”? Because we do not see very well how could “revolutionaries” support and praise such a process, unless they believe in a kind of an Orientalist reverse momentum, that it is very good for them, or they think (perhaps following recent theoretical discoveries) that the establishment of a parliamentary democracy based on the Western model is now an indispensable step for a future social revolution.
If it was possible to be mistaken in 2014, it is incomprehensible that in 2017 some people still discover in Rojava a “revolutionary”, “libertarian” or even “self-managing” experience. We won’t come back to that. The word “revolution” has been widely overused in everyday language, to such a point that it has no longer any precise political meaning. It seems that it is now the same in far-left or anarchist circles, where this word is increasingly synonymous with evolution towards more democracy. In addition to losing battles, if we lose words, it’s utopia itself that is weakened.
https://www.autistici.org/tridnivalka/caliphate-and-barbarism-the-final-struggle/
Comments